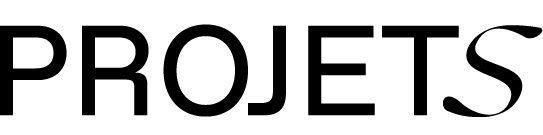Les visiteurs des foires d’art, comme ceux des musées, passent un temps fou à consulter cette « étiquette fixée sur le cadre d’un tableau, le socle d’une statue et portant une inscription qui identifie l’œuvre », pour citer la définition du Larousse à propos du cartel – quand celui-ci relève des beaux-arts. La FIAC offre une grande variété de cette signalétique sur bristol, déclinant une typologie à laquelle on prête peu attention, mais qui n’est pourtant pas totalement anodine.


On observe ainsi que certaines enseignes choisissent de mentionner d’abord leur nom : en capitales (Paula Cooper ; Waddington Custot, White Cube ; Magnin-A ; Almine Rech…), et parfois en lettres rouges (Van de Wegghe fine Art ; Galerie Max Hetzler, Konrad Fischer …). D’autres optent pour des minuscules, tels que Massimo de Carlo, ou Lelong & Co dont l’intitulé est séparé par un trait noir. La galerie Buchholz fait figurer le sien en gras, dans une police légèrement plus grande que celle utilisée pour le reste du texte.


D’autres galeries mettent en avant le nom de l’artiste, en minuscules (Semiose ; Kukje …) ou en capitales (Nathalie Obadia ; Marian Goodman ; Vedovi Gallery…). Leur nom peut parfois apparaître en cursives déliées (Esther Shipper), ou sous forme de logo (Pace).
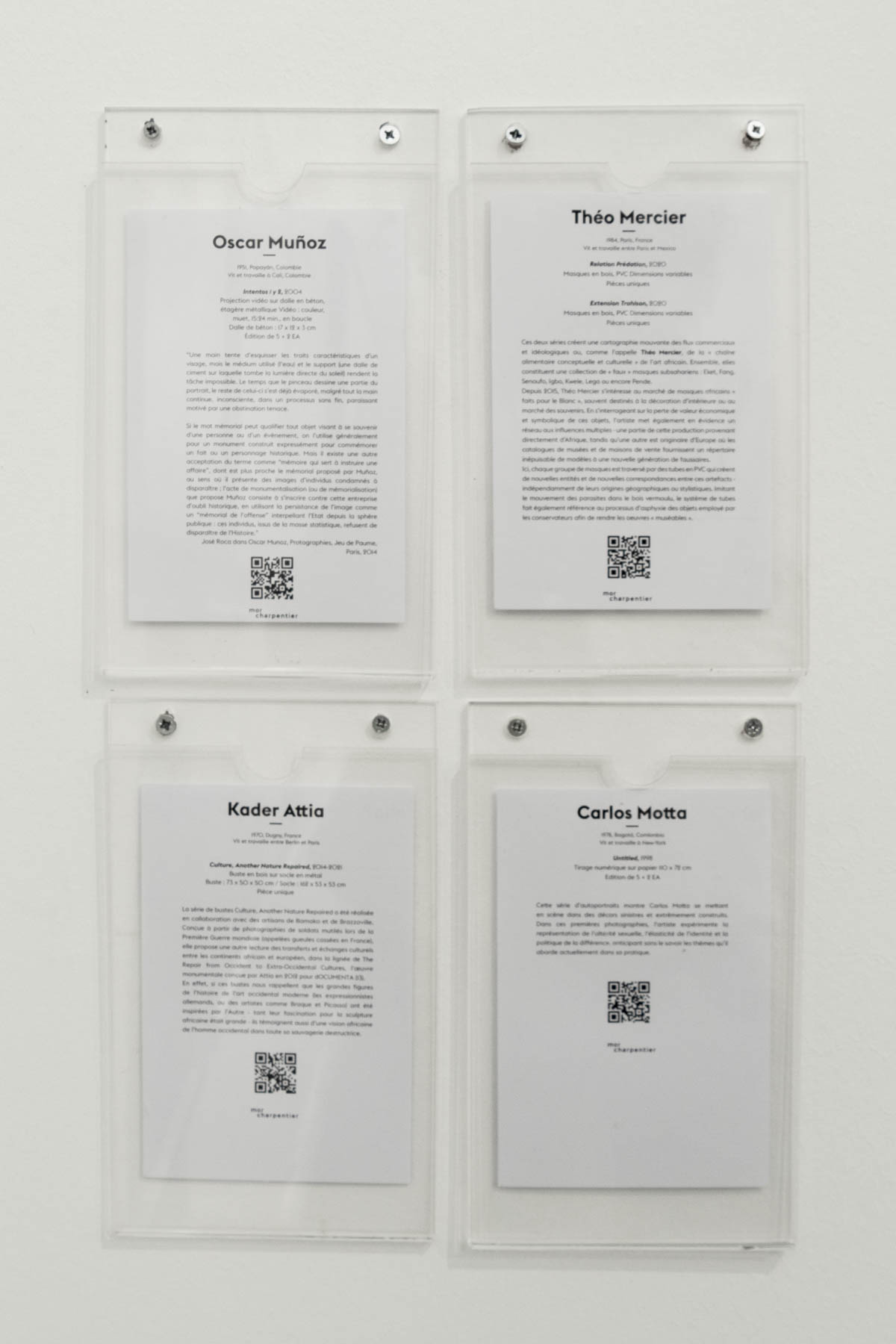

Certains cartels sont strictement factuels – patronyme de l’artiste, titre de l’œuvre, dimensions, matériaux… D’autres offrent davantage d’informations. Zlotowski accompagne par exemple la présentation d’un tableau de Robert Motherwell, Pink Nude with Blue Stripe (1976), de trois paragraphes : « Provenance », « Exposition » et « Littérature ». Mor Charpentier livre une longue explication sur l’installation de masques en bois et tubes PVC de Théo Mercier disposée au mur (Relation Prédation et Extension Trahison, 2020), tout comme Nogueras Blanchard fournit quelques clefs à propos de la sculpture textile de Mercedes Azpilicueta On the Dignity of Codpieces (2021). Quant à la galerie Nahmad Contemporary, elle expose en français et en italien une lettre « vraisemblablement rédigée par le peintre Virgilio Guidi » à l’attention de Giorgio de Chirico, dont une série de vues de Venise est exposée sur un papier peint à motifs de briques rouges évoquant un entrepôt industriel. Ce parti-pris scénographique fait d’ailleurs un peu mal aux yeux.
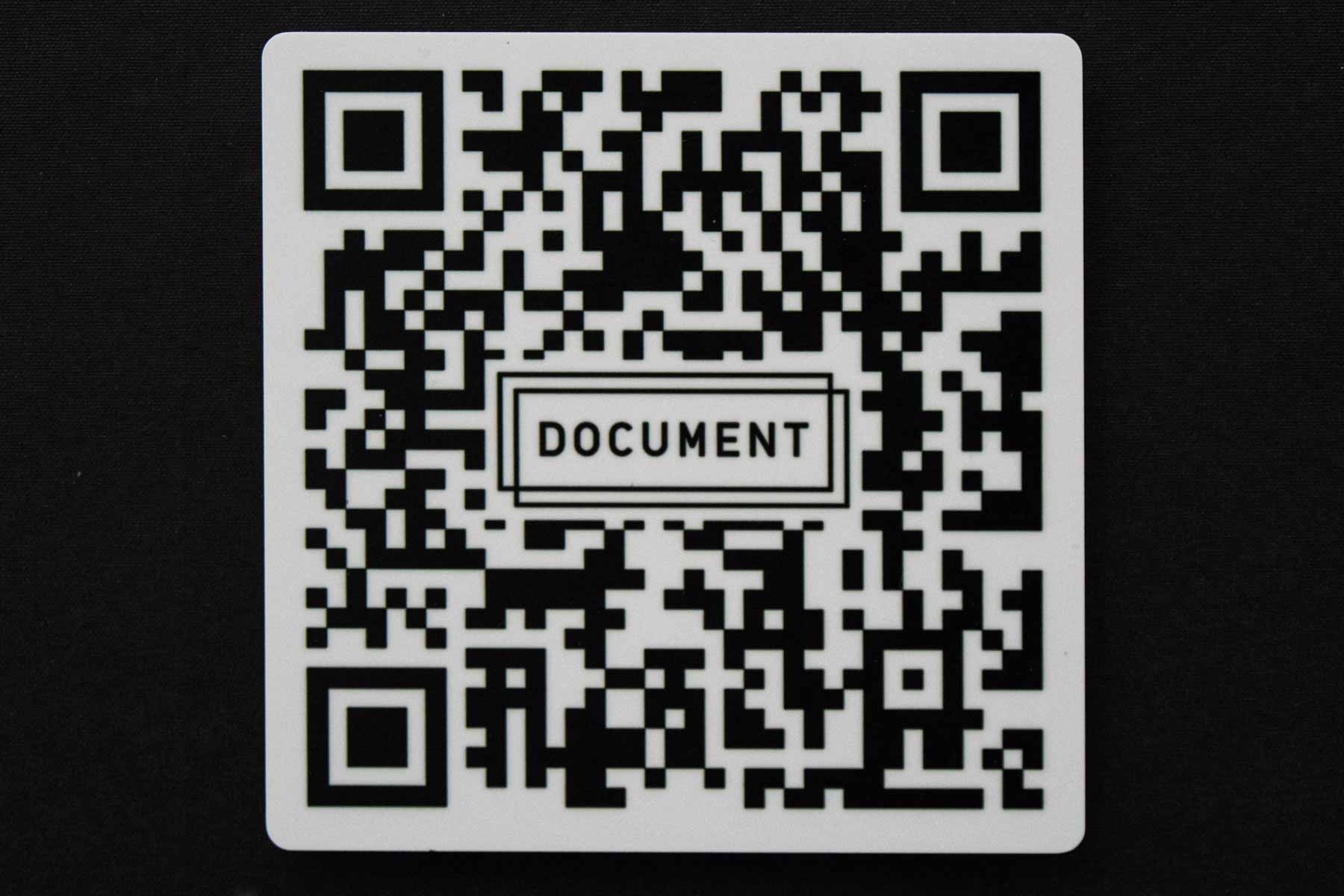

Lorsque le stand est dédié à un solo show, le cartel est remplacé par un petit livret, offert à chaque visiteur, un peu comme à l’opéra (neugerriemschneider ; Weiss Falk), ou par une simple page à consulter sur place (Document pour le solo de Erin Jane Nelson). Avec sa spectaculaire installation « all over » signée Agnes Scherer & Paul DD Smith, la galerie sans titre (2016) a fait pour sa part le choix d’un cartel complété par un QR code. Depuis peu, ces codes barre graphiques sont en effet apparus sur les cimaises, renvoyant aux viewing rooms des galeries sur la plateforme de la foire. Signe des temps. Le QR code a le mérite d’être discret, mais il surfe sur la fracture numérique, excluant ceux qui n’auraient pas de Smartphone. Et que faire si la batterie de son téléphone est à plat ? Certains stands, comme celui de la galerie Allen, proposent un cartel unique rassemblant toutes les œuvres, permettant d’avoir l’ensemble des informations d’un seul coup d’œil. En version minimale et low tech, on note aussi le procédé consistant à rédiger le nom de l’artiste à même le mur. Air de Paris est coutumière de cette pratique qui rappelle l’esprit des artists run space et que l’on remarque également, sur cette édition de la foire, chez Dvir Gallery.
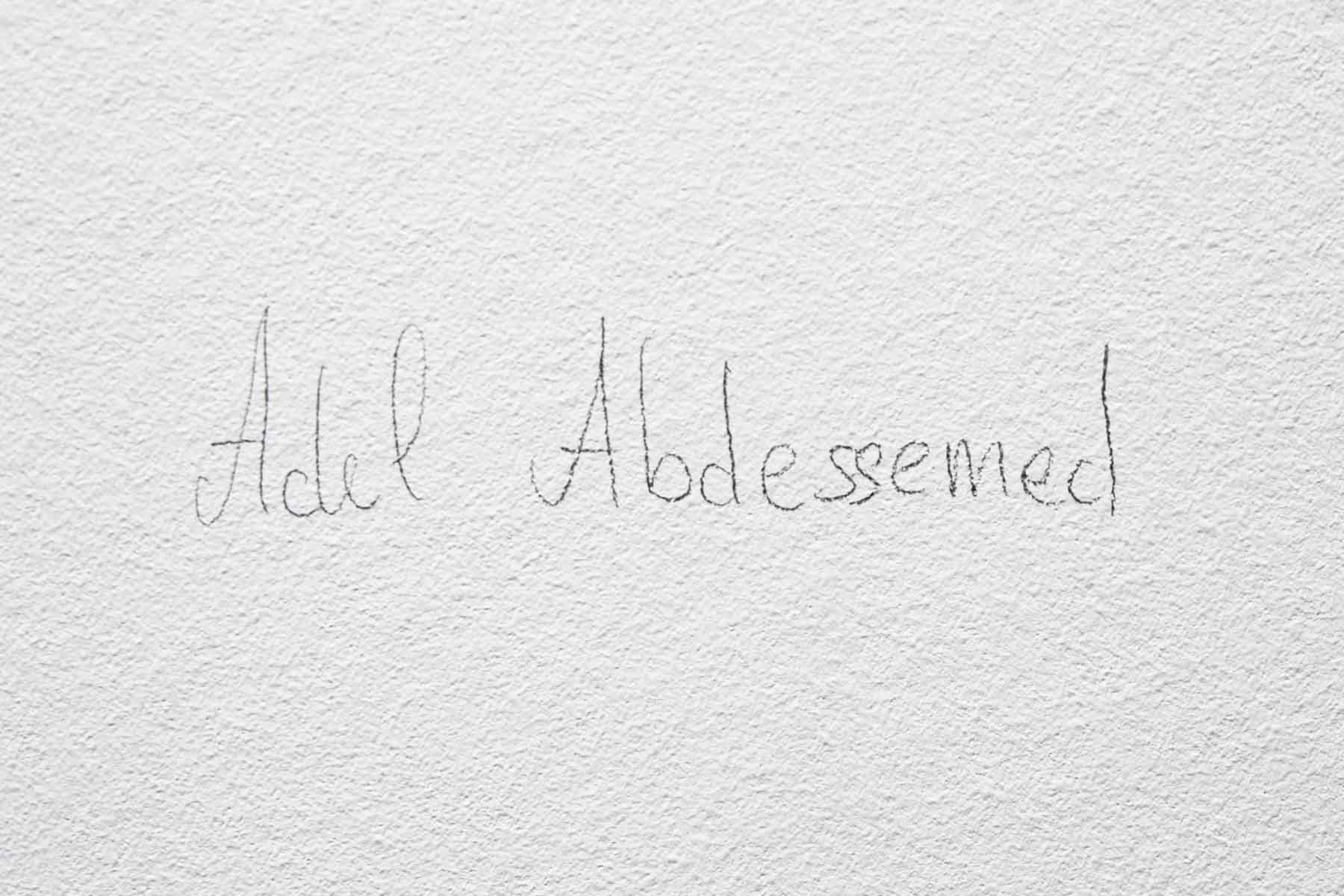
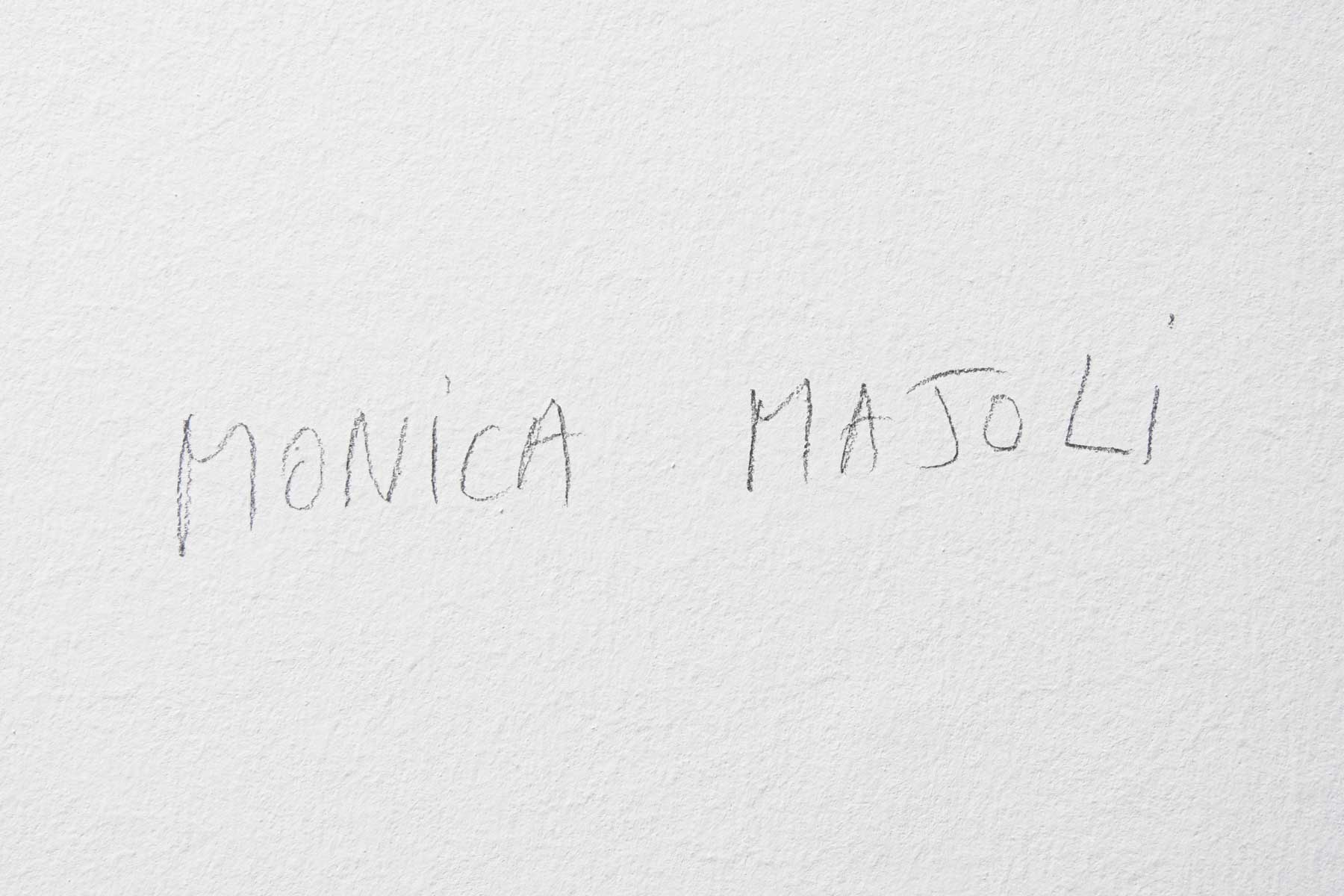
Le point commun de toutes ces variantes ? Le prix est toujours la donnée manquante. « Combien ce tableau ? », s’enquiert ingénument une visiteuse plantée devant un joli petit Josef Albers dans les tons de bleu et vert sur le stand de la galerie Zwirner. « 500 000 », lui répond-on sobrement. Rappelons que le terme de cartel désigne aussi « l’entente réalisée entre des entreprises d’un même secteur d’activité, afin de limiter la concurrence en s’accordant sur les prix et le partage du marché ».