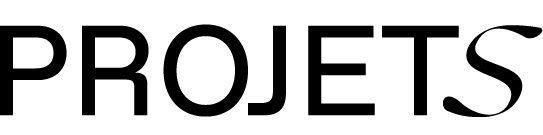Du choeur antique à la sculpture sociale : sur la pente glissante de l’art politique.
L’artiste lituanienne Lina Lapelyté présente pour cette 17ᵉ édition de la Biennale de Lyon une installation et performance intitulée Study of Slope, littéralement « étude de la pente ». La pente, c’est ici celle qui relie le son à l’image ; la quotidienneté à la virtuosité (en l’occurrence celle de l’écriture musicale), le singulier au collectif. Le titre de la pièce nous rappelant que les pentes, même glissantes, sont des plans inclinés qu’il est bon de chercher à gravir.
On retrouve ainsi dans le décorum des grandes Locos, ancien technicentre SNCF de onze mille mètres carrés ; en extérieur, posé là, entre deux halles, des enregistrements de sons de chantier dissimulés dans des monticules de terre. Sur ces masses mal dégrossies, poussent fébrilement des orties abimés par la pluie. On y retrouve également des dalles ocres en terre cuite, mises côte à côte pour former de petites pentes douces. Dans le fond, un écran LED, en forme de bandeau, sur lequel défile du texte, on y lit : «Ce que j’ai fait de ma vie, ce que je suis devenu.». Le tout accueillant un choeur d’une quinzaine de personnes, d’à peu près tous les âges et chantant faux. La proposition semble à première vue aride, pour ne pas dire pentue, et en effet on se demande si à décréter que tout est art, et en sanctifiant le moindre geste, on ne prend pas le risque d’aboutir à une implosion de la sphère artistique ? Oui mais voilà, il y a malgré l’apparente pauvreté et âpreté du dispositif, quelque chose qui advient. Des questions importantes sur le rôle de l’art, sa dimension sociale, le pouvoir politique et performatif du langage, émergent. On se demande par exemple si on peut dissocier la voix de ce qui est dit ? Si le chant est l’affaire de la parole, ou l’affaire du collectif ? Si l’agora doit se soucier ou non des images et des formes ?

Lina Lapelyté, Study of Slope, 2022-2024
Jardin d’orties, son (45’), performance musicale pour des chanteur·euses dépourvu·es d’« oreille musicale », texte, costumes, chaussures, rampes en céramique, bancs en pierre, cannes. Courtesy de l’artiste
Photo Jair Lanes
Tout au long du XXᵉ siècle, les artistes n’ont cessé d’excentrer et d’élargir l’art en direction de tout ce qui en était traditionnellement exclu. L’art a donc visé à rejoindre la vie jusqu’à se fondre et se confondre en elle. On a alors en tête cette fameuse formule de Robert Filliou disant que « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », mais reste à savoir quel aspect de la vie est choisi et élu digne d’être rendu à nos vues brouillées.
Le geste de Lina Lapelyté, et c’est peut-être ce qui la situe à l’endroit de la performance et de l’art contemporain plutôt que du spectacle vivant, c’est de décider d’habiter cette frontière entre l’art et la vie. Il ne s’agit certes pas d’un art participatif, ou des expériences d’art en commun telles que peuvent les pratiquer des artistes comme Thomas Hirschhorn ou Javier Téllez (qui incluent les problématiques d’un territoire en co-réalisant l’oeuvre avec les habitants.tes), mais bien d’un art où la question politique de ce qui lie les individus, des moyens d’association des récits individuels en parole collective, est au centre des préoccupations.
Pourtant cette performance n’a pas non plus la factures des happenings des années 1970 qui travaillaient déjà le matériel, social, politique, urbain, prosaïque et langagier. Ni celle des performances du Living Theater qui se développa au sein d’un champ intermédiaire entre théâtre et action politique, en faisant irruption dans l’espace public. L’espace étant ici certes public mais encore celui du monde de l’art, celui d’une biennale, avec ses normes et ses codes. Ce qui varie peut-être principalement alors, c’est la nature de l’activité humaine qui est prise pour sujet de l’oeuvre, à savoir le fait-même de faire spectacle. Car c’est bien l’acte de chanter ensemble qui est montré. Montré sans les artifices du spectacle. Le spectacle est comme mis à nu, désossé. Exercé non plus comme représentation, mais comme événement. On sent en effet une volonté de Lina Lapelyté de travailler le temps et l’espace sans à-coups, c’est-à-dire en se fondant dans le paysage, dans un continuum formel et rythmique qui suit le flux de la vie vécue. Celle des spectateurs.rices, mais aussi celle des performeurs.euses, qui est d’ailleurs un groupe d’amateurs.rices volontaires.

L’artiste renoue ainsi avec une pratique de la tragédie antique qui consistait à constituer les choeurs de citoyens non professionnels, recrutés dans la ville pour l’occasion. Ces non-acteurs faisaient le trait d’union entre les citoyens.nnes-spectateurs.rices et les acteurs. Leur permettant de passer de la salle à la scène. En outre, le choeur était celui qui regardait les acteurs, qui étaient les plus souvent des rois et des dieux. On comprend alors toute la portée politique de cette entité située entre la représentation et le réel, entre le peuple et les puissants. Expression de l’opinion publique, Aristote dira qu’une des inventions majeures de la tragédie antique était d’impliquer le choeur dans l’action. Ainsi, le choeur n’est plus seulement témoin mais sujet même de la pièce ; la parole publique devient l’énergie du déroulé tragique. Et ici, c’est précisément ce que Lina Lapelyté tente de réactiver à travers l’activité du chant. Car le chant, c’est bien ce qui commence très modestement, sous la douche, tout en portant le fantasme de la communauté idéale qu’il pourrait produire. L’harmonie pure des voix, chacun y trouvant sa place, chaque voix s’harmonisant par rapport à celle du voisin. Et on le sait, cette société pure est toujours au bord de sa dégénérescence, en voix fusionnelles, celles des chants de guerre, de la communauté émotionnelle et effervescente. Dans Study of Slope, les chants travaillent cette tension entre écriture poétique et problématiques politiques. Bien que la choralité, qui unifie, diffère de la polyphonie, l’écriture chorale n’efface pas ici totalement l’individu. En effet, des extraits personnels, anecdotes de la vie quotidienne, de pratiques, de spiritualités, du travail, des chanteurs.euses, font irruption dans le chant. En outre, le réel n’est pas utilisé à la manière du vérisme ou du naturalisme du XXᵉ siècle où objets, machines, déchets et matériaux du quotidien, faisaient le support et l’essence de l’oeuvre. Mais bien sous sa forme métaphorique et idéologique : histoire, sociologie, événements de la vie quotidienne. Car ce qui se raconte est vrai. Poétique mais vrai. Ce principe était déjà à l’oeuvre dans Have a good day !, montré tout récemment dans le cadre du festival d’automne et de la saison lituanienne à Paris. Aux cotés de ses comparses Vaiva Grainytė et Rugilė Barzdžiukaitė, avec qui elle avait déjà gagné le lion d’or à la Biennale de Venise en 2019, Lina Lapelytė mettait en scène le récit chanté du quotidien de caissières de supermarché, installées en ligne sur la scène du Théâtre du Rond Point.
Il est intéressant de noter qu’ici, et comme elle l’avait déjà fait dans The Mutes, joué à Lafayette Anticipations en 2022, l’artiste choisit délibérément des personnes qui n’ont pas l’oreille musicale. Outre la dimension comique que suscite le mauvais chanteur, c’est le rapport conflictuel à l’identité qui est recherché. Car la voix c’est l’intimité immédiate, il n’y a rien de plus personnel qu’une voix, elle est distinction et identité. Et en même temps, cette voix il faut la conquérir, parfois elle nous échappe, elle nous trahit, elle déraille, elle parle faux, elle ne coïncide pas avec notre voix intérieure. À travers ce rapport conflictuel que tout un chacun peut entretenir avec sa voix, ce n’est pas seulement la musicalité de la voix en tant que métrique ou mélodie qui intéresse l’artiste mais bien son expressivité singulière. Chanter faux au sein d’un choeur, c’est se placer sur cette ligne de crête entre identité et ralliement au groupe.

Lina Lapelyté, Study of Slope, 2022-2024
Jardin d’orties, son (45’), performance musicale pour des chanteur·euses dépourvu·es d’« oreille musicale », texte, costumes, chaussures, rampes en céramique, bancs en pierre, cannes. Courtesy de l’artiste
Photo Jair Lanes
À travers cette action du chant, qui réunit pour énoncer, «parler de concert», on s’interroge sur le sens des sons. Dans la lignée de ce que préconisait Cage «laisser être les sons, ce qu’ils sont.», Lyna Lapelyté donne à entendre des enregistrements métalliques et des bruits de chantiers qui se mêlent aux paroles chantées. Ces frottements sonores nous font réaliser que le chant fait quelque chose de très particulier à la parole. En effet, on se dit que la parole peut être chantante, même si la voix ne chante pas. Et que le chant est une forme d’expression qui peut se passer de parole. Nous vient alors une interrogation ; comment en est-on venu à établir cette distinction entre chant et parole ? Pourtant, pendant une grande partie de notre histoire occidentale, on a considéré la musique comme un art verbal, c’est-à-dire que la tessiture du chant se trouvait essentiellement donnée par la sonorité des mots mêmes. Or, aujourd’hui, le langage peut aisément être considéré comme un système de signification qui fonctionne indépendamment de la verbalisation sonore des mots. Notre conscience va au-delà du son, à l’endroit du sens qui, lui, reste absolument silencieux.
Pour Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguistique contemporaine, les mots ne tirent pas leur existence du son. Après tout, remarque-t-il, nous pouvons nous parler à nous-mêmes, ou nous réciter mentalement des vers, sans émettre aucun son, sans même remuer les lèvres ou la langue. Il n’y aurait donc dans le langage pas de son à proprement parler, mais uniquement ce que Saussure appelle des «images acoustiques», et cette expression est à rapprocher de la manière dont Lina Lapelyté parle de son travail ; ayant étudié le violon classique, puis les arts sonores à Londres, elle dit refuser le terme de compositrice, s’intéressant avant tout autre chose à l’aspect visuel de la musique. L’image acoustique est donc psychologique et visuelle ; elle est l’empreinte psychique de ce son sur la surface de l’esprit. On peut alors se demander si les choix plastiques et formels de cette performance n’ont pas pour objectif de déposer une image (sonore) qui travaille le sens de ce qui est dit. Cette mise en question du sens, des sons et des paroles, on la retrouve également dans l’emploi de l’écran LED qui fait défiler du texte au coeur de l’installation. En effet, on se rend compte que notre familiarité aux mots écrits est un facteur qui nous coupe de leur sonorité. À ce sujet, Tim Ingold cite l’éducateur et linguiste Walter J. Ong : « Quand les mots sont couchés sur le papier, nous avons tendance à les percevoir comme des objets dont l’existence et le sens sont dissociés de leur sonorité dans les actes de parole. Notre familiarité avec l’écrit est tellement ancrée, qu’il nous est très difficile d’imaginer le type de relation que des sociétés ignorant tout de l’écriture pourraient avoir avec la parole. Les sociétés de «l’oralité primaire» ne pourraient pas concevoir les mots indépendamment de leur matière phonique. Pour eux, les mots sont leur sons et non des choses qui s’expriment par des sons. »¹Ainsi, l’espace-temps performance se fait ici le lieu d’élaboration d’une micro-société, où les mots et les choses regagnent leur sens par les sens, le son et la vue.

Lina Lapelyté, Study of Slope, 2022-2024
Jardin d’orties, son (45’), performance musicale pour des chanteur·euses dépourvu·es d’« oreille musicale », texte, costumes, chaussures, rampes en céramique, bancs en pierre, cannes. Courtesy de l’artiste
Photo Jair Lanes
Ce projet de micro-société n’est pas sans rappeler le concept de sculpture sociale de Joseph Beuys. En oeuvrant au-delà de l’art, au niveau de ce qu’il dénomme le travail et la créativité humaine, c’est l’humain en son entier qui est désormais à sculpter et à façonner ; les processus idéaux s’ajoutant et se combinant aux processus matériels sans qu’il soit finalement possible de les démêler. En oeuvrant à faire chanter des amateurs, et en donnant à entendre des fragments de réalité, Lyna Lapelyté s’inscrit dans cette filiation de l’art politique. À la différence près que la chose plastique, la visualité de l’oeuvre, est ici la seule chose non chantante. Ce désenchantement visuel introduit un doute quand à la valeur d’oeuvre de ce qui se déroule sous nos yeux. Sommes-nous face à une oeuvre, ou bien devant une simple, et touchante, chorale de village ?
¹ Tim Ingold, UNE BRÈVE HISTOIRE DES LIGNES, 2011
Félix Touzalin pour PROJETS MEDIA