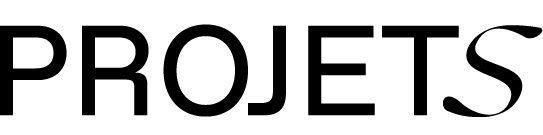Pourvu Qu’iels Soient Douxces – Saison 3 – Épisode 31
↘ PROJET𝘚
– Exposition : « L’esprit du geste » – Institut des Cultures d’Islam
– Débat : Comment dealer avec lae soi du passé ?
Extrait débat :
« Dans l’une de ses chansons, Céline Dion dit: “On ne change pas, on attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l’on fait des choix.” Alors, peut-être que c’est vrai, peut-être que, dans le fond, on ne change pas, “on pousse un peu, tout juste, le temps d’un rêve, d’un songe”. Pourtant, il m’est déjà arrivé, et sans doute à vous aussi, d’être très très sûre de quelque chose et puis, en parlant avec d’autres, en lisant ou en écoutant quelqu’un.e, il m’est déjà arrivé aussi de changer d’avis. C’est précieux de décaler nos regards, nos pensées, au contact d’autres expériences et de se sentir toujours en mouvement, de sentir qu’on a toujours à apprendre pour mieux appréhender.
Mais, quand on a une pratique qui laisse des traces, qu’est-ce que ça implique ? Est-ce qu’il faut documenter ces mouvements, faire comme si de rien n’était, renier ce que l’on a été ? Quand on écrit des textes qui sont, toujours, situés et marqués par un contexte, des biais, des choix, comment les relire plusieurs années plus tard ? »
Avec Camille Bardin, Grégoire Prangé, Mathilde Leïchlé, Samy Lagrange.
Retranscription :
Camille Bardin
Bonjour à toutes et à tous, on est ravi.e.s de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu Qu’iels Soient Douxces. Ce soir au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d’Art, un collectif d’auteurs et d’autrices libres et indépendant.e.s. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d’art comme un genre littéraire à part entière et pensons l’écriture comme un engagement politique. Pour Projets, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité, en partageant avec vous les échanges qu’on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu Qu’iels Soient Douxces, c’est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d’une problématique liée au monde de l’art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd’hui, je suis avec Grégoire Prangé.
Grégoire Prangé
Bonsoir !
Camille Bardin
Mathilde Leïchlé.
Mathilde Leïchlé
Bonsoir.
Camille Bardin
Samy Lagrange.
Samy Lagrange
Salut Camille.
Camille Bardin
Et moi-même Camille Bardin. Ce mois-ci, on vous emmène dans le quartier de la Goutte d’Or, à Paris, à l’Institut des Cultures d’Islam, qu’on appellera sans doute l’ICI tout au long de cet épisode, où l’on peut voir jusqu’au 16 février prochain l’exposition L’esprit du geste curatée par Sonia Recasens. Une exposition qui réunit 17 artistes internationaux.ales qui, je cite, « explorent et interprètent des gestes, motifs et matières transmises au fil des siècles et des migrations. » J’ai très hâte de vous entendre là-dessus. Pour une fois, on ne s’est pas trop spoilé.e, donc je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez. Mais je vais devoir être encore un peu patiente, parce qu’avant de s’attarder sur cette exposition, on a choisi de consacrer le débat de ce mois-ci au passé, au soi du passé. On voulait se demander comment dealer avec nos productions passées, nos œuvres, nos textes, nos prises de parole formulées il y a parfois des années et avec lesquelles nous sommes possiblement plus du tout aligné.e.s. Mathilde.
Mathilde Leïchlé
Merci Camille. Dans l’une de ses chansons, Céline Dion dit « On ne change pas, on attrape des airs et des pauses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l’on fait des choix. » Alors peut-être que c’est vrai, peut-être que dans le fond, on ne change pas, on pousse un peu tout juste le temps d’un rêve, d’un songe. Pourtant, il m’est déjà arrivé, et sans doute à vous aussi d’être très très sûr.e de quelque chose, et puis en parlant avec d’autres, en lisant ou en écoutant quelqu’un/quelqu’une, il m’est déjà arrivé aussi de changer d’avis. C’est précieux de décaler nos regards, nos pensées au contact d’autres expériences et de se sentir toujours en mouvement, de sentir qu’on a toujours à apprendre pour mieux appréhender. Mais quand on a une pratique qui laisse des traces, qu’est-ce que ça implique ? Est-ce qu’il faut documenter ces mouvements, faire comme si de rien n’était, ou renier ce que l’on a été ? Quand on écrit des textes qui sont toujours situés et marqués par un contexte, des biais, des choix, comment les relire plusieurs années plus tard ? Est-ce qu’il faut, au moment même de l’écriture, anticiper ces changements possibles et essayer d’être la ou le plus atemporel.le ? Ou au contraire assumer le fait de pouvoir devenir celui ou celle avec lequel/laquelle on ne sera plus d’accord. Y a-t-il une démarche qui nous permettrait de dire au bout de la route, comme Céline Dion, « J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris merci / Raisonnable et nouveau c’est ainsi par ici, que les choses ont changé / Que les fleurs ont fané, que le temps d’avant c’était le temps d’avant. »
Camille Bardin
Je vais l’avoir dans la tête toute la semaine. [elle rit] Merci Mathilde pour cette introduction. Qui veut commencer ?
Samy Lagrange
Oui, je peux y aller si vous voulez.
Camille Bardin
Allez Samy, on t’écoute.
Samy Lagrange
Bah déjà merci Mathilde pour cette introduction, c’était court et précis et je pense qu’en fait tu as résumé déjà beaucoup de choses qui sont des points d’interrogation.
Camille Bardin
Allez ciao ! [elle rit]
Samy Lagrange
C’est un débat où je pense qu’on va renfoncer beaucoup de portes ouvertes mais en même temps qui sont nécessaires parce que c’est des choses qu’on sait mais qu’on a du mal à s’appliquer à soi-même. A chaque fois, je pense qu’on va répéter beaucoup de conseils qu’on donne aux gens quand les gens viennent se plaindre à nous mais qu’on a un petit peu du mal à s’appliquer vraiment quotidiennement quand nous-même on est dans ces périodes de doute. Il me semble qu’il y a deux choses dans ce que tu as commencé à faire défiler dans ton propos, à la fois comment faire dans le présent sans penser au futur, comment créer sans avoir ce regard toujours tourné vers le futur, et à la fois comment dans le présent regarder ce qu’on a fait dans le passé. Sur ce premier point, peut-être pour commencer – donc première porte ouverte, attention… De toute façon, je pense que penser ce qui sera encore pertinent dans le futur et ce qui va nous paraître à nous pertinent dans le futur, c’est deux choses différentes mais qui sont autant impossibles l’une que l’autre. Donc ça peut être que immobilisant comme pensée dans le présent, vu qu’il n’y a aucune réponse à ces deux questions. Donc je suis totalement d’accord avec ce que Mathilde a esquissé, je pense que c’est vraiment un vrai travail de lâcher prise, mais qu’il faut à la fois chercher à pouvoir s’exalter de faire quelque chose d’imparfait, parce qu’en fait faire c’est fun, et du coup qu’il vaut mieux se concentrer sur cette pensée-là plutôt que de diriger son regard vers le futur et du coup sur quelque chose d’immobilisant puisque d’anxiogène, et aussi de s’exalter, comme tu l’as très bien dit, de bientôt être bousculé.e, déplacé.e, de pouvoir se repenser, se repositionner. Je pense que vraiment c’est le cœur de notre travail d’être constamment remis.e en question et du coup ça devrait être quelque chose qui nous exalte, ou en tout cas le moteur de notre pratique. Peut-être qu’une alternative pour pouvoir se rassurer sur ce qu’on est en train de faire dans le présent – car son pire juge c’est toujours soi-même, c’est peut-être tout simplement (alors ça c’est une grande maraude de JCA), mais de faire en collectif, parce que dès lors qu’on fait en collectif, on fait exister une pensée qui est plurielle. Et par cette pluralité même, peut-être qu’on aura… il y aura une pérennité un peu plus assurée, un peu plus grande de cette pensée qui est figée dans un temps. Et puis en collectif, notre pensée, elle est challengée et remise en question en direct. Tout de suite, on peut un peu checker sa propre pensée du présent au contact d’autres pensées. Et donc, peut-être que ça nous permet de ne pas passer par l’épreuve du temps pour être bousculé.e théoriquement et de se faire bousculer directement.
Camille Bardin
C’est marrant parce que moi je l’ai pris dans l’autre sens. Toi tu as vachement parlé du futur et moi j’ai plus pensé à la moi du passé et au nous du passé de manière générale. Parce que là on a parlé de l’écriture, etc. mais c’est un truc qu’on retrouve énormément chez les artistes. Le nombre d’artistes sur lesquel.les tu dois écrire. Iels t’envoient leur portfolio, tu discutes avec elleux et en fait iels te parlent d’une oeuvre et t’es là « Mais elle n’est pas dans ton portfolio celle-ci…. – Bah non non non je l’aime plus du tout, j’ai tout supprimé et tout. » Et en fait parfois tu trouves des boîtes de Pandore comme ça et tu te rends compte que parfois tu as des mois de boulot, si ce n’est des années de boulot qui ont été supprimées parce que l’artiste trouvait ça nul, etc. Et en fait toi – enfin je ne sais pas vous, mais en tant que critique d’art, je trouve que c’est hyper précieux d’avoir accès aux œuvres du passé, même si elles sont en décalage ou qu’elles ne sont plus exactement en adéquation avec ce que l’artiste fait aujourd’hui. Je trouve que ça apporte vraiment un éclairage nouveau sur son boulot. Et en l’occurrence, moi j’ai plus la sensation de… Je ne sais pas, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, je me dis tout le temps, je me répète toujours en boucle, quand je ne suis pas sûre de moi, quand je produis quelque chose, ou quand je me relis et que je me dis, « Oh là là, comment j’ai pu écrire un truc pareil », ou « C’est tellement mal écrit », etc. Je me dis, à partir du moment où tu arriveras à être complètement sûre de toi et absolument d’accord avec tout ce que tu as dit, écrit, pensé, machin truc, alors là c’est sûr que tu seras devenue une vieille conne. J’arrête pas de me répéter ça. Donc en fait, dès que je suis face aux doutes et que je tremble un petit peu quand je relis certains textes ou quoi, je me dis, « Bah c’est normal, c’est très bien ». Je chéris ce doute-là parce que ça veut dire que je suis en permanence en train de me remettre en question, etc. Et donc il y a aussi un autre truc, c’est que comme à chaque fois que je… c’est bizarre puisque mon métier c’est d’écrire et de penser des programmations, des expos, des machins, mais en fait à chaque fois que je dois écrire un nouveau texte, j’ai la sensation d’en être absolument incapable et de pas du tout savoir faire ça et je me dis « Mais pourquoi les gens m’appellent pour écrire ? Mais quelle idée ! » Et donc, à l’inverse, il y a quand même certains textes du passé que je chéris et que je reprends et que je relis en me disant « Ok, c’est bon, t’en es capable, tout va bien, ça va bien se passer. C’est une montagne mais t’as réussi à en franchir d’autres, donc vas-y. » Donc c’est marrant ce truc-là. Enfin, t’as commencé par le futur et moi je parlerai plus du passé à cet endroit-là. Grégoire.
Grégoire Prangé
C’est marrant ce que vous avez parlé du fait d’écrire et moi j’avais commencé par le fait de lire. Donc on retourne encore les choses. Je suis complètement en phase avec tout ce que vous avez dit. Je pense qu’il y a quelque chose aussi qu’on pourra peut-être un petit peu travailler, c’est la question des typologies de textes.
Camille Bardin
Hum. Complètement.
Grégoire Prangé
Je trouve qu’il y a certains types de textes qui sont beaucoup plus durs à assumer ou à écrire, sans effectivement se projeter dans l’avenir. Mais avant ça, en fait je me suis demandé pourquoi est-ce qu’effectivement on se… on en fait tout un plat, en fait, de cette écriture qui doit rester dans le temps. C’est parce qu’en fait, potentiellement, le texte va être lu dans un, deux, trois, dix ans et pas uniquement par moi, par d’autres personnes.
Camille Bardin
Bah oui.
Grégoire Prangé
Et du coup, je me suis remis dans la position du lecteur que je suis. Et là aussi, c’est une porte ouverte qu’on va enfoncer, mais on lit toujours le texte dans un présent qui n’est pas celui de l’écriture. Et ce texte, on le…. on le juge dans le présent du lecteur ou de la lectrice. On ne le juge pas, ou très rarement, dans le présent de l’écriture. Et du coup, c’est face à cette distance en fait qu’il y a entre écriture et lecture que je pense qu’on se met des sortes de pressions en se disant, même si évidemment c’est une bonne chose de changer d’avis, c’est une bonne chose d’évoluer…
Camille Bardin
T’es quand même ridicule au moment T. [elle rit]
Grégoire Prangé
Ouais ça saoule de se dire que dans cinq ans je passe pour un gros débile tu vois. Alors… Moi, je me rappelle que quand j’ai commencé à écrire j’étais très jeune et je me suis dit cette frustration, cette peur en fait je vais l’avoir toute ma vie donc j’ai… autant tout de suite la mettre sous le tapis quoi et puis faire avec. Mais c’est pour ça par exemple… Il y a un autre truc qui est super galère c’est quand tu donnes une interview et que tu dis des choses et parfois tu relis trois ans plus tard tu te dis mais quel enfer.
Camille Bardin
Ouais…
Samy Lagrange
Chose qu’on inflige à des artistes constamment.
Grégoire Prangé
Ah non mais exactement, c’est un enfer.
Camille Bardin
Mais c’est pour ça, ce débat il est beaucoup plus large, enfin là tu vois on se focalise beaucoup sur l’écriture parce que c’est notre endroit de production mais en fait je pense qu’on serait artistes… Enfin on peut juste changer les mots quoi. Oeuvres, écrits, qu’importe, c’est la même chose il me semble. [iels acquiescent]
Grégoire Prangé
Mais je pense que c’est vraiment un travail… Ouais, notamment la première interview que j’ai donné… Mais j’étais presque pas content le lendemain quoi. Et je me suis dit « Bon allez c’est pas grave, façon ça va disparaître dans Internet ». Pas du tout, c’est encore là très très vite sur Google quand t’as mon nom.
Samy Lagrange
C’est le premier truc qui sort. [il rit]
Grégoire Prangé
Ouais presque. Mais du coup c’est un exercice je trouve à faire sur soi et c’est aussi une forme d’ego qu’il faut venir mettre de côté quoi.
Mathilde Leïchlé
Ouais puis je pense l’exercice de l’interview permet de réaliser ce qui se passe en coulisses et donc d’être aussi un peu plus bienveillant.e quand on lit les interviews des autres parce qu’on sait ce que ça fait, la parole qui nous échappe et je pense que c’est ça qui est dur aussi avec cette forme de l’interview, c’est que… À un moment, il y a une parole qui nous échappe, qui est parfois réécrite, en fonction d’avec qui on échange… Et en fait, je trouve que le parallèle avec les artistes est vraiment hyper intéressant et ce que tu disais Camille, c’est super juste sur les œuvres qui sont un peu cachées au fil de l’évolution parce que c’est cette évolution qui est riche et nous-mêmes je pense qu’on porte toujours un regard très bienveillant sur cette évolution et c’est ça qui fait l’intérêt d’une œuvre et d’une carrière dans sa totalité. Et du coup, le fait qu’on puisse porter ce regard-là sur une trajectoire d’artiste, ça peut nous inspirer aussi pour porter ce regard-là sur nos propres trajectoires de critiques et de personnes qui écrivent en général. C’est drôle, Samy, que tu parles de « portes ouvertes », parce que moi, je ne trouve pas du tout que ce soit des portes ouvertes, parce que je n’ai vraiment pas de réponse à cette question en fait. Chaque fois que j’écris, déjà, comme tu le dis Camille, j’oublie que je sais écrire.
Camille Bardin
Ça va ça me rassure. [elle rit]
Mathilde Leïchlé
Éternel recommencement, vraiment. Et puis, quand je relis des textes du passé, d’un jour sur l’autre, je peux adorer un texte ou le haïr pour le même texte. Donc ça, c’est assez fluctuant. Et je trouve que dans l’écriture, il y a vraiment tout le temps une confrontation aux doutes. Et j’ai vraiment pas de résolution par rapport à ça. Je pense que c’est une bonne chose parce qu’en effet, quand on arrête de douter, ça devient un peu compliqué et je pense qu’on devient pas la meilleure version de nous-même. Et ce que tu dis par rapport au collectif, Samy, c’est super intéressant puisque je suis d’accord avec toi que ça permet de décaler, de poser des questions, d’y réfléchir en groupe avec plein de points de vue différents et c’est hyper précieux. Et en même temps, parfois, ça nous force à aller peut-être un peu trop fort dans une direction dans laquelle nous-même on ne serait pas allé.e parce que justement on a ce doute avec lequel on deal nous-même. Et… et donc, on peut aussi ne pas assumer des prises de position qu’on a… qu’on a choisies dans un élan collectif. Pour moi, une des clés de résolution de ça, c’est toujours la situation, le fait de toujours se situer, de revenir au « je » et d’assumer le fait qu’on est des êtres faillibles, finalement. Mais ça, ça renvoie à ce que tu disais, Grégoire, sur la typologie des textes, où on n’a pas toujours l’espace de ce je-là.
Camille Bardin
Grégoire ?
Grégoire Prangé
Oui, je… je rebondis à ce que tu dis Mathilde en fait parce que j’ai également eu une interrogation sur cette question de la place du collectif dans l’écriture. Évidemment, on a toutes et tous au sein de JCA fait l’expérience de cette chance folle qu’on a de pouvoir partager et parfois même écrire en commun. Néanmoins, je trouve que sur les textes critiques, si on commence à parler de typologie de texte, sur les textes critiques, moi ce qui me permet d’écrire tout en sachant que sans doute je ne serai plus forcément en phase avec ce que j’écris dans deux ou trois ans, parce qu’un texte critique souvent il est jeté. Alors moi c’est assez rapidement. Et puis, il est très contextuel en fait, c’est un corpus d’œuvres d’un artiste ou d’une artiste, c’est une exposition, c’est un moment donné, c’est une réaction presque épidermique parfois. Et du coup c’est l’intense conviction que le texte critique est parfaitement subjectif qui me fait dire que s’il est subjectif dans le présent, c’est normal que voilà il soit pas… que même moi je ne sois plus en phase avec lui dans X temps. Contrairement par exemple à un texte scientifique. Alors ça je trouve que c’est vraiment l’angoisse absolue, publier un texte scientifique dans une revue dont on sait justement que, et c’est le but, ce texte scientifique va rester ou doit rester ou devrait rester, et que ce texte il faut le pondre alors même que l’objet de cette recherche n’est pas terminé, parfois même loin de là. Et c’est là justement que le collectif est un garde-fou, parce que justement les nombreuses relectures, les comités de relecture, le regard des directeurs/directrices de thèses quand c’est dans le cadre d’un doctorat, ou d’éditeurs/d’éditrices de la revue, etc. Ça, ça rassure parce qu’on se dit le texte en fait, même je m’en dépossède en partie en fait, il a passé tellement de filtres qu’à la fin, il y a un regard collectif et finalement il y a une…
Mathilde Leïchlé
… responsabilité partagée.
Grégoire Prangé
Exactement, qui est partagée. Et le texte est porté par plusieurs personnes.
Camille Bardin
En fait, j’ai l’impression qu’il y a vachement quelque chose qui est de l’ordre de faire sortir… Enfin, c’est une partie de nous qui est extérieure à nous désormais et sur lequel on n’a plus d’emprise, en fait. Et je le vois notamment… On parlait des interviews tout à l’heure. J’ai dû enregistrer une centaine d’interviews ces dernières années avec des artistes, des très jeunes artistes, des artistes beaucoup plus installé.e.s, etc., etc. Systématiquement, ça se finit de la même manière. Toutes les interviews, à partir du moment où je mets off, la personne dit « Oh là là, j’aurais tellement pu dire ça, putain j’ai pas dit ça, j’aurais trop dû dire ça ». Et ensuite, il y a un autre truc, c’est par rapport à la voix, c’est quand j’envoie l’épisode, les gens généralement sont contents et contentes d’elleux. Mais à chaque fois, le truc qui ressort, c’est « Oh ! Et ma voix, c’est vraiment terrible ! », etc. Et en fait, je pense que ça a un lien avec cette idée de dépossession. C’est-à-dire qu’en fait, c’est nous, mais c’est plus nous. Et donc, c’est tellement violent. Des fois, t’as envie de te dire « Chut ! » Tu te dis « Mais pourquoi je suis en train de dire ça ? » C’est terrifiant. Juste de le dire, j’en ai des frissons de gêne. [elle rit] Des fois, vraiment, c’est douloureux de se réentendre ou de voir des œuvres qu’on a pu produire. Ça me fait penser aussi… Et ça, j’ai un peu envie de vous poser des questions, parce que là, j’ai de la chance d’avoir trois des chercheureuses de Jeunes Critiques d’Art autour de moi, vous êtes toustes les trois en thèse, en l’occurrence. Moi, j’ai assez peu la possibilité de travailler sur des temps vraiment très, très longs, comme vous pouvez le faire. Mais il m’est arrivé, notamment une fois, de bosser sur une exposition qui, finalement, a été annulée, puis décalée, puis redécalée, puis redécalée à cause du Covid à l’époque. Et donc… Sauf qu’en fait le projet de l’exposition était déjà bien abouti quand on a fait tous ces moments de décalage, etc. Donc les trois quarts des artistes étaient déjà prévenu.e.s, les œuvres étaient sélectionnées, etc. Donc entre ce moment de sélection, de pensé ce travail-là, et le moment où l’exposition ouvre, il y a un an et demi qui se passe et moi en fait j’ouvre une exposition un an et demi plus tard où je me dis mais « Alors vraiment, ça me… C’est plus du tout mes considérations actuelles en fait. C’est plus ce à quoi je pense, j’ai découvert plein d’autres artistes, j’ai envie de… » Je me souviens à l’époque, c’était sur les problématiques liées à la déconstruction, au corps. Et je me disais « Mais je suis allée tellement plus loin aujourd’hui, là je montre des prémices de réflexion alors qu’en fait j’ai dépassé tout ça depuis un moment ». Et j’étais tellement frustrée de se dire que là les gens qui allaient découvrir l’expo allaient se dire « Bon ben en fait l’état actuel de la réflexion de Camille Bardin en est là, ça va pas très loin quoi ». Donc oui, qu’est-ce que… Enfin, je veux pas vous… parasiter ce que vous voulez dire ou quoi, mais c’est vrai que je me dis, le travail sur le temps long, du coup tu travailles en temps réel avec ton toi du passé aussi quoi.
Samy Lagrange
Non, non, c’est très intéressant et puis ça rentre totalement dans ce qu’on était en train de dire. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je suis d’accord avec tout ce que vous avez dit et surtout, tout ce que vous avez abordé, c’est exactement ce que j’avais noté. Donc du coup, j’ai envie de rebondir, en même temps ça ne sert probablement à rien, mais j’essaye de… Ça va être bordélique, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit. Mais pour te répondre, en premier, Camille, je pense que Grégoire et Mathilde seront d’accord avec moi, que c’est d’autant plus immobilisant ce temps long qui… qui nous oblige du coup à beaucoup plus de précision. Si on… La rhétorique c’est si on a le temps de le penser aussi longuement, ce qui va être produit au final doit être d’une qualité supérieure. Donc c’est immobilisant, je ne pense pas que ce soit vrai, mais c’est immobilisant. Et en tout cas, même le temps de la publication dans la recherche est long. Là, je… j’ai dû écrire un article, le temps de l’envoyer. Là, j’arrive à peine aux premières corrections qu’on me renvoie. Déjà, je ne suis plus du tout d’accord et ok avec ce que j’ai écrit.
Camille Bardin
Han quel enfer.
Samy Lagrange
Donc je suis d’accord qu’il y a vraiment ce truc de dealer avec sa propre… avec le propre principe des possessions et d’être ok là-dessus. Ce que disait Grégoire, je suis hyper d’accord, je l’avais pas pensé comme ça, mais qu’effectivement, il y a…. il y a un truc de collectif qui fait que la responsabilité est partagée. Après, je ne suis pas sûr qu’il faille… Moi, je n’aurais pas fait de distinction, en tout cas… Ça me fait du bien de ne pas faire de distinction entre un texte critique et un texte de recherche, parce que ça voudrait dire que l’un est totalement subjectif, comme tu l’as dit, alors que l’autre serait totalement objectif.
Grégoire Prangé
Oui, j’ai évidemment pas voulu dire ça, mais oui.
Samy Lagrange
Mais comment on l’aborde ? Je pense qu’on l’aborde forcément comme ça, qu’il doit avoir une certaine objectivité et du coup, il doit avoir une qualité intrinsèque au texte de recherche qui fait qu’il ne va pas être dépassé dans les années à venir, ou en tout cas qui sera toujours vrai d’une certaine façon. Moi, ça me rassure de me dire genre « Bah non, c’est ma subjectivité sur un sujet. Et du coup, c’est hyper ok qu’il soit déjà dépassé dans deux mois ». Donc pour finir à l’emporte-pièce, j’étais trop d’accord avec ce que tu as dit Camille sur relire les textes du passé. Moi aussi je trouve que c’est une manière de se redonner un certain ego boost et de se rendre compte qu’en fait on en était capable et ça permet vraiment de pouvoir dépasser un blocage qui est psychologique et contextuel à un moment donné. Et aussi, Grégoire, tu parlais de penser à comment les autres nous voyaient à travers ces textes. Je trouvais ça intéressant quand j’y réfléchis, de se dire que la technique pour être ok avec le soi du passé, c’était de regarder comment nous, on voyait les gens à travers les textes. Est-ce que vraiment, quand tu lis un texte de quelqu’un.e, tu le.a figes dans ce texte-là ? Est-ce que tu le.a juges vraiment à ce qu’iel a fait dans le passé ? Est-ce qu’on regarde la valeur de quelqu’un.e à travers sa production ? Est-ce qu’on fait, quand on lit quelque chose, la distinction entre la pensée passée et la pensée présente ? Est-ce qu’on juge forcément à l’emporte-pièce ? Est-ce qu’on va vraiment regarder ce que les autres ont fait dans le passé ? Donc, c’est plein de questions de voir comment on travaille notre regard. Souvent, moi, ça m’apaise de me dire genre « Bah en fait, je ne juge pas les autres ». Enfin, ça a encore eu un peu une porte ouverte.
Camille Bardin
Parce que tu es une bonne personne. [iels rient]
Samy Lagrange
Je ne juge personne. On ne juge jamais les autres aussi sévèrement qu’on se juge soi-même. Et pourtant, quand j’y ai pensé genre dans nos milieux, j’ai un peu l’impression qu’une production écrite ou une exposition, elle peut figer une persona professionnelle à un moment donné et que c’est aussi ça qui nous fait flipper. C’est de se dire genre t’as produit un truc, il y a peut-être quelqu’un.e dans le milieu professionnel pas si loin que toi qui va te résumer à ça.
Camille Bardin
Ouais.
Samy Lagrange
Et ça je pense que malheureusement c’est un petit peu vrai et que du coup ça nous donne un peu des raisons de flipper de nos productions passées parce qu’elles peuvent vraiment être des manifestes de ce qu’on a fait.
Camille Bardin
Parce qu’il y a tellement de productions, on n’a tellement pas le temps de tout voir, qu’effectivement tu vas associer des formes, des écrits, des textes, en disant « Bon bah telle personne elle fait ça et pas ça quoi ».
Samy Lagrange
Oui, d’être jugé.e à l’emporte pièce.
Camille Bardin
Mathilde ?
Mathilde Leïchlé
Par rapport à ton partage sur l’exposition Camille, tu avais ce sentiment-là aussi, parce que toi tu avais connaissance de ton évolution.
Camille Bardin
Ouais.
Mathilde Leïchlé
Mais les gens à qui tu présentais ça, iels n’avaient pas connaissance de cette évolution-là, donc iels ne portaient pas le même regard de jugement que toi sur cet objet. Et je pense que c’est ça qui est dur aussi avec la peur d’être contredit.e, c’est qu’on a toutes ces voix dans nos têtes qui disent « mais on pourrait faire ça, mais on pourrait dire ça ». Et peut-être qu’une des pistes c’est d’essayer de se réconcilier avec ça. Je pense que quand on écrit des textes scientifiques, un des espoirs ça peut être aussi d’être contredit.e par d’autres.
Camille Bardin
Ouais.
Mathilde Leïchlé
Moi, perso, quand je travaille sur mon sujet de thèse, je me dis « Bah là, j’émets une hypothèse, mais si d’autres personnes ne sont pas d’accord avec moi, en fait, ce sera hyper riche parce que soit ça me confortera dans ma position, soit ça me fera décaler mon regard et j’avancerai en fait ». Mais ce qui est dur, je trouve, c’est de se contredire soi-même. Parce que… Comment on fait quand on n’est plus d’accord avec quelque chose ? On peut toujours réécrire un article ou faire changer nos textes en fonction de cette évolution, mais c’est quand même pas évident. Et puis il faut avoir la vision d’ensemble et justement ne pas être figé.e dans un texte à une époque. Et pour revenir à la question que tu posais sur le temps long de la thèse, par rapport à mon projet de recherche en début de thèse, je suis plus d’accord avec mes hypothèses de base.
Samy Lagrange
[il rit] Moi non plus.
Camille Bardin
Et heureusement presque !
Mathilde Leïchlé
Et je pense que c’est très bien en fait, parce que ça veut dire qu’on a travaillé. Ça veut dire qu’on a fait des recherches et que ça, c’était des présupposés qu’on avait sur le sujet. Mais le fait de pouvoir se contredire, ça veut dire qu’on est allé.e à des endroits qui permettent d’apporter des preuves autres et qui, du coup, font avancer notre pensée et la… la font évoluer…
Camille Bardin
… la précisent.
Mathilde Leïchlé
la précisent exactement. Et oui, en effet, je pensais exactement à ça, Samy, sur le temps entre la publication d’article et… entre l’écriture de l’article et sa publication, parce qu’il y a aussi une avancée de l’actualité de la recherche et donc on peut toujours ajouter quelques petites notes de bas de page pour citer des personnes qui ont publiées entre-temps. Mais c’est assez compliqué comme exercice. Et ce temps long aussi, il fait que pendant qu’on réfléchit, il y en a d’autres autour de nous qui réfléchissent et qui publient, qui travaillent. Et donc la question, c’est toujours quand est-ce qu’on s’arrête ? Quand est-ce qu’on fige notre pensée, mais aussi la pensée des autres autour de nous ? Quand est-ce qu’on se coupe du bruit et de la conversation générale pour dire « Bon bah là, voilà, c’est ça que je pense avec la pensée des autres à ce moment-là ».
Camille Bardin
Grégoire ?
Grégoire Prangé
Oui, il y a énormément de choses sur lesquelles j’aurais envie de rebondir, mais je vais en choisir quelques-unes. Déjà, la première chose, c’est par rapport à cette question du temps de publication. Je pense qu’on a aussi un rapport différent à ça selon le moment où on est dans la recherche, d’une part, et puis d’autre part, selon le domaine de recherche dans lequel on est. Moi, ce que je trouve très rassurant dans la recherche, universitaire, c’est qu’il y a souvent la notion d’urgence. J’ai pas l’impression de la ressentir. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’urgence de l’actualité souvent. Donc, il y a un temps qui existe. Et on sait que la recherche prend du temps, et donc ce temps, on l’accepte comme ça. Il y a des articles parfois qui mettent un an et demi à être publié, mais ce n’est pas forcément grave. Par ailleurs, j’ai un article qui a été publié justement il y a une semaine, que j’ai rendu début juillet. Donc comme je suis en début de thèse, ça me paraît déjà un temps long. Et en fait, quand j’ai écrit en juin et début juillet, j’avais encore beaucoup de mal à comprendre mon sujet. Donc je trouve que c’est là qu’il y a quelque chose qui est quand même compliqué, c’est qu’on pose des mots, on fait des choix de vocabulaire. Au-delà des notes de bas de page, au-delà d’assumer on va dire l’évolution de la recherche collective, il y a le fait qu’on comprend certains rouages de son objet d’étude au fur et à mesure. Et parfois, c’est même le concept ou les concepts qu’on a développés dont on n’est plus sûr qu’ils tiennent. Et ça, je trouve ça compliqué. Mais effectivement, je trouve que le fait qu’il y ait qu’on soit responsable collectivement de l’article qui est porté ensemble, et qu’il soit daté, en fait, tout simplement, et qu’on puisse aussi revenir dessus, le réécrire, je trouve ça très rassurant. Et juste… Pour finir là-dessus, je suis complètement d’accord que des thèses qui vivent sont des thèses qui sont faites pour être contredites, par soi ou par les autres, ça c’est pas du tout un problème. Mais là aussi, je trouve qu’en début de recherche, quand on a une recherche qui est balbutiante, la crainte, c’est pas qu’on soit contredit.e… qu’un bon travail soit contredit par une bonne opposition, c’est qu’on pointe un mauvais travail, qu’on pointe des grosses lacunes, des vrais problèmes.
Camille Bardin
Qu’on soit invalidé.e quoi.
Grégoire Prangé
Et ça, c’est un peu immobilisant quand même.
Camille Bardin
Ça c’est l’angoisse.
Grégoire Prangé
Mais encore une fois, les gardes-fous sont nombreux.
Camille Bardin
Ça me fait penser à deux choses. Ça me faisait penser à la mode. Je me disais, c’est marrant, en fait, sur les questions de temporalité. En fait, la mode d’il y a cinq ans, on ne peut plus se la voir. Vraiment, c’est la honte si tu portes encore les pompes que tu portais il y a cinq ans tu vois. Ce qui est sans doute mon cas, mais passons. [iels rient] Mais par contre, on est en plein revival des années 2000. Alors qu’il y a dix ans, on voyait les fringues des années 2000, on se disait mais quel enfer, comment on peut porter un truc pareil ? Donc en fait, plus c’est distant de nous, plus ça devient ok. J’ai un peu cette impression-là. Et du coup, plus tu peux retrouver, chérir certaines choses, etc. Même moi qui fais un travail avec ma psy, je me rends compte que la Camille-enfant, je la trouve trop choupie. Par contre, la Camille-ado ou jeune adulte, j’ai envie de la claquer parce qu’elle est encore trop proche de moi, tu vois. [elle rit] Et donc je trouve que cette temporalité-là, elle est importante à prendre en compte. Et donc ça, c’était le premier point que je voulais aborder avec vous, cette question de la mode et du coup de la temporalité finalement. Et ensuite, je voulais aussi évoquer une conversation qu’on a eue il y a des années au sein de Jeunes Critiques d’Art, où on parlait de justement le moment où on ne serait plus Jeunes Critiques d’Art. Ce qui approche vraiment à grands pas année après année. Et on se disait, « Vous vous rendez compte, il y a un moment donné… » Enfin là peut-être que c’était un moment où les gens nous voyaient comme des petits cons, des petites connes, et on se disait mais plus tard, nous on verra peut-être d’autres personnes comme des petits cons, des petites connes parce qu’iels nous contredirons dans nos certitudes, etc.
Samy Lagrange
On sera des vieux.lles con.nes.
Camille Bardin
Et on se disait mais on a tellement hâte de ça, de ce moment-là parce que ça veut dire que les choses auront tellement avancé que finalement on aura aussi bien fait le taf nous-mêmes de notre côté quoi. Et je sais pas… En fait, on avait un peu conclu cette conversation là-dessus (je sais pas si je suis assez claire) mais on avait conclu cette conversation en se disant vraiment mais on a hâte qu’on soit des vieux cons et des vieilles connes finalement et que du coup le monde aille mieux finalement. [iels rient] Samy ?
Samy Lagrange
Oui, ce que tu disais sur l’adolescence, ça m’a fait penser à un truc qu’on n’a pas dit, qui pour moi est un peu la base et je pense qu’on se répète entre nous absolument toutes les semaines. Effectivement, il y a ce truc, on ne supporte pas ce qu’on a fait hier. Par contre, on est arrivé.e à des âges où on a une certaine tendresse pour le soir adolescent.
Camille Bardin
Bah oui.
Samy Lagrange
Alors que à 25 ans, moi le rapport que j’avais avec l’adolescent que j’avais été, tout me paraissait crade, honteux, ça grattait, je ne voulais pas regarder.
Camille Bardin
T’as des moments t’y repenses et t’es en mode « quelle horreur ».
Samy Lagrange
Et surtout, ce que je disais, ce que je pensais, comment je m’habillais, ce que je renvoyais, parce que tout est emprunt d’une maladresse adolescente, alors que maintenant on a appris à poser un regard beaucoup plus tendre sur cette maladresse. Ça me fait penser à ce qu’on se dit normalement tous les jours, c’est l’importance du regard doux sur le soi du passé. À chaque fois que quelqu’un.e vient te voir en disant « Je ne supporte pas ce que j’ai fait. » En fait, t’y peux rien, et du coup c’est fait, et ça ne sert à rien de se tirer soi-même des balles dans le pied. Et donc du coup autant essayer de se donner de l’amour un petit peu tout.e seul.e, et ça sert à rien en plus de faire des histoires contre-factuelles, de fantasmer des non advenus. Parce qu’on sait ce qu’on perd, mais on sait pas ce qu’on retrouve. Donc, si ça s’était pas passé comme ça… [iels rient]
Camille Bardin
On en est là putain ! [iels rient]
Samy Lagrange
C’est ce que disait la dame de la cantine quand j’étais petit. [iels rient]
Camille Bardin
Grégoire, est-ce que tu peux conclure là ?
Grégoire Prangé
Ouais non conclure sans doute pas, mais je me dis quand même en vous écoutant que quand on commence à avoir ce rapport de tendresse, voire parfois de nostalgie avec son soi jeune, c’est que sans doute on est passé.e du côté de la barrière.
Camille Bardin
Wa ! Putain.
Mathilde Leïchlé
On n’est plus si jeunes que ça.
Camille Bardin
Ah ouais vraiment c’est de pire en pire quoi.
Samy Lagrange
Est-ce qu’on peut juste noter que l’exercice qu’on on est en train de… dont on parle avec hantise en essayant de trouver des solutions, c’est exactement celui qu’on est en train de faire là, de figer notre parole. Alors que normalement, les paroles s’envolent mais les écrits restent. Là, on a trouvé le moyen de figer des fucking paroles. Et du coup, on est en train de le faire et ça m’a juste fait penser au début quand on commençait cet exercice-là, on était tétanisé.e.s par nos prises de paroles parce qu’on était là genre en fait tous les trimestres je vais avoir de 4 à 8 minutes pour figer ce que moi je renvoie aux gens théoriquement en tant que critique et c’était tétanisant.
Camille Bardin
Ah mais je fais ça tous les mois, je suis toujours aussi stressée à chaque prise de parole, c’est vraiment terrorisant, effectivement. Mais il va quand même falloir parler de cette exposition, donc je vous propose qu’on se lance là-dessus.
Mathilde Leïchlé
Allez !
Camille Bardin
Samy, tu nous introduis cette exposition ?
Samy Lagrange
Bien volontiers. L’esprit du geste est une exposition collective qui se tient à Paris à l’Institut des Cultures d’Islam jusqu’au 16 février 2025. Elle a été curatée par Sonia Recasens et rassemble 17 artistes internationaux.ales. Il s’agit de la rencontre de deux volontés, celle de l’Institut d’interroger les liens entre art et artisanat et celle de la commissaire qui souhaitait questionner la hiérarchie imposée depuis l’Europe entre le grand art occidental et les arts extra-occidentaux dits « mineurs ». Sonia Recasens résume ainsi sa démarche : « J’ai invité une quinzaine d’artistes à une réflexion sensible et poétique autour de techniques, de matières et de récits puisés dans les ateliers des artisans et artisanes comme dans l’intimité des maisons ». L’exposition évoque donc des gestes, des techniques et des traditions issues de différentes cultures, sous le prisme de leur transmission et de leur hybridation. Des gestes des potières tunisiennes aux motifs ancestraux des tapisseries ou des feutrages, en passant par les rituels des îles iraniennes, on observe comment les traditions se transmettent, mais aussi comment, au fil des siècles – des mots de Sonia Recasens – les croyances, les gestes et les matières traversent les frontières, s’entremêlent, se renouvellent et s’hybrident. Il me semble important de noter que l’exposition ne se veut ni inutilement compliquée ni très bavarde, alors je ne vais pas en dire beaucoup plus et je vous laisse la parole sur cette citation de l’artiste marocain Mohamed Chabâa qui ouvre la déambulation sous forme de manifeste : « Notre tradition est révolutionnaire, notre tradition est futuriste ».
Camille Bardin
[elle chantonne] Qui commence ? Mathilde ? Grégoire ? Grégoire.
Grégoire Prangé
Non, déjà, ce que je voulais dire, c’est que c’est une exposition où la place et l’histoire personnelle de la curatrice est tout de suite mise au cœur de la narration. J’ai été même surpris, mais heureusement surpris, de… de voir le « je » dans le texte d’introduction, ce qui est quand même extrêmement rare.
Camille Bardin
C’est la première fois qu’elle l’employait, le « je », dans un de ses textes.
Grégoire Prangé
Ah oui ? J’ai trouvé ça hyper bienvenu en fait et même très rassurant. Et je dois dire que quand une exposition est autant liée en fait à l’histoire et à l’expérience de… de la curatrice, c’est vraiment important pour le public de l’assumer complètement et d’en faire un des… on va dire un des leviers de la narration. Ça, c’est la première chose que je voulais dire parce que ça m’a vraiment heureusement surpris.
Camille Bardin
Mathilde ?
Mathilde Leïchlé
Moi, j’ai vraiment adoré cette exposition. Et en fait, plus je réfléchis à cette exposition et plus je l’adore. Hum. J’ai trouvé que c’était extrêmement généreux. Hum. En fait, tout au long du parcours, j’ai été surprise et j’ai appris à chaque fois des choses. En fait, c’était plein de plis. Et je ne m’attendais pas toujours à ces plis-là, mais ça marchait extrêmement bien. Et en plus, dans les… dans ce qui est construit en termes de médiation autour de l’expo, j’ai trouvé ça aussi hyper pertinent. Le fait que dans les cartels, il y ait souvent la mention des conditions de production, des personnes qui ont aidé à produire les œuvres, par exemple, ça, j’ai beaucoup aimé. Le fait que en fait tout au fil de l’expo, il y a quelque chose qui est appelé « parcours sensible », qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes et qui permet de poser des questions sur les œuvres qu’on est en train de voir. J’ai beaucoup aimé ça, le fait de créer une communauté pas seulement d’enfants visiteurseuses, mais vraiment de toustes les visiteureuses de l’expo qui sont rassemblé.es sur des questions : qu’est-ce que vous ressentez face à cette œuvre ? comment vous pensez que telles œuvres ont été conçues ? Et puis moi j’ai… Alors, il y a plusieurs supports de médiation, il y a les textes de salles, les cartels développés, et puis il y a un journal de l’exposition qui est aussi extrêmement riche, qui permet de développer encore plus loin en créant des liens avec l’histoire de l’art, toutes ces créations. Et je me suis rendue compte que, donc ça se fait sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le premier niveau de l’ICI, et je me suis rendue compte qu’au premier niveau, j’avais pas fait la chose dans le bon sens, mais que ça marchait très bien aussi en termes d’enchaînement. Puisque pour le dire un peu vite, au premier niveau, il y a la question de la construction/déconstruction, vraiment quelque chose d’architecture collective, et puis de processus de création aussi, retranscrire le processus de création, le réinterpréter. Et quand on passe à l’étage, il y a un travail encore autour du geste, puis autour du conte et de la transmission, de la réinterprétation de techniques traditionnelles. Et moi, du coup, je l’ai fait dans ce sens-là, en passant par le conte, alors qu’on aurait pu passer par l’autre côté, mais ça marchait bien pour moi. [Camille rit] Et puis, on arrive à des questions de gestes liés à des spiritualités très fortes mais toujours très en lien avec la matière. Et puis, pour moi, ça aboutissait sur une perspective historique, puisqu’il y a des œuvres de Nil Yalter notamment qui sont présentées dans une salle. Et donc, ça ouvrait sur l’histoire de l’art avec une perspective un peu plus ancienne. Et j’ai trouvé ça très bien ficelé. J’ai aussi aimé le fait qu’il y ait une réflexion sur ce retour au geste qui permet de… de déjouer cette emprise du chef-d’œuvre sur l’histoire de l’art, mais aussi cette emprise du génie individuel et de vraiment retourner au collectif, ce qu’elle fait elle-même dans son processus, puisqu’elle valorise ce qu’elle appelle des « personnalités qualifiées », des personnes, des chercheurs/chercheuses, curateurs/curatrices avec lesquelles elle a travaillé. Et dans le journal de l’exposition, on retrouve des traces de ces échanges avec elleux. Et ça, j’ai trouvé que, encore une fois, c’était plein de niveaux comme ça qu’on pouvait explorer au fil de l’exposition et de sa suite avec la trace du journal qui est laissé.
Camille Bardin
Je suis d’accord avec toi, moi aussi j’ai adoré cette exposition. En fait, je ne sais pas ce qui s’est passé avec cette expo. Je n’ai pas fait le traditionnel disclaimer qu’on fait habituellement en chaque début d’épisode pour dire dans quelles conditions on a visité l’expo parce que vous l’avez fait complètement seul.es. Vous avez simplement envoyé un mail à Sonia parce que, à ce moment-là, l’Institut des Cultures d’Islam était fermé, donc c’était pour savoir si on avait la possibilité de rentrer malgré tout. Et finalement, il a rouvert, donc vous avez fait l’expo tout.e seul.e. Ce qui n’est pas mon cas. Moi, en l’occurrence, c’est Sonia Recasens que je connais, mais on n’échange pas assez justement, et qui m’a proposé de me faire faire le tour de l’exposition, chose que j’ai fait avec une autre membre de Jeunes Critiques d’Art qui est Alexia Abed. Et en fait, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’ai pleuré tout du long. Enfin j’étais… Je pense que j’étais hyper à fleur de peau, j’étais très fatiguée, stressée, en plein SPM, donc ça n’aidait pas. Mais il y a plein de fois où Sonia… On était toutes les trois dans…à l’ICI, et en fait elle me présentait des œuvres, et je ne saurais pas expliquer pourquoi, ce qui est un peu problématique quand on doit esquisser une critique mais… Je suis désolée pour ça. Elle me touchait dans des endroits d’intimité. J’ai vraiment du mal à mettre le doigt dessus quoi. Mais je devais tourner ma tête pour pas que Sonia voit que j’étais en train de pleurer. J’étais vraiment… Elle m’a bouleversée. Et alors même que j’avoue que les expositions qui tentent de tisser des liens entre l’art et l’artisanat, entre la nature et la culture, ou pire encore, la tradition et la modernité, c’est carrément devenu un mème. C’est un lieu commun et c’est un mème pour critique d’art fainéant.e. Donc ça déjà premier a priori potentiellement où là on aurait pu avoir une expo vraiment, vraiment un peu chiante quoi et ce qui est loin d’être le cas. Et aussi deuxième chose où je me disais… Moi je connais le travail de Sonia Recasens parce qu’elle avait présenté le travail de Florence Jung d’ailleurs qui a actuellement une exposition à la Fondation Ricard et elle avait présenté son travail au Prix AICA 2019. Et j’avais juste adoré la présentation de Sonia et surtout j’avais été énormément touchée par son discours à la fin où elle remerciait aussi sa mère, qui est pas du tout une personne qui travaille dans la culture, de lui avoir malgré tout donné la possibilité d’en arriver là où elle en est aujourd’hui. Voilà. Mais j’aime son travail de critique d’art en fait, et parfois les critiques d’art font de très mauvaises expositions. Donc je me disais peut-être que finalement cette exposition elle aura… elle serait très bien dans un livre, mais elle ne mériterait pas de se déployer sur des cimaises, et là en l’occurrence ce n’est pas du tout le cas. Je trouve qu’il y a un travail ultra sensible, d’œuvres qui se répondent entre elles, il y a des dialogues vraiment, mais qui sont très bien sentis. En fait, le travail curatorial de Sonia Recasens, il se fait à partir de pressentiments, j’ai l’impression. Elle nous disait, par exemple, qu’elle avait du mal à dire concrètement à l’ICI à quoi allait ressembler cette exposition. Elle disait : « Mais en fait, les choses vont se faire aussi pendant l’accrochage. Faites-moi confiance. Il y a des choses qui vont se dessiner de manière spontanée. » Et en fait, je crois que c’est ça aussi qui se passe quand on visite cette exposition… et que j’ai autant de mal à poser aussi des mots dessus… C’est qu’il y a certaines choses qui sont vraiment de l’ordre du sensible. C’est même pas nécessaire d’entourer tout ça de grands discours, ça vient juste nous toucher à des endroits vraiment, encore une fois, intimes. Et c’est simplement très poétique, très… Je sais pas, j’ai parlé de cette exposition une fois après l’avoir visitée, j’en ai parlé à tout le monde, sans être en capacité ni de la résumer, ni d’esquisser une critique positive comme négative, j’étais juste… « Allez la voir, c’est trop beau, j’ai fait que pleurer en fait ». [elle rit] Donc voilà, encore une fois je suis un peu troublée là parce que… C’est un peu embêtant. Grégoire.
Grégoire Prangé
Oui, alors c’est marrant parce que moi pour le coup j’ai eu une expérience de visite très différente de toi Camille puisque en fait je me suis très peu renseigné sur l’exposition avant d’y aller. J’avais juste regardé la liste des artistes, certain.e.s je connaissais et j’étais déjà assez convaincu par leur travail. Donc j’avais plutôt un bon a priori en y allant. Je ne m’étais pas du tout arrêté sur cette question de art et artisanat.
Camille Bardin
Ouais.
Grégoire Prangé
Et en fait, j’ai eu envie pendant l’exposition, c’était un dimanche midi, exposition très douce, je trouve, dans la manière dont je l’ai appréhendée. Et en fait, j’avais envie de picorer par-ci par-là. Et je me suis un petit peu forgé ma propre appréciation de cette narration. Et en fait, ce que j’ai trouvé extrêmement beau dans ce projet, c’est que vraiment on ressent, à travers les œuvres présentées, comment en fait les mythes, les traditions et les gestes qui en découlent, sont en fait des matières constamment en mouvement, qui amènent non seulement des formes qui nous sont présentées, mais qui également sculptent les corps. Et je trouve que le corps est vraiment omniprésent dans ce projet, et que ces corps et ces formes sont des constantes hybridités. Et donc on ressent vraiment… Et c’est vrai que c’est pas forcément naturel quand on parle d’artisanat. En fait, on sent cette circulation vraiment absolument constante qui est placée au cœur du projet. Et du coup, ce qui est assez marrant, c’est que je trouve que quand on parle de tradition, quand on parle d’artisanat, on a tendance, malheureusement, dans notre monde contemporain, à mystifier ces termes. Et en fait, c’est comme si c’était une forme de… En fait, la tradition, l’artisanat c’est devenu le passé figé dans le présent. Mais c’est une aberration vraiment totale. Et on voit que cette aberration, en fait, conduit aussi, malheureusement, à des expériences très douloureuses aujourd’hui. Or là, en fait, on nous parle de traditions qui sont liées à des migrations, qui sont liées à des échanges, à des rencontres, à des corps qui sont mis en présence, que ces corps ensuite vont fonder des gestes sur ces traditions, que ces gestes vont conduire à des formes, que ces formes, là encore, vont modeler des corps. Et cette circulation, ce mot est revenu beaucoup trop souvent dans ma prise de parole, mais c’était vraiment ça et j’ai trouvé ça extrêmement bien fait, d’autant plus que c’est pas asséné de manière, on va dire, au marteau-piqueur. Juste ça découle, je trouve, assez naturellement de ce qu’on voit.
Camille Bardin
Ouais. Samy ?
Samy Lagrange
Oui, je suis assez d’accord avec toi Grégoire, je pense que ce qu’il y a de plus intéressant dans cette exposition, c’est justement de voir la transmission par ce prisme du syncrétisme et de l’hybridation. Ce qui n’est pas si simple à penser que ça, parce que c’est quand même… Toi tu disais que c’est une aberration, mais ça peut quand même être un contresens, parce que la transmission, il faut quand même… pour transmettre, il faut quand même répéter. Et c’est pour ça que souvent on le voit sous… sous l’angle de quelque chose de conservateur et d’une pureté à garder. Donc du coup, cette tension qu’il y a entre la transmission de quelque chose qui est garant d’un savoir-faire et pourtant de l’hybridé parce que son origine est d’abord le syncrétisme. Enfin, c’est quand même assez passionnant et je trouve que ça le fait très bien. Je trouvais que c’était très… très marrant, non, on ne va pas abuser [Camille rit], de remarquer qu’on a eu des expériences très différentes sur cette exposition, qu’on a pourtant aimée toustes les quatre : plus sensible, plus théorique, de l’ordre de la déambulation agréable. Moi je suis plutôt de ton côté aussi Grégoire. J’ai trouvé que c’était une exposition très agréable, que j’ai trouvé, comme je le disais en introduction, simple dans le meilleur sens du terme. Ça vient de petites choses que vous avez déjà esquissées Grégoire et Mathilde, notamment par le discours qu’il y a dans l’exposition qui est pas du tout assommant, qui est même très léger. Et effectivement, je suis totalement d’accord avec toi sur ce qui remplace les textes de salle, qui sont des textes à la fois accessibles aux enfants, mais qui remplacent le texte de salle pour tout le monde et qui nous force à… qui nous donne la vision de la curatrice sur ce qu’elle voulait dire dans cet assemblage d’œuvres dans une salle, tout en nous forçant à regarder de manière très pédagogique les œuvres. Je trouvais que ça marchait trop bien et que c’était très léger et top. Je voulais juste peut-être revenir sur ce « je », moi aussi qui m’a beaucoup touché. J’ai aussi beaucoup de mal à clairement exprimer pourquoi, mais j’ai trouvé la position de Sonia Recasens très juste, très équilibrée et très agréable en utilisant ce « je ». Donc effectivement, dès le début, elle utilise le « je », elle explique quel est son intérêt, sa volonté à développer ce propos. Dans le petit catalogue du coup qui est gratuit, qui accompagne l’exposition, qui s’appelle « Un journal », elle revient précisément sur ses souvenirs d’enfance, sur ses propres expériences, sur ses questionnements personnels, elle remercie personnellement les artistes de lui avoir fait confiance et d’avoir accepté son invitation. À la fin, elle nous souhaite une bonne visite à nous, visiteureuses. C’est tout bête, mais j’ai trouvé ça très honnête dans le sens où elle assume véritablement son axe curatorial qui vient d’une expérience subjective et intime. Et pourtant, il n’est jamais question d’elle dans l’exposition.
Camille Bardin
Ouais.
Samy Lagrange
Sa voix est présente dans l’exposition dès le début, sans que nulle part elle vampirise l’espace par son statut de curatrice. C’est pas une exposition de Sonia Recasens, avec un concept qu’elle aurait inventé et qu’on réduit à elle. Alors probablement parce que les questionnements personnels qui président à cette exposition sont en vérité des questionnements partagés avec toustes les artistes à qui elle donne la parole. Mais en gros, j’ai trouvé ça tout bêtement très agréable. Je suis allé voir l’expo avec un artiste avec qui je travaille, Anatole Chartier. Et vraiment, on a passé une heure dans l’Institut. On s’est arrêté dans chaque salle pour discuter parce que ce qu’on voyait nous amenait à réfléchir sans nous assommer par un propos. Il y avait pas un gros texte de salle où en fait, on nous donnait déjà toutes les réponses et qu’en fait, on lit en diagonale parce qu’on s’est dit à peu près, en fait, on n’a pas envie d’en parler parce qu’on est déjà rempli d’informations. Là c’était pas le cas, et du coup on se sentait vraiment à chaque fois amenés à échanger, soit sur les formes qu’on voyait, soit sur le regard qu’on pose sur ce type d’image, soit sur les répétitions qu’on observait d’une salle à l’autre, soit sur les stratégies de monstration, etc. J’ai vraiment l’impression que l’expo a été faite, alors c’est vraiment un ressenti très personnel, mais comme un espace propice à l’échange et à l’apprentissage, presque, qui était vraiment, je me sentais invité à vraiment discuter de cette exposition parce qu’en fait… Je pense que tu le disais Camille, que présidait pour Sonia Recasens, toujours un sentiment un peu intuitif de ce qu’elle faisait en tant que curatrice. Et effectivement, il y avait plus genre : « Je sais ça, je pressens ça, j’ai envie d’en parler », c’était plutôt genre : « Voilà ma réflexion. Et où est-ce que toi, tu aboutis ? » Effectivement, je pense que j’avais envie d’avoir Sonia Recasens à la fin de cette exposition pour échanger avec elle, pour voir si on avait compris un peu la même chose et tout ça. Donc il y avait vraiment cet espace propice pour moi à l’échange et à l’apprentissage, j’y reviendrai peut-être dans un second temps, mais qui me faisait un peu penser à ce que devrait être un musée sans réussir à l’être toujours.
Camille Bardin
Grégoire ? Mathilde ? Mathilde.
Mathilde Leïchlé
J’avais envie de rebondir sur ce que tu disais Grégoire, sur la place des corps. Je pense que c’est vraiment ce que j’ai apprécié dans cette exposition. Déjà parce qu’il y a vraiment cette évolution entre le rez-de-chaussée et le premier niveau, où au rez-de-chaussée on est face à différents éléments d’architecture. Il y a la question d’un portail qui est retravaillé en tapis par Amina Agueznay. Et puis, dans les premières salles, un peu avant, il y a une structure qui est collée au mur de Salima Naji, qui s’appelle « Matbouaates, empreintes, ce qu’il reste ». Donc là, en fait, nos propres corps sont dans un espace architecturel qui est celui de l’ICI, mais qui est retravaillé par le geste des artistes. Il y a aussi une réflexion sur les éléments architecturaux que sont les muqarnas par l’artiste M’Barek Bouhchichi sur comment est-ce que… Il essaie de déconstruire un peu cet élément architectural pour montrer comment il est fait et comment on en hérite. Donc il y a ce premier espace au rez-de-chaussée dans lequel nos corps évoluent. Et à l’étage, le travail sur les vidéos notamment m’a beaucoup marquée, la manière dont elles sont mises en espace. Puisqu’on arrive en haut de l’escalier face à une vidéo de Selma et Sofiane Ouissi, qui sont deux chorégraphes et qui rendent hommage et… – la curatrice parle de matrimoine immatériel et c’est vraiment ça qui rejaillit partout dans l’exposition – donc qui rendent hommage aux gestes de potières. Là, on est face à l’écran. Un peu plus loin, il y a l’œuvre de Hoda Afshar sur un rituel pour exorciser des personnes qui auraient été traversées par un vent mauvais. Et en fait, on est encadré.e par trois grands écrans. Et en fait, on est au milieu de ce paysage traversé par les vents. On est nous-même au milieu de ce de ce rite-là, j’ai trouvé ça extrêmement puissant. Et puis dans la salle, avec les dessins de Nil Yalter, il y a un petit écran télé, une ancienne télé, avec des coussins posés tout autour. Et c’est en fait une vidéo de Mythia Kolesar-Dewasne qui a suivi Nil Yalter dans ses pérégrinations et qui… qui donc porte ce travail d’archive mais aussi de création. Et avec ces coussins, ça recrée ce qu’on voit à l’image et j’ai trouvé ça vraiment très intelligent comme manière de présenter ces vidéos à chaque fois en s’adaptant aux vidéos.
Camille Bardin
Grégoire ?
Grégoire Prangé
Oui je voulais juste… En fait, c’est assez marrant parce que moi, pour le coup, dans l’exposition, j’étais très content d’être tout seul, et je n’avais pas du tout envie d’en parler avec d’autres personnes. [iels rient] C’était aussi évidemment peut-être lié au fait que c’était un dimanche après un week-end intense. Mais je trouvais que chacune des œuvres nous invitait à une forme de déambulation assez intime dans une narration partagée, que j’avais envie de faire ce chemin en fait en moi et d’être vraiment au calme. Et alors j’ai plein d’exemples, j’ai été touché par beaucoup de choses, notamment par exemple le « Jardin oasien طرايد » de Mohamed Amine Hamouda, vraiment une forme de tapisserie en fait vraiment entre botanique et alchimie extrêmement intéressante, très très belle, très forte plastiquement, où on navigue comme ça entre des traditions de tissage et en même temps l’urgence écologique. J’ai trouvé ça extrêmement, extrêmement beau et je pense que je serais complètement passé à côté si j’avais pas été seul encore une fois. Ou encore la vidéo dont tu parlais Mathilde de Hoda Afshar, « Speak the Wind », sur ces mythes, là aussi syncrétiques, qui sont présents dans le détroit d’Ormuz, où comme ça on circule dans des paysages, il y a un moment avec des troupeaux de chèvres que j’ai trouvé génial. [iels rient] Et là aussi en fait, on plonge dans cette hybridité, dans ce corps qui est prostré avec ce… recouvert d’un voile en fait, et puis qui vraiment se balance comme ça, battu par les vents. Et… Je trouvais qu’il y avait un… En fait, il y avait une forme de… Moi, j’ai vécu une forme de silence dans cette exposition, mais un silence extrêmement… une sorte de brise, quelque chose de très doux, mais en même temps de très puissant. Et ça, c’était assez fort. Il n’y avait pas beaucoup de verbiage. C’était une exposition… Mais ça ne veut pas dire que ce n’est pas profond, bien sûr. Au contraire, bien au-delà de ça.
Camille Bardin
Samy, tu voulais ajouter quelque chose ?
Samy Lagrange
Oui, parce qu’au final, j’ai quand même quelques questions qui me sont venues quand j’ai vu cette exposition, qui sont vraiment plus de l’ordre des questions, encore une fois, que ça a soulevé en moi, plus que de reproches frontaux à l’exposition et qui auraient pu tout à fait faire partie d’une discussion avec la curatrice, si elle avait été là en vérité. Et en plus, c’est des questions assez naïves parce que j’ai probablement beaucoup d’angles morts sur ces questions de monstration des artisanats et de cultures qui ne sont pas les miennes. Je vais essayer de résumer, de ne pas aller trop loin, parce que notamment, ce que je n’ai pas dit en introduction, c’est que l’expo s’accompagne quand même d’une programmation assez riche pendant tout l’hiver, à laquelle on n’a pas assisté, et qui doit brasser un peu plus largement les questions que l’expo soulève. Et en plus, ça va être des questions qui vont sûrement contredire tous les trucs positifs que j’ai dit au début. Donc c’est moi-même qui me contredis, mais on n’est plus à une incohérence près dans PQSD. [Camille rit] Ce que j’ai noté, je le donne vraiment à l’emporte-pièce comme ça, je me suis interrogé sur la génération des artistes, et effectivement j’ai été un peu surpris, mais alors vraiment de manière neutre. Il me semble que la plus jeune artiste a 36 ans, donc du coup c’est déjà marqué. Il y a des artistes historiques, il y a des artistes qui sont aujourd’hui décédé.e.s, qui appartiennent vraiment au XXe siècle, il y a des artistes plus contemporain.e.s, mais c’est vrai qu’ils sont toustes d’une génération du coup, de celle au-dessus de la curatrice. Voilà, je l’ai juste marqué comme ça. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais Mathilde sur la monstration et la scénographie, moi c’est peut-être là où j’ai le plus de réticences ou en tout cas de questions. J’ai eu l’impression qu’une part du propos de l’exposition c’était donc de valoriser les savoir-faire en tant qu’art, en les montrant, en les dévoilant sous une forme alternative. Et dans ce sens, j’aurais peut-être aimé que l’exposition donne une part plus importante à des inventions artistiques ou à des stratégies scénographiques plus ambitieuses, plus décalées, notamment puisque tout un axe du projet porte, comme on l’a dit, sur la transmission comme syncrétise, comme hybridation, comme réinvention permanente. Mais c’est peut-être aussi complètement à côté de la plaque de penser comme ça et que ça implique juste de remettre des dispositifs, des stratégies et des regards typiquement occidentaux dans quelque chose qui cherche justement à s’en affranchir et de penser une monstration tout autre. Mais, je pense qu’il y a des choses qui pouvaient appeler à une monstration… Hum… mes mots ne sont pas les bons, pas « ambitieuse », mais en tout cas peut-être plus « inventive ».
Camille Bardin
Oui.
Samy Lagrange
Moins frontale. De simplement parfois… j’ai un eu un peu l’impression, et ce que j’ai trouvé top en même temps, c’est pour ça que je me contredit… de montrer frontalement, littéralement, l’artisanat, le geste, la tradition. Et en fait, il y avait peu de filtre entre nous et ces techniques-là. Je me suis posé la question d’une exposition ou d’un musée ? Je ne sais pas.
Camille Bardin
Pour moi le fil c’était les artistes, mais… Grégoire ?
Grégoire Prangé
Non, je me suis fait les mêmes réflexions en bas, et j’ai été bien plus séduit par la manière dont les oeuvres étaient présentées en haut.
Camille Bardin
Ah ouais ?
Grégoire Prangé
En bas j’ai eu un peu peur, j’avoue. En bas j’ai fait les deux salles, mais je me suis dit [râle un peu sceptique]. L’accrochage, j’étais pas très convaincu. Et en fait, je me suis aussi dit que déjà les espaces du bas sont très difficiles et même ceux du haut, la circulation est quand même pas évidente et après je me suis aussi très rapidement demandé quel budget il y avait aussi. Parce que je trouve que c’est déjà une exposition qui est très généreuse et j’ai pas envie de présupposer des budgets faibles pour ce type de lieu mais je pense que ce ne serait pas aberrant de dire qu’il n’y a pas énormément d’argent.
Samy Lagrange
C’est toujours la même question quand on parle de scénographie.
Grégoire Prangé
Et donc j’ai trouvé qu’il y avait déjà une vraie générosité en termes de provenance des œuvres et de nombre d’artistes, etc. Et que c’était déjà sans doute un vrai tour de force. Même si sur des questions d’accrochage, parfois j’ai pu avoir des petits doutes comme toi.
Camille Bardin
C’est effectivement une des choses qui m’a plu, c’est le fait qu’il y ait énormément d’artistes. J’ai trouvé que Sonia Recasens était vraiment une digueuse. C’est qu’il y a effectivement des artistes qu’on connaît, type Sara Ouhaddou, etc. que j’étais très heureuse de recroiser dans cette exposition. Et puis derrière, t’as des artistes venu.e.s de France, du Maroc, d’Australie, d’Afghanistan, d’Ouzbékistan, de Slovaquie. C’est quand même hyper large et ça, j’ai trouvé ça vraiment très généreux, encore une fois, à cet endroit-là. Et je voulais absolument parler d’une artiste dans ce podcast parce que j’ai découvert son travail au Musée de l’histoire de l’immigration en 2021. Cette artiste, c’est Amina Agueznay et j’avais vu son boulot et c’est ce genre d’oeuvre, vous savez, qui vous suit. J’avais pas son nom, je me disais merde. En l’occurrence, au Musée de l’histoire de l’immigration, elle avait montré une œuvre qui s’appelle « Curriculum Vitae ». C’était dans l’exposition Ce qui nous lit et ce qui reste. C’est une artiste qui suit depuis une dizaine d’années des tisseuses au Maroc pour justement appréhender leurs gestes, etc. et toutes ces traditions qui vont autour. Et donc elle avait suivi des mâalmates qui sont des tisserandes de tapis qui travaillaient avec un vocabulaire formel qu’elles acquéraient au fur et à mesure du temps. Donc chaque tisserande avait un pan de tissu et en fait elle déclinait comme ça tout son vocabulaire de formes, toutes les formes qu’elle savait tisser. Et en fait, quand elle connaissait la signification de la forme, elle la tissait en noir. Et quand elle ne connaissait pas la signification de la forme, elle la tissait en blanc. Et donc, on avait des bouts de tissu qui étaient très très très très longs parce qu’on sentait que la… la tisserande était d’un certain âge et à l’inverse des hyper courts avec beaucoup de tâches blanches, etc. parce que la personne commençait seulement à travailler. Cette œuvre m’avait bouleversée. En l’occurence, là elle a travaillé cette fois-ci avec Zahra El Kaddouri, une maîtresse tisserande de la région du Tiflet, toujours au Maroc. Et alors là, en l’occurence, elle lui a demandé de décliner son motif de base qu’elle produit inlassablement. Elle lui a demandé de répéter ce motif, puis ensuite de le déconstruire avant de s’en émanciper tout à fait. Et en fait, ainsi, elle montre son agentivité tout simplement. Et cette œuvre-là, je l’ai trouvée hyper belle. Et en même temps, je sais pas, elle m’a fait… J’ai trop de mal à poser des mots sur cette exposition, c’est très perturbant. [elle rit gênée] Mais j’ai trouvé ça très beau et d’autant plus qu’elle reprend finalement un motif qui est celui du monochrome, finalement une forme qui est reprise inlassablement dans l’histoire de l’art par des hommes blancs, etc. Et là, en l’occurrence, on a cette tisserande qui vraiment déconstruit tout ce geste-là, le dissèque pour finalement s’en émanciper. Et j’ai trouvé ce boulot incroyablement beau. Mathilde ?
Mathilde Leïchlé
Oui, pour rebondir juste à ce que tu dis, Samy, et puis pour peut-être conclure et ouvrir.
Camille Bardin
Oui !
Mathilde Leïchlé
En fait, il y a une expérimentation qui m’a beaucoup plu en termes de scénographie et qui fait lien entre… Enfin, je trouve que ce qui aussi révèle le fil rouge de l’expo, qui est le lien entre architecture et tissage et textile en général, puisque la curatrice dit qu’elle s’appuie notamment sur les travaux d’un architecte allemand du XIXe siècle qui s’appelle Gottfried Semper… Semper [elle hésite sur la prononciation], je vais le dire comme ça, qui a eu l’hypothèse que en fait la polychromie en architecture vient des tentes des populations nomades et que le textile c’est l’art premier, que tout découle du textile. Et il y a une œuvre au premier étage de Samta Benyahia, qui s’inspire d’un motif de moucharabieh qu’elle trouve sur la robe de sa mère et qu’elle décline sur toutes les vitres de l’ICI. Et ça, du coup, on le découvre qu’au premier niveau, alors qu’on a déjà traversé ça dans l’espace. J’ai trouvé ça très fort et je trouve que ça montre aussi une volonté d’ancrage dans le lieu, mais plus généralement dans le quartier, le quartier de la Goutte d’Or, puisqu’il y a aussi l’œuvre de Maha Yammine, qui est une vidéo et des marionnettes avec, encore une fois, recouvertes de textiles. La vidéo s’appelle « Une Oie, un rossignol, une cigogne, une grue et un faucon » et ça raconte ces histoires de transmission et de parcours de vie par le rapport au textile. Et c’est des témoignages d’habitants/d’habitantes de la Goutte d’Or. La vidéo est tournée dans un parc du quartier a priori aussi, et donc j’ai trouvé ça très beau comme manière d’ouvrir sur l’extérieur et de s’ancrer dans le quartier.
Grégoire Prangé
Et on peut aussi dire qu’on a… juste avant de commencer à parler au micro, on s’était aussi dit qu’on avait toutes et tous été extrêmement bien reçu.e.s à l’ICI et que ça c’était vraiment très précieux également.
Camille Bardin
Oui, complètement, à noter. Merci à toustes les trois, merci à vous de nous avoir écouté.e.s, merci à Projets Média et à toute son équipe de nous accompagner sur les Pourvu Qu’iels Soient Douxces. On vous donne rendez-vous dans un mois mais d’ici là prenez soin de vous, on vous embrasse.
Mathilde Leïchlé
Merci.
Samy Lagrange
Merci Camille.
Grégoire Prangé
Merci.
Mathilde Leïchlé
Au revoir !