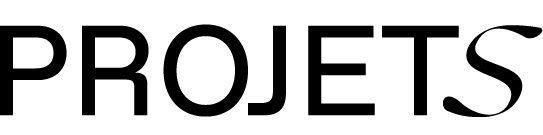Pourvu Qu’iels Soient Douxces – Saison 3 – Épisode 33
↘ PROJET𝘚
À Marseille, l’équipe des Jeunes Critiques d’Art s’est rendue à Triangle-Astérides pour l’exposition « Comme un printemps, je serai nombreuse ».
Jusqu’au 8 juin prochain, cette exposition collective réunit une dizaine d’artistes avec et autour de l’autrice Sonia Chiambretto. Les plasticien·nes explorent, à l’instar de l’autrice, les réalités des quartiers populaires et leurs jeunesses. À travers archives, témoignages et la répétition comme outil d’amplification, l’exposition interroge l’héritage des révoltes urbaines de 2005, déclenchées par la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois.
– Débat : Comment préserver nos espaces d’autocritique face à la montée de l’extrême droite ?
Extrait :
« La critique d’art est elle plus que jamais en prise et prise entre deux feux ? Dans un monde où les artistes et les institutions luttent pour leur survie et où le soutien institutionnel devient conditionné. Quelle place reste-t-il pour un débat véritablement libre et critique ? »
Avec Camille Bardin, Caroline Honorien, Meryam Benbachir, Adèle Anstett
« Comme un printemps, je serai nombreuse »
Jusqu’au 8 juin 2025 à Triangle-Astérides, Marseille
Exposition collective avec et autour de Sonia Chiambretto, avec Ouassila Arras, Agata Ingarden, Hannan Jones, Samir Laghouati-Rashwan, Luna Mahoux, Josèfa Ntjam, Fanny Souade Sow, Virgil Vernier
Retranscription :
Camille Bardin
Bonjour à toutes et à tous, on est ravi.e.s de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu Qu’iels Soient Douxces. Ce soir au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d’Art, un collectif d’auteurs et d’autrices libres et indépendant.e.s. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d’art comme un genre littéraire à part entière et pensons l’écriture comme un engagement politique. Pour Projets, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité, en partageant avec vous les échanges qu’on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu Qu’iels Soient Douxces, c’est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d’une problématique liée au monde de l’art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd’hui, je suis avec Caroline Honorien, bonjour Caroline.
Caroline Honorien
Bonjour Camille.
Camille Bardin
Meryam Benbachir
Meryam Benbachir
Hello.
Camille Bardin
Adèle Anstett.
Adèle Anstett
Bonjour.
Camille Bardin
Et moi-même, Camille Bardin. L’exposition dont on a choisi de parler ce mois-ci se tient au Centre d’art contemporain Triangle-Astérides à la Friche Belle de Mai à Marseille jusqu’au 8 juin prochain. C’est une exposition collective qui réunit une dizaine d’artistes par et autour de l’autrice Sonia Chiambretto, et dans laquelle il est question des violences policières, des révoltes urbaines qu’elles engendrent, de lenteur et de silence. Mais avant de parler de cette exposition, on a choisi de prendre le temps de discuter de ce qui se passe actuellement dans notre secteur, à l’heure où l’extrême droite est aux portes du pouvoir, si ce n’est déjà bien installée. À l’heure où l’on coupe les budgets de la culture, où le ministère dégage les gens qui sont en désaccord avec ses mesures, comment préserver nos espaces de réflexion ? Comment poursuivre notre autocritique ? Comment continuer à créer de la pensée ? Caroline je te laisse introduire notre débat, s’il te plaît.
Caroline Honorien
Merci. Alors c’est désormais un marronnier : celui de la mort annoncée et programmée de la critique d’art négative. Il en serait fini de cet espace public de discussion que la critique d’art et littéraire avait contribué à bâtir en Occident. Chacun.e y va de son Eden perdu de la parole critique, libre et indépendante (réelle, revendiquée ou fantasmée). Les philosophes évoquent les Salons des Lumières, les historien.ne.s de l’art, ceux de la peinture et de la sculpture. Les mêmes et quelques nostalgiques, souvent né.e.s trop tard, regrettent les décennies October et les millennials, qui, comme moi, ont un pied dans la tombe, se souviennent peut-être encore des beefs et des passes d’armes de Jonathan Jones, avec à peu près la totalité du monde de l’art dans The Guardian. La critique d’art serait morte, étouffée par l’avènement de la réclame, mise au service du marché et des industries créatives. D’aucuns affirment d’ailleurs qu’elle est en passe d’être assassinée par le wokisme, ce qui n’a pas manqué de raviver le débat, s’il en est, ces dernières années dans l’Hexagone ou outre-Atlantique. C’est donc un débat passionnant et maintes fois abordé qui refait régulièrement surface. Mais il nous a semblé aujourd’hui que la multiplication des coupes budgétaires et les tensions politiques qui ont mené à de véritables censures et sanctions reconfigurait la question. Nous nous souvenons toustes de l’affaire de la lettre ouverte D’Artforum qui a conduit au renvoi de David Velasco ou à l’annulation d’expositions des signataires. Dès lors, comment faire de la critique négative dans un contexte où l’art lui-même est menacé ? La critique d’art est-elle plus que jamais en prise et prise entre deux feux ? Dans un monde où les artistes et les institutions luttent pour leur survie et où le soutien institutionnel devient conditionné, quelle place reste-t-il pour un débat véritablement libre et critique ?
Camille Bardin
Qui veut commencer ?
Adèle Anstett
Bah du coup…
Camille Bardin
Adèle.
Adèle Anstett
… Je me lance. C’est vrai qu’on en a parlé entre nous au sein de Jeunes Critiques d’Art, et puis c’est des choses qui agitent des syndicats, les écoles… Enfin un peu partout, on se demande ce que la culture va devenir et dans ce grand Cosme, on se demande ce que la critique va devenir, ce que l’art contemporain va devenir. Et… Et en fait, je me… Je me posais la question aussi est-ce que la critique négative, ou en tout cas le fait d’émettre une critique à l’encontre d’une exposition, d’une pratique, est-ce que c’est toujours possible ? Parce que parfois c’est assez mal vu, on va dire « on tire dans les pattes » des gens qu’on est censé.e soutenir. Et du coup, comment est-ce qu’on continue à avoir des espaces de débat où critiquer, ça veut toujours dire encourager. Seulement, c’est aussi en rendant compte des faiblesses et des maladresses qu’on peut améliorer et enrichir les choses, et pas en restant dans une sorte de complaisance collective. Je pense que ça, ça peut continuer à exister. Et si tout devient, comment dire, plat ou lisse, ça serait très triste. Notamment à un moment où on a besoin de recomplexifier les choses et de rester critique.
Camille Bardin
Meryam ?
Meryam Benbachir
Je suis assez d’accord sur cette notion de critique constructive. Mais moi ce qui me pose beaucoup problème, c’est devant qui on le fait et… et à qui on s’adresse quand on le fait ? Et pour moi c’est une réelle question de… d’intra communautaire aussi en fait. C’est-à-dire que il y a des choses qu’on est censé… enfin qu’on doit questionner entre nous, dans un bureau comme on en parle souvent. On fait souvent référence avec Camille à ce sketch de Fary qui dit que il faudrait un bureau entre personnes racisées pour parler des choses et pour ne pas s’écharper devant… devant tout le monde.
Camille Bardin
Devant les adversaires quoi.
Meryam Benbachir
Oui, et donner des outils aux adversaires et à l’extrême droite. Et du coup, c’est souvent une question que je me pose quand je parle du travail de certain.e.s artistes ou d’une exposition de : face à qui je suis ? Qu’est-ce que je peux dire ? Parce que enfin, il y a quand même aussi cette notion de on est dans un espace de travail…
Camille Bardin
Tout à fait.
Meryam Benbachir
… dans un monde professionnel où, pour moi, en fait, il y a des questions éthiques qui rentrent en jeu dans l’utilisation de symboles par les arts visuels. Parce que du coup, moi j’ai une pratique plastique aussi. Donc, je m’inscris dans dans ce regard là en premier et pour moi, on est responsable des symboles qu’on utilise et des espaces dans lesquels ils sont montrés. Et du coup, ces symboles-là, enfin en tout cas ces questions éthiques qui rentrent en jeu, moi, elles me… elles me… elles me questionnent. Mais voilà, je ne peux pas les questionner face à n’importe qui parce que j’ai pas envie non plus de descendre des personnes qui sont minorisées tout simplement dans un espace qui est un espace professionnel de travail. Et du coup, c’est cet enjeu-là, je trouve, qui est compliqué à gérer complètement.
Camille Bardin
Caroline tu veux y aller ?
Caroline Honorien
Globalement, je suis absolument d’accord. D’ailleurs, on parle toujours des groupes en non-mixité choisie, mais en fait ça c’est des avatars de choses qui avaient été mises en place d’abord dans les Civil Rights, puis par les mouvements féministes dans les années 60 et 70 aux États-Unis, où effectivement l’intérêt de ces groupes-là était aussi de pouvoir avoir des discussions intra-communautaires et intra groupes politiques. Néanmoins, moi ce qui me me questionne et qui m’inquiète un petit peu, c’est que à partir du moment où on met systématiquement en place ça ou à partir du moment où, comme je l’entends souvent, des personnes qui peuvent être, même si je n’aime pas forcément ce mot d’allié.e.s, mais des allié.e.s politiques dans ce champ de l’art ont l’impression qu’iels ne sont pas légitimes pour émettre des critiques, à qui en fait on laisse l’espace pour émettre ces critiques ? Et donc, c’est pour ça que je parlais dans cette introduction, par exemple, des derniers débats qui avaient fait florès. Est-ce qu’on a vraiment envie de avoir ces articles ? Donc je pense à celui notamment de Dean Kissick donc, qui par ailleurs est un critique d’art tout à fait respectable, mais qui est aussi proche d’un mouvement en ce moment qui est en train d’éclore aux États-Unis, notamment à New York, donc le Times Square Group. Donc, qui est un groupe de personnes qui sont plutôt réactionnaires ou alors placées à l’extrême droite et qui sont en train de réinvestir le champ des arts. Donc, tout ce qu’il écrit et produit n’est pas… Et il n’en fait pas partie de manière ouverte. Mais est-ce qu’on a envie que ce soit toujours ces personnes-là qui produisent en fait des… des critiques à l’encontre d’art, qu’on a pu appeler Identity Politics Art à un moment. Nous avons eu notre propre petit scandale et passes d’armes l’an dernier, à l’occasion de l’exposition 100 %. Est-ce qu’on a envie que ce soit toujours des journalistes de Transfuge qui soulèvent certaines questions ? Par ailleurs, moi ce que je note, c’est que… Et j’ai l’impression aussi que c’est un petit peu là que les personnes placées dans ces… dans ces courants de droite, ces courants réactionnaires, ces courants d’extrême droite sont en train en fait de prendre quelque chose et de voler quelque chose. C’est que, en fait, il y a aussi beaucoup de questions qui sont soulevées que, en fait, parfois on se pose aussi. Simplement la question c’est pas de poser cette question-là, la question c’est en fait quel est le… par quel raisonnement on y arrive ? Et en fait, si nous, on ne peut pas réinvestir ces champs-là, donc c’est-à-dire… Effectivement, peut-être qu’effectivement, peut-être qu’il y a des endroits où je ne sais pas, moi, des artistes racisé.e.s se passent… se font placer par exemple toujours à un certain endroit par des institutions. Sauf que elleux, la manière dont iels le critiquent est une manière réactionnaire. En revanche, nous, ce qui va nous intéresser, et je te regarde Meryam, parce que tu en parles beaucoup, c’est la question de la tokenisation. C’est la question en fait de ne pas pouvoir justement dépasser un certain cadre autorisé. Et si on ne peut pas se… Si on ne peut pas en fait mettre ces sujets-là sur la table, je crois qu’on est en train de perdre quelque chose.
Camille Bardin
Complètement.
Meryam Benbachir
Je suis assez d’accord.
Camille Bardin
Oui, je te rejoins complètement. En fait, moi ce qui me fait peur avec ce qui se passe actuellement, c’est… J’ai l’impression que c’est un frein à la pensée, un frein vers la lutte, c’est-à-dire que cette peur qui… elle vient…. Enfin, cette peur du… de la perte d’espace, de prise de parole et d’espace de réflexion entre nous, j’ai l’impression qu’elle vient mettre à mal en fait, notre esprit critique, notre vigilance et notre exigence. Je me suis retrouvée il y a peu de temps dans la conférence de presse du Nouveau Printemps à Toulouse qui est curaté cette année par Kiddy Smile. Et déjà, en fait, je sentais à quel point tout ce qui se passe actuellement venait en fait presque éteindre mon cerveau à certains endroits et mettre à mal ma vigilance. C’est-à-dire que j’étais tellement… Je suis…. Je suis tellement apeurée en fait par le risque de silenciation de certaines personnes, la mise à mal de certains discours que j’étais déjà… J’arrivais simplement à me satisfaire du fait qu’un homme racisé et queer parle et je me disais : « C’est déjà tellement bien qu’il soit là et c’était tellement bien qu’on ait encore la possibilité d’entendre ces voix-là ». Et je me disais mais c’est terrible parce qu’il y a quelques mois, j’aurais été juste à étudier si la méthodologie de travail était carrée, si les sujets étaient vraiment intéressants. Enfin, j’aurais été beaucoup plus… ouais exigeante, encore une fois. Et là, je me satisfaisais de la simple présence en fait de corps mis en minorité et je trouve que c’est… Enfin, c’est délétère, vraiment à terme parce qu’on a besoin encore aujourd’hui de créer de la pensée. Et l’art contemporain était, et est encore j’espère, un espace où on a la possibilité d’aller un peu plus loin dans les réflexions, notamment sur les questions de genre, de racisme, etc. Et… Et aujourd’hui, c’est tellement… Ces sujets sont tellement mis en danger que finalement, le risque c’est qu’on soit, qu’on se satisfasse simplement du fait qu’ils persistent à exister quoi. Donc voilà, ça c’était le premier point. Ensuite, je me disais aussi, et c’est un truc qu’on vit pas mal au sein de Jeunes Critiques d’Art, et quand on fait ces épisodes de Pourvu Qu’iels Soient Douxces, c’est que souvent on va choisir en fait de traiter d’exposition qui nous intéresse en fait, et qu’on a par ailleurs envie de soutenir. Simplement bah le travail qu’on nous demande de faire ici et qu’on a envie de faire ici, c’est aussi de… de mettre le doigt sur les dysfonctionnements, sur des trucs qui n’iraient pas, sur des endroits où on aurait pu aller plus loin. Sauf qu’en fait, ces… ces expos dont on parle, elles sont aussi présentées aujourd’hui dans des lieux qui sont eux-mêmes mis en danger, qui sont… voilà dont on coupe les budgets, etc. Et donc moi, la crainte que j’ai aujourd’hui, c’est que finalement… c’est de faire un compte manquant, tout simplement. C’est de venir défoncer une expo, ou en tous cas, voilà enfin esquisser une critique négative d’une exposition dans un lieu mis en danger et qu’à terme ça vienne encore plus… enfin, « tirer sur l’ambulance » encore une fois. Enfin, c’est toujours… C’est un peu de ça dont on parle à chaque fois. Et donc voilà, je suis un peu… C’est un peu le constat que je fais pour le moment.
Meryam Benbachir
Oui, je voulais juste…
Camille Bardin
Meryam ?
Meryam Benbachir
Oui pardon. Juste rebondir sur le fait que tu dises que ces personnes-là existent dans ces espaces et en fait ce n’est pas une réelle existence, c’est juste une représentation et du symbole.
Camille Bardin
Par ailleurs oui.
Meryam Benbachir
Et le… Enfin, d’ailleurs je reviens sur ma définition du tokenisme. Mais en fait, la première fois que ce terme est apparu dans le cadre des luttes antiracistes, c’était dans un article de Martin Luther King et en français ça avait été traduit par symbolisme. Et du coup pour moi c’est vraiment pas anodin. Même si aujourd’hui on utilise cet anglicisme, ce n’est pas anodin que cette question de symbolisme… Enfin voilà, c’est les quotas, c’est… On le met en avant mais on met rien en avant, on met une image quoi. Et… Et c’est là toute la dangerosité de la chose. Et je trouve ça aussi très intéressant que tu aies utilisé l’expression « tirer sur l’ambulance » qui fait référence pour moi à l’expo dont on parle après aussi. Enfin, on y reviendra, mais avec notamment l’œuvre de Fanny Souade Sow.
Camille Bardin
C’est vrai, je n’y avais pas pensé. Adèle ?
Adèle Anstett
Je pense qu’on partage pas mal de peurs qui sont aussi alimentées par des attitudes qui appartiennent aux extrêmes droites. Mais il y a ce truc de… de passer par l’instantané et de refuser le temps long qui me fait un petit peu peur et qui a été super instrumentalisé par les extrêmes droites de s’appuyer que sur des faits divers, sur des punchlines, de retenir un morceau de la critique et d’en faire un espèce de slogan à charge. Et du coup, je me dis que si on arrive à continuer à prendre le temps et… et à arrêter d’être en speed x2, et ben c’est peut-être une des pistes pour continuer à avoir une critique construite et constructive et de remettre en valeur l’argumentation et le débat. Parce qu’effectivement, moi aussi j’ai très peur des discours simplifiés, des raccourcis qui font comme un espèce de gros gloubiboulga de magma où il y a plein d’ingérences qu’on n’arrive pas à saisir, qui vont s’emparer de ces extraits et les manipuler à charge. Alors que quand on essaye de prendre le temps d’expliquer les choses pour nous et pour les autres, on arrive là à spécifier les luttes, à les complexifier et à continuer à produire des savoirs qui nous aident à avancer dans nos propos.
Camille Bardin
Et surtout, je voulais rajouter un petit truc à ce que tu dis. Ce qu’il faut bien se dire ce que c’est une des stratégies effectivement de l’extrême droite qui est vachement employée ces derniers temps par Donald Trump. Mais finalement on se rend compte qu’ici en France, elle est présente aussi. C’est finalement de multiplier les fronts, c’est d’assommer ses adversaires avec un certain nombre de mesures, plus graves les unes que les autres. Et donc, on se retrouve un peu bras ballants, assommé.e en fait, face à tout ça, et on ne sait même plus par où commencer et par où, enfin par où prendre le truc quoi. Et donc, je pense qu’il faut vraiment se matérialiser ça aujourd’hui, c’est que, en fait, là, l’idée, c’est qu’on perd du terrain en fait. C’est que vraiment nos idées sont en train d’être vraiment balayées. Et donc, là je pense qu’il s’agit vraiment, finalement de tout faire pour les préserver et pour ne pas être simplement dans une posture de défense et qu’on continue en fait à encore une fois créer de la pensée et aller plus loin intellectuellement en fait, qu’on ne soit pas simplement satisfait.e de la présence de corps minorisés, etc. et qu’on continue en fait à créer quoi. Caroline ?
Caroline Honorien
Je reviens un petit peu en arrière, mais ça va, ça va me permettre de rebondir sur ce que vous disiez. Je pense… Effectivement, donc il y a cette question de pouvoir critiquer en fait ce qu’on a. Mais en fait, il y a eu aussi une autre question qui, à mon sens, vient lier en fait cette question d’économie, de présence de personnes minorisées et d’économie en fait de la critique. Tout à l’heure, Meryam, tu disais token qui a été traduit par symbolisme. Je pense que cette traduction en fait est finalement incomplète puisque dans token il y a déjà une question économique, il y a déjà une question de pièces. Et aujourd’hui… alors je crois que c’est dans Le Monde, il y avait un… enfin, aujourd’hui… il y a quelques temps, il y avait un article qui était paru sur… alors là, c’était sur le spectacle vivant et c’était sur le fait qu’il y avait eu des études, enfin des sondages auprès des publics, sur les… les thèmes qu’il voulait voir ou ne pas voir dans les institutions. Et en fait globalement tout ce qui touchait en fait à des minorités : l’immigration, les questions lgbtqia+, etc. étaient refusés. En fait, il y a quelque chose où… Peut-être que pendant une partie des années 2010, on a pu tokeniser parce que ça avait vraiment, ça avait vraiment une… Ça permettait en fait d’avoir une valeur… Ça permet de valoriser quelque chose et écono… enfin, et symboliquement et économiquement. Et en fait, là, dans ce moment où les budgets refluent, cette puissance économique là est aussi en train de refluer. Or, en fait, nous, le problème de la critique, c’est aussi cette question de… de valorisation. En fait, j’ai l’impression que tout ça est extrêmement lié. Et en fait, pour moi, la question, elle va même au-delà des quelques expositions ou quelques spectacles ou quelques performances auxquelles on va pouvoir assister ou non dans les années à venir, c’est qu’il y a réellement cette question-là qui se met en travers même des productions qu’on va pouvoir voir. Et aussi, moi, il y a quelque chose qui, toujours dans cette question-là, parce qu’il y a toujours ce débat : la critique est-elle du marketing ou pas ? C’est toujours lié à cette question économique. Quand même, il y a quelque chose qui me surprend pour nous, l’art autorisé, c’est qu’en fait, finalement la polémique et la critique négative, c’est quelque chose qui est à la limite recherchée, qui fait florès, qui fonctionne dans le reste des industries créatives, dans la musique, dans le cinéma. Et en fait, nous, non, on n’arrive pas en fait à… à avoir ça. Alors moi, ma question c’est finalement est-ce que c’est réel ? Est-ce que c’est une projection ? Est-ce qu’on s’interdit des choses qui en fait… Enfin, on s’imagine qu’on… Est-ce qu’on s’imaginerait pas en fait finalement que ce type de polémique serait « tirer contre l’ambulance », alors que peut-être qu’en fait ça crée quelque chose ? Là, je pense qu’il y a aussi quelque chose à interroger. Malheureusement, je pense que c’est aussi une question de quelles sont les études et travaux à notre disposition ? Là, j’avoue, mon ignorance, c’est peut-être qu’il y en a, mais peut-être qu’il n’y en a pas assez aussi.
Camille Bardin
Meryam ?
Meryam Benbachir
Oui, cette question du bad buzz. Bad buzz is still buzz. Pour moi, il y a aussi… Je pense que ça rejoint un peu cette idée que on ne parle pas d’argent dans l’art et en fait c’est pas le bad buzz, il y a quand même cette idée vraiment genre néo-libéraliste de « On va parler de toi. Visibilité is money« . Et en fait, je sais pas pourquoi je parle anglais mais bref, c’est le néolibéralisme qui me fait ça et… [elles rient] Et du coup, j’ai l’impression que ça vient aussi de cette fausse pudeur et de cette hypocrisie complète de… de pas réussir à parler de carrière, d’ambition, d’argent. Enfin voilà, on est toujours dans ce truc de : « Non non, on ne parle pas de tout ça parce que l’art c’est avant tout une passion ». En fait, on travaille et souvent gratuit. Mais en fait, on travaille quoi.
Camille Bardin
Ouais, complètement.
Meryam Benbachir
Mais du coup, je voulais aussi parler de… de la simplification des discours. En fait, pour moi, il y a un truc un peu dangereux, c’est que sous des fausses intentions, selon moi, de médiation et d’accessibilisation et d’accessibilité aux publics, on va simplifier les discours et on va nous demander, à nous, critiques et travailleureuses de l’art de simplifier nos discours, c’est-à-dire de ne pas utiliser certains termes. Et là, je parle notamment de vademecum. Je ne connaissais pas ce mot, mais c’est apparemment juste une fiche technique de comment… Enfin, de ce qu’on peut faire ou pas faire quand on écrit un texte pour une institution. Et donc, on a été confronté à ça il y a quelques mois, où on n’avait pas le droit d’utiliser des mots trop compliqués – entre parenthèses, capitalisme, anti-capitalisme, machin… – sur des textes très courts, à moins de les expliquer. Donc, ce qui en fait nous empêche de les utiliser, parce que passer trois lignes à parler juste d’un terme. Est-ce que c’est l’endroit ? Est-ce que… Et en fait, je commence à me dire que ça l’est, parce que si c’est le moyen de faire passer des choses. Et c’est surtout… enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, excusez moi de l’expression, mais en fait. Enfin, pour moi c’est vraiment… Enfin, je me demande sincèrement si c’est pas un moyen de censure en fait.
Caroline Honorien
Ouais alors en l’occurrence, pour ce… l’exemple dont tu parlais. Pour moi, je le… Comment dire… La sélection des mots était de toute évidence très intéressante et je la critique aussi. Néanmoins, dans un contexte de médiation pour moi, je pense qu’il y a quand même différents régimes de texte. Un texte de médiation n’est pas un texte… un texte académique. Néanmoins, je note aussi, tout comme toi, que globalement, personne ne demande à un ingénieur nucléaire de simplifier, tout le temps, ce qu’il raconte et que, en fait, tout serait une bouillie incompréhensible. Au contraire, les gens sont ravi.e.s. Enfin, je sais pas moi je parle à plein de gens, je sais pas, chez mon boulanger, dans mon taxi ou etc. qui sont trop contents d’écouter. Bon alors, ce sera un petit peu la mauvaise référence parce que Etienne Klein est un plagiaire comme nous le savons toustes. Mais voilà qui en fait… Les gens sont curieux.ses quoi. Iels sont contents. Mais effectivement, dès qu’on en touche à un certain nombre de sujets dits « progressistes », alors là tout devient inaudible. Et ça, effectivement, c’est effectivement un moyen de censure. Ça je suis totalement d’accord.
Meryam Benbachir
Parce que pour moi ça fait aussi écho à la quasi interdiction qu’on a failli avoir en France des études décoloniales au sein de l’université en fait.
Camille Bardin
Complètement.
Meryam Benbachir
Et du coup, de ne pas pouvoir utiliser ces termes-là, c’est aussi les invisibiliser encore plus.
Camille Bardin
Et encore une fois, nous retirer la possibilité-même de réfléchir à ce propos-là et d’avancer. Et en fait, là, dans ce que tu dis, Meryam, il y a un truc aussi, c’est que je pense que les personnes qui nous ont commandé ces textes-là étaient pour. Ce sont des personnes de notre bord politique et iels sont pour en fait, enfin lutter contre tout ça, etc. Le problème aussi, c’est qu’aujourd’hui les institutions en fait se bagarre pour préserver un maximum leurs budgets et donc se tiennent à carreau, parce que au-dessus tu as les régions, au-dessus tu as le ministère, au-dessus tu as… enfin qu’importe. Et que si elles emploient certains termes, elles savent qu’elles vont se faire bousiller derrière. Et je pense que ça, c’est hyper important que toutes et tous, on en ait conscience, notamment pour penser nos stratégies de lutte à partir de ça. J’avais un exemple en tête où, il y a quelques mois, il y a des artistes qui avaient écrit une tribune contre un lieu dans Paris pour la manière dont ce lieu-là fonctionnait, etc. que ce n’était pas OK, voilà. Et en l’occurrence, moi j’avais partagé la tribune en me disant que… enfin voilà, je soutenais ces artistes-là en l’occurrence. Et effectivement, leur… leur modalité d’existence et d’exposition dans ce lieu là n’était pas OK. Et quand j’en ai parlé avec la personne qui gérait ce lieu, la personne en elle-même, elle était d’accord avec les artistes et elle se battait en interne depuis des mois avec ses n+1 pour faire en sorte que ces ces conditions-là d’exposition changent. Et donc je lui ai dit : « Ah mais du coup, trop bénef la Tribune, ça montre que les gens vont dans ton sens et que tu es soutenu finalement par les personnes avec qui tu bosses ». Et il me disait : « Mais pas du tout en fait, ça a mis à mal deux ans de boulot, de négociations, de machins ». Et en fait les gens se sont dit, et trouvent en cette tribune un très bon argument pour dire : « Ah mais si personne n’est content, bah en fait on arrête tout en fait ». Et c’est ça aussi, je pense qu’il faut qu’on ait en tête aujourd’hui, c’est comment réussir à faire avancer le schmilblick sans en fait à nouveau faire un contre son camp en fait, et nous retirer nos espaces de paroles, de prises de positions, etc. Et je pense que tout le danger est là aujourd’hui et c’est pour ça qu’il faut à mon avis, on parlait d’allié.e.s tout à l’heure, mais je pense qu’il y a aussi un travail à faire et une prise de conscience. Et il est nécessaire, je pense aujourd’hui, qu’il y ait une transparence entre les artistes exposant.e.s, les personnes qui travaillent pour les expositions et les personnes qui travaillent pour les institutions, qu’il y ait un vrai échange en fait, et qu’on arrive à comprendre qu’on est de la même équipe, qu’on fait partie de la même équipe et que notre objectif à terme, c’est qu’on préserve ces espaces, etc. Et donc qu’on se donne les informations. Je pense que c’est vraiment hyper important là-dessus, pour qu’on avance ensemble et qu’on mette des stratégies de lutte en place à partir de ça. Adèle ?
Adèle Anstett
Et je voulais aussi revenir sur les questions économiques et comment on continue à… enfin, pour qui on écrit, par qui on est payé.e ? Et du coup, qu’est-ce qu’on est capable d’écrire quand on est payé.e par X et que X ne veut pas mettre « capitalisme » par exemple ? Mais… Mais je me souviens que c’était assez tôt quand j’étais en école d’art où j’étais en train de lire un journal où il y avait un encart d’un critique d’art. Et en fait, il y a un prof qui est passé à côté. Et donc je disais : « Ah mais vachement intéressant et tout ». Et en fait, lui, il me disait… Bon alors c’était son point de vue, mais ça a fait un peu écho à ce dont on est en train de parler. Il disait que, à partir du moment où il y a ton article de critique et sur la page d’en face, une publicité pour un produit de luxe, en fait, tu es dans un endroit assez bizarre où en fait quelles sont les conditions d’écriture de ces produits-là ? Qu’est-ce qui a été auto-censuré plus que censuré par les éditos ? Parce que maintenant on intègre aussi des choses où on se dit : « Je ne vais peut-être pas aller là, parce que effectivement, comme tu le disais Caroline, il y a des choses qui ne vont pas vendre ou qu’on ne va pas m’acheter ». Et du coup, comment est ce qu’on réussit à avoir des espaces qui sont peut-être plus indépendants, comme ici, pour continuer à dire un peu… un peu ce qu’on veut ? Et je trouvais aussi intéressant cette idée de transparence de chaîne de l’information, parce que ces espaces-là, et puis même voilà, jusqu’au jusqu’au public en fait, de rendre tout ça plus transparent pour que les gens comprennent : « Ah bah ouais, mais en fait, l’exposition, elle s’est pas faite en un jour. Il n’y a pas juste l’artiste avec son tableau. Et puis en fait iel est payé.e comme ça. Et en fait le texte est écrit par X. C’est fou, il y a quand même plein de gens qui bossent. » Donc, que les gens se rendent compte que la culture, c’est pas que de l’argent jeté par les fenêtres, c’est de l’argent injecté dans des salaires qui font… qui payent leur TVA et qui font fonctionner la grosse machine et qui payent leurs impôts aussi. URSSAF limousin si tu nous entends ! Et du coup d’avoir un peu… Enfin, de rendre compte de toute cette chaîne. Et ça permet d’être critique parce que on reste dans un milieu professionnel, on s’identifie, on a compris à qui on s’adressait et de qui on parle et ça permet de pas avoir du coup des espaces où il y a des informations qui manquent et du coup on parle mal de l’autre, mais en fait tu savais pas mais c’est pas sa faute. Et ça revient dans ma tête à ce truc du… de prendre le temps parfois d’arrêter de réagir trop à chaud. Parce qu’en fait, si t’as pas posé la question, tu sais pas tous les tenants et les aboutissants. Et tant que tu les sais pas, si t’ouvres ta gueule trop vite, ça risque d’être récupéré ou de te glisser entre les mains et du coup de partir dans des espaces où tu peux plus récupérer ta parole en fait. Et ça, ça c’est dangereux aussi.
Camille Bardin
Caroline ?
Caroline Honorien
Non mais moi je voulais juste rappeler que bon… Aujourd’hui, la presse est en train de mourir comme la critique d’art qui est négative. [elles rient] Mais je dirais même… Enfin c’est même… Je pense qu’il y a eu un moment, notamment dans les années 90 je pense, c’était plus qu’avoir une critique d’art, un article critique et une pub de produits de luxe à côté, c’était qu’en fait les titres de presse spécialisée ou non, puisque d’ailleurs dans la presse généraliste, Le Monde ou Libération avaient aussi ses petits guides à part, enfin ses petits suppléments. En fait, c’était ces instances-là qui faisaient des goodies aussi dans les musées. Et ça aussi, c’est un truc qui a participé à l’aplanissement et à la neutralisation de la critique. Donc effectivement, comme tu le dis, je crois que la question de la chaîne et de l’entremêlement, cette question qu’on dit toujours qu’en fait maintenant on est toustes des acteurices du marché, il faut que ce soit beaucoup plus transparent pour que le public, effectivement, puisse comprendre les tenants et les aboutissants.
Camille Bardin
Meryam ?
Meryam Benbachir
Oui, et sur… Moi, je reviens sur le fait que tu as dit Camille tout à l’heure, on va perdre nos endroits de parole. En fait, si c’est ces gens-là de base qui donnent l’argent et qu’il fallait déjà faire attention et qu’on n’a pas fait attention, du coup on s’est fait… niquer, pardon. Bah est-ce que c’était vraiment des endroits de parole ? Et dans ces cas-là, bah désolée, mais c’est vraiment genre hyper triste et pessimiste, mais est-ce qu’on a déjà eu des endroits de parole réellement ? Et face à des gens qui disent tout le temps : « On peut plus rien dire. » En fait, qui est-ce qui n’a jamais pu dire quelque chose en fait ?
Camille Bardin
Ah bah ça je crois qu’on l’a répété des dizaines de fois. Je te rejoins absolument. Adèle ?
Adèle Anstett
Je voulais aussi parler du fait que, en lien avec la chaîne, c’est de promouvoir des espaces de fraternité mais sans forcément de copinage pour… Parce que le copinage, quand il y a trop d’enjeux intimes, ça exclut des personnes et ça crée une concurrence, une mise en concurrence, des espaces de compétition et de rivalité et un élitisme. Et du coup, je pense qu’il faut échapper à ça et en restant critique. C’est pas « Je t’aime pas », c’est « Ton travail ne m’a pas plu ».
Camille Bardin
Trop bien Adèle, je suis trop contente que tu parles de ça parce que j’avais aussi un dernier point en tête. Là récemment, il y a Samuel Belfond qui a qui a publié un article sur Artagon pour… pour voilà, poser des questions finalement sur encore une fois les méthodologies de travail, etc. Pour tout vous dire, cher.ère.s auditeurices, nous on a lu cet article-là, mais il n’est pas encore paru à l’heure où on enregistre, donc on ne sait pas en fait quels sont ou quels ont été les retours, quelles ont été les réactions des personnes concernées. Mais toujours est-il que c’était déjà un truc qu’on avait abordé lors de l’épisode qu’on avait fait sur la Triennale de Nîmes où j’avais fait un gros disclaimer en expliquant tous les liens aussi que Jeunes Critiques d’Art a avec l’association Artagon et Anna Labouze et Keimis Henni qui en sont les les co-fondateurices ? Et en expliquant que malgré ces liens-là, où on a effectivement un partenariat à l’année avec elleux, moi à titre personnel, je travaille aussi, je produis aussi des podcasts pour elleux, etc. Mais en fait, pour moi c’est un signe aussi de la bonne santé de notre secteur que de réussir en fait à esquisser des critiques vis-à-vis des personnes qu’on côtoie et qui par ailleurs… que par ailleurs on peut apprécier. Pour moi, c’est essentiel en fait qu’on sorte justement de ce truc de copinage-là où genre : « C’est génial ton expo, elle est super et j’adore ton boulot » etc. C’est ultra important qu’on réussisse à se dire… Enfin, moi je suis hyper en attente aussi que parfois on me chope par le colbac et on me dise : « Camille, là ton podcast est pas ok, ta programmation c’est pas cool, nanana » ou « Ta méthodo ou ta… » mais même « Ta manière de répondre à ce mail-là, elle est pas correcte tu vois ». Enfin, je pense que c’est hyper important qu’on soit aussi des garde-fous entre nous quoi. Et encore une fois, la critique, elle est preuve de bonne santé de notre secteur et je pense qu’il ne faut pas qu’on s’en offusque aussi entre nous quoi. Ceci étant dit, je vous propose qu’on passe à la deuxième partie de cet épisode sur l’exposition Comme un printemps, je serai nombreuses. Meryam, je te laisse nous l’introduire ? C’est parti ! Let’s go !
Meryam Benbachir
Comme un printemps, je serai nombreuse. Cette exposition ouverte du 8 février au 8 juin 2025 dans le panorama de la Friche Belle de Mai, a été construite par Victorine Grataloup et Camille Ramanana Rahary assistées par Léo Ferreiro et Clara Juan et s’articule autour d' »Oasis Love », la dernière pièce de l’écrivaine Sonia Chiambretto, présentée au Festival d’Automne en 2023. Sur le site du Festival d’Automne, il est écrit : « Comme si faire parole était déjà faire émeute ». Pour l’autrice et metteuse en scène Sonia Chiambretto, le moteur poétique de sa pièce « Oasis Love » se trouve dans le sens de ce mot « émeute », littéralement « créer de l’émotion ». Cette œuvre est née d’une longue recherche sur nos rapports ambigus à l’autorité ». De cette pièce, nous retrouvons une partie du décor qui nous accueille dans un espace entre poésie documentaire et mise en scène du réel. Une dalle de béton et une bouche d’aération fumante venant mimer le toit d’un bâtiment urbain. Faisons un rapide tour de l’exposition. Donc, une fois face à ce toit, sur notre droite se trouve Let your thug cry, une installation de Samir Laghouati-Rashwan jouant avec des ours en peluche et une vidéo où il se met en scène avec un masque et au ralenti. Derrière la dalle en la contournant, c’est l’œuvre de Luna Mahu qui nous surplombe, Bienvenue en France ! Ici, on passe la vie à courir. C’est ce qui est inscrit sur cette image, une capture d’écran du clip de Mbiyo (« vite » en comorien) du rappeur RDJB et de son fils Rayad. Ensuite, c’est Virgil Vernier avec son œuvre Kindertotenlieder. Encore une fois, on me fait parler allemand dans un PQSD. [elle rit]
Camille Bardin
Désolée Meryam !
Meryam Benbachir
Une vidéo constituée à partir d’archives TF1 documentant les émeutes de 2005 suite à la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré. Nous avons ensuite la série de sculptures Les voisines de Ouassila Arras, The Side of Sound, une installation sonore de Hannan Jones, des sculptures de Agata Ingarden, Social Security et un magnifique, si je puis me permettre, tirage de Josefa Ntjam qui s’appelle Fire Next Time. Et enfin We’ll burn everything, une sculpture de Fanny Souade Sow reprenant la forme des chaises à palabre d’Afrique de l’Ouest. À quelques mois du vingtième anniversaire des révoltes urbaines de 2005, neuf ans après les assassinats d’Adama Traoré et Mehdi Faghdani dans le Val d’Oise, sept ans après l’assassinat d’Aboubacar Fofana à Nantes et deux ans après l’assassinat de Nahel à Nanterre, nous sommes invité.e.s dans cet espace d’archivage de récits d’une histoire qui ne cesse de se répéter et à travers des paroles qui ne cessent de se réinventer, d’éclorent de nouveau à chaque printemps. Personnellement, et malheureusement, comme beaucoup de personnes en France et ailleurs, j’ai depuis très jeune été marquée par ces questions et j’ai grandi avec. Ce qui me révolte souvent dans le traitement bien en surface la plupart du temps de la subalternité dans l’institution culturelle, qu’elles soient des questions de représentation des diasporas ou des études décoloniales, c’est justement l’omission des conditions d’existence actuelles et réelles des personnes concernées par ces mêmes questions. Donc je voudrais vous laisser là-dessus avec juste une affirmation et une question. Premièrement, une affirmation. Nous avons le droit à l’exigence et à la poésie. Et est-ce que, au prochain printemps, nous ferons la révolution ?
Camille Bardin
C’est bien que tu commences par ça Meryam parce que justement, en l’occurrence, je crois que la manière dont j’ai reçu cette exposition, elle illustre parfaitement le débat qu’on vient d’avoir. Je suis déjà tellement contente qu’un centre d’art d’intérêt national se saisisse des questions des violences policières, parle frontalement de la manière dont on matte les corps mis en minorité que je n’ai pas envie d’abîmer ça. J’ai envie de le chérir et de l’encourager. Ensuite, force est de constater qu’en tant que femme blanche qui s’est faite contrôler qu’une seule fois par la police, étonnamment, une fois où je me promenais avec un homme arabe, je me rends aussi compte de mes limites et de mes angles morts. En fait, à titre personnel, cette exposition, vraiment à titre personnel, elle m’a fait du bien et elle est venue panser certaines plaies et une frustration quant au fait qu’on est assez peu à aborder ces questions dans notre secteur, ou en tout cas pas assez, ou de manière trop sporadique, ou de manière pas assez frontale. Enfin donc voilà, ça c’était un peu mon premier point. Après, j’ai trouvé qu’il y avait des gestes qui étaient assez intéressants. On s’est vachement pris la tête du coup. Merde, j’ai même pas fait le petit disclaimer de début d’épisode, mais je le fais maintenant, j’en profite. On est parti en voyage de presse. En fait, Meryam, toi tu es basée à Marseille donc tu étais sur place. Mais effectivement, Caroline, Adèle et moi, nous nous sommes basées à Paris. Donc on est descendu en voyage de presse payé par la Friche Belle de Mai pour pour voir cette exposition. Et sachez aussi qu’on a été logées sur place une nuit, toujours par par la Friche. Voilà, cela étant dit, donc on a… On était toutes les quatre et il y avait aussi Alexia Abed qui est une autre membre de Jeunes Critiques d’Art qui était avec nous à Marseille. Et donc on a eu tous ces débats-là. Et donc notamment, un des premiers débats a été autour de cette dalle qui est centrale dans l’exposition et qui est donc un décor et non pas une œuvre. Enfin, on pourrait s’interroger là-dessus, mais qui est un décor. Le décor… Iels ont repris en fait un des décors de de cette pièce de théâtre et… Et en fait on se… On s’est vachement pris le chou là-dessus. On ne savait pas si c’était un truc un peu factice de simplement ramener en fait, rapporter ici, dans une salle d’exposition, finalement un… quelque chose de l’espace urbain qui existe vraiment et qui abrite vraiment des corps. Et en même temps, je trouvais ce geste assez intéressant parce que je l’ai trouvé efficient en fait. C’est-à-dire que assez vite, on s’en est saisi, c’est-à-dire que tout de suite on s’asseyait autour pendant la visite, enfin on s’asseyait dessus pendant la visite. Et puis une fois que les conversations ont commencé à avoir lieu – parce que ça aussi dans le disclaimer, j’aurais pu le dire – on a eu de longues conversations avec Victorine Grataloup, donc la directrice de Triangle-Astérides et avec Sonia Chiambretto. Et ces discussions, elles se sont faites sur cette dalle en fait, où on était, mais vraiment avachies sur cette dernière. [elle rit] Et je trouvais que le fait qu’on s’en saisisse tout de suite, je trouvais ça intéressant, sachant que pour ma part, je ne sais pas vous, mais moi, dans les salles d’exposition, les pouf, les machins, enfin… Jamais je vais me vautrer dessus quoi. Et là, en l’occurrence, je trouvais que mine de rien, même si j’avais un peu cette peur-là, que ce soit encore une fois factice et simplement mettre un décor qui… qui reste, voilà qui ne sert à rien. Et bah je le trouvais intéressant et j’ai l’impression qu’il y a eu des perfs après tout au long du week-end et j’avais l’impression que ce truc-là était assez agissant. Premier tour d’horizon mais je vous laisse, je vous laisse partir là où vous voulez. Adèle ?
Adèle Anstett
Alors… Je pense que… Et je crois que c’est un truc partagé. J’ai aimé le travail des artistes que je connaissais ou pas par ailleurs. En revanche, comme on est arrivées un peu avec la presse, puis c’était un moment presse de présentation. Le fait… En fait, malgré une sorte de visite guidée, j’ai eu un espèce de sentiment de mal à l’aise parce que j’arrivais pas et je crois que toujours pas. J’arrive pas à comprendre exactement ce qu’on essaye de me dire dans cette exposition. Je parle du propos curatorial, parce que je comprends les pièces, je comprends ce qu’elles disent, ce qu’elles portent, mais… Mais il y a un truc dans l’ensemble que j’arrive pas à préciser. Et même ce matin en relisant le CP, je… Il y a un truc un peu un peu confus entre… Parce qu’il y a cette phrase dans le CP qui dit : « quartiers populaires urbains et les problématiques spécifiques de leur jeunesse ». Et puis il y a le contexte hyper précis de 2005 à Clichy-sous-bois et de 2023 à Nanterre, Zyed Benna et Bouna Traoré et Nahel Merzouk qui sont des enfants qui sont morts suite à des contrôles et de la main directe de policiers. Donc en fait, il y avait à la fois un contexte hyper précis et à la fois des zones de flou dans le… dans le propos curatorial qui m’ont qui m’ont laissé un peu, un peu mal à l’aise de ça. Et c’est peut-être aussi parce que il y a des gens qui parlaient, enfin qui présentaient, que du coup ça m’a un petit peu perturbée. Et notamment tu… parlais de poésie et je trouve que c’est effectivement des espaces importants à investir. Mais ce terme de « émeute » et « émotion », moi ça m’a ça m’a beaucoup perturbée parce que…
Camille Bardin
Peut-être expliquer rapidement que Sonia Chiambretto sciemment, continue à employer le terme « émeute » qui est un terme qui est énormément remis en question, à juste titre je pense, de se dire qu’en fait, pourquoi en fait on viendrait dépolitiser finalement, ces révoltes-là, en employant ce terme. Et elle continue à l’employer parce que – vous m’arrêtez si je dis une bêtise – il vient d' »émotion » et du coup c’est ça, je ne dis pas de bêtise ?
Adèle Anstett
Exactement.
Camille Bardin
Il vient d' »émotion ». Et donc il faut, il faut continuer à l’employer.
Adèle Anstett
Voilà, c’est exactement ça. Donc j’ai regardé sur les sites sérieux de définition et donc effectivement, en vieux français, « émeute », « émotion », donc l' »émoi » aussi qui vient. Et en fait, je n’arrive pas à passer outre la rhétorique raison versus émotion qui justement place l’émeute comme une démonstration de l’impossibilité de celleux qui la font d’agir à partir de la pensée. Donc il y a un truc, il y a un truc négatif et je n’arrive pas à avoir la… la reprise, la réappropriation de ce terme. Je préfère quand iels disent « révolte » en fait c’est… Parce qu’il y a un truc hyper… hyper empouvoirant d’être en révolte, d’être contre quelque chose et… Et voilà. Et c’est un appel à la révolte. Voilà sur le vocabulaire.
Camille Bardin
Complètement. Meryam ?
Meryam Benbachir
Oui, parce que du coup, à préciser que le terme « émeute » n’est utilisé que dans le cadre de révoltes urbaines.
Camille Bardin
C’est ça.
Meryam Benbachir
De questions de personnes issues des diasporas, issues des banlieues ou dans les banlieues. On n’utilise jamais le terme « émeute » pour une manif…
Camille Bardin
De la manif de la CGT quoi.
Meryam Benbachir
Ou une manif pour la réforme des retraites.
Camille Bardin
Contre la réforme des retraites. On s’entend. Caroline ?
Caroline Honorien
Je reprécise quelque chose, je ne pourrais pas en dire grand chose puisque je n’ai malheureusement pas lu le livre. Mais en revanche, cette remobilisation du terme « émeute », elle le tire d’un auteur, Joshua Clover, qui lui, en l’occurrence, dans sa perspective marxiste, fait remonter une généalogie des émeutes depuis les années 60. Donc apparemment, lui semble plutôt justement répondre à ce questionnement que tu soulèves à propos de ces soulèvements Meryam. Mais bon voilà, on ne pourra pas en dire plus malheureusement autour de cette table.
Meryam Benbachir
Mais je pense qu’en tout cas c’est vraiment pensé par Sonia et que ce n’est pas un choix inconscient ou biaisé.
Camille Bardin
Complètement.
Meryam Benbachir
Enfin, c’est vraiment aussi un engagement poétique de sa part, parce qu’elle se situe à cet endroit là en fait. De elle, elle a recueilli, elle a travaillé beaucoup avec des personnes dans des quartiers dits « prioritaires » sur… Enfin voilà, elle a été à l’écoute de ces récits-là et elle, elle dit toujours : « Moi, ce que je peux apporter, c’est la mise en poésie de ces récits-là ». Enfin, c’est l’endroit où elle se situe.
Camille Bardin
Caroline ?
Caroline Honorien
Et ben moi je suis un petit peu… Enfin, je suis totalement d’accord avec toi Adèle, parce qu’on avait notamment parlé, enfin on en a toustes parlé, enfin toutes, pardon. Je crois que c’est notamment ce terme qui revient depuis tout à l’heure de « poésie », et plus précisément de « poétisation » qui m’a un petit peu… Ça m’a rendu un petit peu dubitative. Bon, tout à l’heure on parlait de token et de symbolisme. Malheureusement, poétisation ça a un sens qui veut dire justement « faire de quelque chose une image, un symbole ». On est déjà dans un espèce de white cube. D’ailleurs, Victorine Grataloup l’a… enfin l’a souligné. Elle a souligné les frictions et les problèmes que ça posait de déplacer un certain nombre de pratiques artistiques et qui sont des pratiques qui sont aussi ancrées dans des questions… qui sont aussi politisées dans cet espace-là. Et ça, je crois que ça m’a un petit peu déstabilisée. Bon alors, sans vouloir faire du name-dropping et des références théoriques, c’est vrai que par exemple, quelque chose comme la poethics/poéthique de Denise Ferreira Da Silva qui est une philosophe qui ancre sa pensée dans une pensée en fait noire et féministe. Moi, c’est quelque chose qui m’intéresse plus puisque justement c’est faire le lien entre la poésie et l’éthique. Et moi, en fait, j’ai l’impression que le geste des artistes relevait en fait de cette poéthique, alors qu’en fait, la personne qui curatait l’exposition ne faisait que parler de poétisation. Et bon, je ne veux pas dire que c’est quelque chose de volontaire, enfin que c’est quelque chose qui est forcément très conscientisé. Sonia nous a dit à plusieurs reprises qu’elle ne se considérait pas comme quelqu’un qui était une grande théoricienne. Elle nous a beaucoup redit cette chose : « Ah mince, je ne trouve pas les mots », mais en l’occurrence, c’est vrai que cette espèce de friction-là, moi, m’a posé problème. Et je pense qu’il y a plusieurs endroits dans la… dans l’exposition en fait, [où] ça se ressent. C’est peut-être là, en fait qu’on perd un petit peu du fil finalement de l’exposition. On n’avait que des œuvres très fortes, très intéressantes. Néanmoins, je… j’avais quand même le sentiment qu’il y avait un petit peu une redite finalement d’une œuvre à une autre, que ce soit dans les références à la musique du sud des États-Unis, les musiques du cloud rap, le chopped and screwed, des choses qui sont ralenties, des choses qui parlent justement de l’échappée, de l’échappée du capitalisme, du racisme de manière historique, que ce soit sur un petit peu les typologies d’images, sauf pour une œuvre. Donc là, je sais qu’on n’est pas toutes d’accord. Donc celle d’Agata Ingarden. Alors, je sais que quelques uns ont trouvé que… quelques unes, olala mais pourquoi j’arrête pas… On était que des femmes, on était que des femmes dans ce voyage. [elle rit] Quelques unes ont trouvé que c’était une œuvre qui, peut-être ne fitait pas avec l’exposition. En fait, moi je suis d’accord et pas d’accord, c’est-à-dire que, en fait, je trouve que c’était une œuvre qui au contraire permettait d’aborder ces questions de surveillance et de police et de profilage d’une autre manière. Et en fait, j’aurais aimé que la sélection d’œuvres d’autres… des autres artistes – puisqu’il y en a certain.e.s que je connais bien pour avoir écrit ou travaillé avec – puisse en fait, retranscrire un petit peu, voilà d’autres manière d’aborder la question de l’image, de l’opacité. Et j’ai l’impression que c’était un petit peu ce qui avait été raté dans l’exposition que par ailleurs j’ai appréciée. Donc voilà.
Camille Bardin
Ouais, je te rejoins Caroline, c’est vrai que il y a il y a certaines images qui m’ont questionnée et notamment je crois que c’est cette grande baie vitrée qui s’ouvre sur les quartiers nord de Marseille. Et pendant la visite, on n’arrêtait pas de se répéter qu’iels étaient avec nous. Et en même temps, il y a un truc qui me dérange dans tout ça. J’avais aussi l’impression de regarder une espèce de diorama depuis un white cube et en même temps Victorine Grataloup semblait complètement consciente du manque de diversité, aussi parmi les visiteureuses du lieu qu’elle dirige. Elle expliquait par exemple que si Triangle avait peu d’argent pour penser une programmation, qu’elle avait mis un point d’honneur à organiser des conférences, des lectures et des ateliers pour faire venir du coup d’autres publics qui sont dans le quartier même de la Friche Belle de Mai. C’est souvent ça le plus violent. Enfin, c’est que c’est… Enfin voilà, c’est des personnes qui sont là en plus. Et dans ce genre de cas, j’ai l’impression que ces expositions, elles sont frustrantes parce qu’elles mettent aussi au jour une certaine impuissance en fait de notre secteur qui passe uniquement justement par la poétisation de certaines problématiques. Et en même temps, tu vois Adèle, tu disais que tu n’avais pas compris en fait quel était le sujet de l’exposition. Et en même temps, c’est ça que j’ai trouvé intéressant à certains endroits, c’est que pour moi le sujet c’était aussi le « faire silence ». Et à certains endroits je le trouve intéressant parce que il y a… dans la question du silence, il y a évidemment la question du recueillement, mais aussi, et je crois que c’est ça qui m’intéresse le plus, c’est la question du mépris en fait, c’est le fait de… le refus de répondre notamment aux idées des fachos en fait. C’est qu’on est en permanence dans une posture à gauche qui est celle de la réaction en fait. Et en fait on s’offusque de ce qu’iels disent, mais évidemment. Enfin… En fait, moi j’ai même pas envie qu’on les regarde en fait, j’ai envie qu’on les… qu’on les balaie du revers de la main et qu’on ne s’en soucie même pas. Et quand on parlait tout à l’heure de préserver nos espaces de création de pensée, etc. Je pense que ça passe aussi par le silence. Faire silence et se… se débarrasser en fait du besoin de leur répondre. Et du coup, je trouvais que dans ce truc là de faire silence moi… Enfin voilà, j’ai vu ça dans cette exposition-là aussi. Le fait de ralentir, d’arrêter de courir quand on nous court après, etc. De se dire en fait non, je… Mon corps a le droit d’être là et je ne courrai pas et je ne fuirai pas. Et enfin voilà, il y avait tout ça aussi qui me… qui m’a touchée aussi dans ce truc-là de faire silence. Meryam ?
Meryam Benbachir
Et ce qui est intéressant donc, c’est qu’il y a toujours une double lecture sur la question du silence et sur la question de la lenteur. Notamment donc Fanny Souade Sow et Nesrine Salem qui ont fait une performance le lendemain du vernissage où Fanny marchait sur un tapis roulant à une allure réduite. Et il y a beaucoup cette question de la lenteur et de la marche et de la marche lente parce qu’un corps racisé qui court dans l’espace public se fait poursuivre et se fait poursuivre de façon violente et se fait souvent attraper et se fait souvent arrêter. Et voilà. Et il y a donc ce double enjeu sur la lenteur et sur le silence que j’ai trouvé hyper pertinent et très pesant. Mais enfin, d’une façon juste sincère quoi. Moi j’ai été assez touchée par cette exposition et par les travaux quand même présentés. Et j’ai vraiment apprécié le fait que Triangle se mouille pour le coup avec cette exposition.
Camille Bardin
Complètement.
Meryam Benbachir
Enfin je veux dire, vu le débat qu’on vient d’avoir justement, je voulais clarifier ce truc. C’est vraiment moi pour le coup, je trouve qu’il y a une réelle prise de… pas de risque parce que ça ne devrait pas être un risque et que c’est une institution… Enfin, c’est aussi là que c’est censé être, mais enfin…
Camille Bardin
Non mais complètement.
Meryam Benbachir
C’est pour moi important, nécessaire de le faire et de le faire bien. Et on a senti cette volonté, au moins en tout cas de vraiment être consciencieux.ses avec ces sujets-là. Et je trouve que le fait qu’il n’y ait pas de sujet, encore une fois, pour moi, ça répond aussi à une essentialisation des discours et des pratiques et des personnes qui en fait… Enfin, je sais pas, on part de… on repart de cette expo en se posant des questions et en… Je sais pas, j’ai l’impression qu’il n’y avait pas une lecture hyper dirigée des travaux et pour une fois, moi franchement, ça m’a soulagée parce que c’était pas : « Bon bah voilà, il y a des noirs et des arabes qui vont vous parler de la police ». En fait c’était pas ça, c’était… C’était…
Camille Bardin
Ouais. Et puis même dans ce truc-là, je trouvais ça intéressant. Il y a notamment donc Sonia Chiambretto qui reprenait en fait des ateliers qu’elle a faits du coup avec des jeunes avec lesquel.le.s elle bosse. Et il y avait ce truc là où sont mis à disposition sur la dalle de béton des petites… des petites feuilles avec un stylo à côté et des questions qu’elle posait du coup aux gens avec qui elle a bossé et qui nous étaient aussi adressé, nous, en tant que public. Il y a notamment cette question – si vous pouvez m’aider sur… [en s’adressant aux autres membres de JCA avant de reprendre] – « Serais-tu prêt.e à brûler une voiture ? » il me semble ?
Adèle Anstett
Oui.
Camille Bardin
Et en fait là, même là, on s’est toutes… On a toutes pris le stylo et on a toutes dit un truc à ce moment-là et… Et en fait, je trouvais ça aussi intéressant. Effectivement, quand tu dis que le… elle amène le public aussi à se poser des questions, c’est qu’en fait on est même nous même confronté.e… Enfin, souvent le problème dans les expositions, c’est que finalement on est des corps non agissants justement, simplement en posture de regardeureuse. C’est pour ça aussi que c’est intéressant le fait qu’il y ait très peu de corps dans cette exposition. Moi je suis aussi attachée, enfin je parle souvent des corps, et néanmoins je suis très attachée aux expositions qui ne montrent pas de corps. Parce que justement, ça… c’est une des stratégies pour retirer en fait cette… cette violence de simplement d’exotisation, etc. Et donc là, finalement, il y a assez peu de corps, mais les nôtres, à l’inverse, en tant que regardeureuses et en tant que spectateurices et visiteureuses de ces espaces-là sont sont mobilisés. En tout cas, on nous oblige un peu à nous poser la question de nous-même face à ces violences-là. Caroline ?
Caroline Honorien
Oui, effectivement. Il y a assez peu de porcs… ACAB [elles rient]
Camille Bardin
Il fallait que ça sorte.
Caroline Honorien
Non non. Mais effectivement, il y a assez peu de corps. Donc effectivement par des stratégies d’opacisation, etc. Tu parlais de silence et de recueillement tout à l’heure Meryam. C’est vrai qu’en fait on a un petit peu. Ah non, c’était toi Camille ? Bon qu’importe.
Camille Bardin
Quelqu’une a parlé de ça.
Caroline Honorien
Non, effectivement. En fait, c’est une… c’est une exposition en fait qui est presque hantée.
Camille Bardin
Complètement.
Caroline Honorien
C’est ça qui est assez beau. Et en même temps, je crois que ce qui est intéressant, c’est que… Donc elle est hantée, souvent c’est quelque chose qui est utilisé pour essayer de parler de futurité et d’idéal, etc. Et en fait là-dessus c’est pas le cas, on ne fait que parler de maintenant et ça c’est un petit peu aussi la force de l’exposition, c’est que malgré cette question de la poétisation, elle ne va jamais dans une abstraction totale. On n’a pas l’impression d’être dans ce white cube qui est extracteur un petit peu. Donc c’est pour ça que je pense que malgré les petites critiques qu’on a émises tout à l’heure, il y a quelque chose de très fort qui se passe quand même grâce aux œuvres des artistes.
Camille Bardin
Meryam ?
Meryam Benbachir
Cette question de l’extraction, justement. Moi, quand je suis arrivée dans la salle, la première chose que j’ai vu c’est cette immense dalle, donc ce toit. Et je me suis dit : « Oula ».
Camille Bardin
Ouille, aïe aïe !
Meryam Benbachir
Parce que pour moi, représenter la banlieue, enfin j’ai grandi en banlieue, c’est un truc qui peut très vite me gonfler. Et en même temps, il y a aussi ce truc tout bête d’affect. De moi, j’ai passé du temps à avoir la dalle imprimée sur mes fesses parce que je suis restée trop longtemps assise dessus. Enfin, c’est tout bête, mais… Et de savoir que c’était un décor de théâtre, ça déplaçait la chose pour moi. Et j’ai trouvé ça plutôt fin, parce que ça aurait très vite pu tomber dans quelque chose de complètement exotisant et extractiviste. En prenant une dalle machin : « On a ramené une dalle de telle banlieue où ça a brûlé et on l’a sauvée ! » [voix ironique] Et ce n’était pas la volonté en fait. C’était vraiment : « Bon bah y a ce travail de théâtre qui pose ces questions-là et en fait ». Enfin voilà.
Caroline Honorien
Et merci Meryam, parce que j’étais en train de me perdre tout à l’heure, mais je crois que c’était ça qui était beau dans le fait que le lieu soit hanté, c’était qu’on rattrapait en fait ce que veut dire ce mot, c’est-à-dire en fait d’habiter un lieu. Et en fait, sur cette dalle justement, on pouvait errer et habiter un endroit. Et ça c’est quelque chose qui se passe assez peu.
Meryam Benbachir
Je voulais juste revenir aussi sur la question du recueillement et du silence et de… et de cet espace habité. Pour moi, c’était un réel espace de nostalgie, mais dans le sens une nostalgie… C’est la chercheuse, curatrice, artiste et tout et tout Mawena Yehouessi qui me parlait de de la nostalgie et de la mélancolie et de la mélancolie noire comme non pas une fatalité, mais habiter avec, avec nos morts, avec nos histoires. Et en fait, j’ai un peu ressenti ça dans cette exposition et moi ça m’a… Enfin, je sais que j’ai eu un peu un moment flottant en en ressortant parce que j’avais peur de cette exposition comme je l’ai dit. Enfin voilà, c’est des sujets qui sont sensibles et qui… et qui nous touchent plus ou moins de près quoi. Enfin voilà, moi je voulais noter cet aspect-là. Et des supers travaux d’artistes quand même, on n’en a pas beaucoup parlé, mais…
Adèle Anstett
Bah je vais parler de justement sur… pas du coup nostalgie mais un autre sentiment. Fanny Souade Sow, We’ll burn everything donc 2023 donc je sais pas le mois, donc est-ce que c’était avant/après ?
Camille Bardin
Oui, mais il y a effectivement beaucoup d’œuvres produites en 2023 au moment de la mort de Nahel effectivement.
Adèle Anstett
Et… Et du coup sur ce siège en béton qui est une sculpture, on n’a pas le droit de s’asseoir dessus. Ne vous asseyez pas dessus. Il y a un texte qui parle de la politique de la terre brûlée. Et là, je trouvais ça intéressant parce que d’un coup, il y avait vraiment un rappel à cette stratégie militaire qui s’effectue face à une armée d’invasion où en fait on brûle tout pour pour ne rien laisser à l’oppresseur. Et je trouvais ça d’un coup assez puissant de parler d’outils d’organisation, mais avec une pièce qui n’est pas, qui n’est pas un texte long, qui n’est pas quelque chose d’extrêmement bruyant, donc qui est un peu silencieux, etc. Mais qui parle d’un coup, comment on fait ? Et ben on peut aussi faire comme ça : tout cramer et reprendre pour nous reprendre la main sur ce qu’on décide qui nous appartient.
Camille Bardin
Très bien.
Caroline Honorien
Mais je pense que c’était aussi une pièce qui parlait aussi justement toujours de cette question de « on ne se laissera pas montrer dans cet… dans cet espace ». Je crois qu’elle mettait en mots un petit peu des choses qu’on voyait en images et en sons à travers en fait, l’exposition parce que c’était je crois qu’elle se termine sur… En gros, on préfère brûler nos bijoux, notre héritage, plutôt qu’ils soient exposés pendant des siècles. Et voilà, ça ne fait que réaffirmer cette puissance.
Camille Bardin
Merci les filles pour vos mots. Je voulais finir là-dessus, répondre au titre de cette exposition Comme un printemps, je serai nombreuse avec d’autres mots justement, mots qui sont présents sur la tombe de Malik Oussekine au Père-Lachaise. Et pour moi, cette phrase est vraiment forte et il faut qu’on la garde avec nous. Cette phrase c’est : « Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n’empêcheront pas la venue du printemps ». Et je pense que c’est pas mal de vous laisser là-dessus. Merci à toutes les trois. Merci aussi à Projets Média pour son accompagnement Marc Beyney-Sonier, Gelya Moreau, Antoine Allain et Martin Hernandez. Je remercie aussi Cosima Dellac qui retranscrit ces épisodes. Je vous dis à dans un mois mais d’ici là, prenez soin de vous. On vous embrasse.