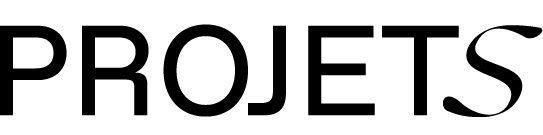Ce mois-ci, l’équipe des Jeunes Critiques d’Art s’est intéressée à l’exposition que consacre actuellement le Centre d’art et de recherche Bétonsalon à l’artiste Florian Fouché. Dans cette exposition, Florian Fouché articule la relation que les corps entretiennent avec l’espace médical et l’espace muséal, face au démantèlement progressif des dispositifs de soin en faveur des personnes les plus vulnérables, à l’instar de l’A.M.E, l’érosion progressive de la Sécurité sociale et la précarisation des institutions culturelles publiques. Une exposition qui fait écho au débat de cet épisode.
– Débat : Cultures en lutte : Show must go on ?
Extrait :
« Divertissement réjouissant apparat parfois politique. La fête serait elle un anxiolytique ? Car si les artistes se sont souvent réappropriés le langage de la fête, ses codes et ses costumes, la prenant comme thématique, support ou médium, du carnaval au banquet, des bals populaires au club techno, qu’est ce que ça signifie dans le contexte politique et social actuel Je vous ferai grâce de l’énonciation d’une autre liste, moins fun, qui oscille entre politique internationale délétère et coupes budgétaires des secteurs associatifs et culturels. »
Avec Camille Bardin, Tania Hautin-Trémolières, Lucie Giorgi, Gregoire Prangé
« SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE – Vies institutionnelles »
Florian Fouché
Jusqu’au 19 avril 2025 à Bétonsalon
Retranscription :
Camille Bardin
Bonjour à toutes et à tous, on est ravi.e.s de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu Qu’iels Soient Douxces. Ce soir au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d’Art, un collectif d’auteurs et d’autrices libres et indépendant.e.s. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d’art comme un genre littéraire à part entière et pensons l’écriture comme un engagement politique. Pour Projets, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité, en partageant avec vous les échanges qu’on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu Qu’iels Soient Douxces, c’est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d’une problématique liée au monde de l’art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd’hui, je suis avec Tania Hautin-Trémolières.
Tania Hautin-Trémolières
Bonjour.
Camille Bardin
Luce Giorgi.
Luce Giorgi
Salut.
Camille Bardin
Grégoire Pranger.
Grégoire Pranger
Bonsoir.
Camille Bardin
Et moi-même, Camille Bardin. C’est trop chouette ! On est vraiment… On est à l’international. Il y a un membre lillois, une membre marseillaise, une membre lyonnaise et moi parisienne. Donc ça y est, on a tout JCA réuni.e.s dans ce studio. Donc ce mois-ci, on a souhaité s’intéresser à l’exposition que consacre actuellement le Centre d’art Bétonsalon à l’artiste Florian Fouché, jusqu’au 19 avril prochain. Une exposition intitulée SÉCURITÉ SOCIALE, PRÉLUDE qui fera assez bien écho au débat qui est le nôtre aujourd’hui, à l’heure où le mouvement des cultures en lutte se structure toujours un peu plus, où les travailleureuses de l’art se mobilisent pour préserver leurs droits et lutter contre la fascisation de notre société. On a voulu se demander si les expositions pouvaient être un levier de mobilisation ? En bref, est-ce que the show must go on ? Je te laisse nous l’introduire Luce s’il te plaît ?
Luce Giorgi
[avec une voix très douce, presque murmurée] « Fiesta », « Boom Boom », « Joie collective – apprendre à flamboyer », « Rendez-vous sur le dancefloor » ou encore « Musée en fête »… Mais que se passe-t-il dans le petit monde des arts contemporains ? Cette rengaine entêtante, vous l’aurez peut-être déjà aperçue dans les programmations en cours ou à venir. Vous y reconnaîtrez Lille 3000, le livre de notre ancien comparse Arnaud Idelon, publié aux éditions divergences, la saison d’expositions du Palais de Tokyo, les événements des Magasins Généraux ou encore le clap de fin (provisoire) du Centre Pompidou Paris. En vous la récitant, cette liste au titre joyeux, j’ai essayé de prendre ma voix ASMR. Je ne sais pas si c’est réussi, mais c’est l’effet qu’elle me fait. Cette liste de mots qui s’articulent autour d’une notion en particulier, un peu à la mode, peut-être déjà un peu désuète – la fête. Divertissement réjouissant aux apparats parfois politiques. La fête serait-elle un anxiolytique ? Car si les artistes se sont souvent réapproprié.e.s le langage de la fête, ses codes et ses costumes, la prenant comme thématique, support ou medium, du carnaval au banquet des bals populaires au club techno, qu’est-ce que ça signifie dans le contexte politique et social actuel ? Je vous ferai grâce de l’énonciation d’une autre liste moins fun, qui oscille entre politique internationale délétère et coupes budgétaires des secteurs associatif et culturel. Dans un monde où tout semble partir en vrille, où la violence est partout, où nos cerveaux sont abreuvés de mauvais présages, a-t-on besoin de « se changer les idées », comme on dit ? Est-ce que ces programmations sont une invitation à regarder ailleurs ou une injonction à la joie ? Vous l’aurez compris, je grossis volontairement le trait. Il y a bien évidemment un peu plus de subtilité dans ces propositions artistiques et curatoriales, et même au cœur de la fête qui revêt sa part de subversion. Pas toujours, mais parfois, quand même, la fête devient le lieu de la réinvention de soi et de l’émancipation des corps, surtout des corps contraints, minorisés ou invisibilisés le jour. Loin du simple fest, la fête devient alors un moment collectif et communautaire où le militantisme peut prendre racine et revigorer les troupes. Le contexte politique et social nous oblige à penser cette question fondamentale, quoique peut-être un peu simplette, un peu naïve, un peu dangereuse. Faut-il vraiment continuer ? À créer, oui, mais à exposer ? À faire des événements éphémères à tout va ? Must the show go on ? Si oui, dans quelles conditions ? Quels sujets aborder ? Et peut-être aussi pour combien de temps ? N’est-il pas le moment de réfléchir ensemble à comment faire ensemble, avant qu’il ne soit trop tard et que plus personne n’ait envie de danser ou ne le puisse ? Avec cette liste cette fois-ci de questions, mes cher.ère.s collègues et camarades, c’est la question sous-jacente du sens de la nécessité et de la possibilité qui est posée. Ce qu’on doit faire, ce qu’on peut faire et pourquoi – et ce aujourd’hui, dans nos lieux, dans nos institutions publiques ou privées, dans nos textes et ici dans nos podcasts.
Camille Bardin
Alors, Tania, Grégoire, cher.ère.s camarades, on ne vous a pas encore entendu.e.s ? Qui veut commencer ? Grégoire ?
Grégoire Pranger
Oui bah déjà je vais peut-être juste dire que…
Camille Bardin
Oui out toi avant tout. [elle rit]
Grégoire Pranger
Oui, c’est ça. [il rit] Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant et on avait envie de parler aujourd’hui ensemble de… Effectivement, qu’est-ce qu’on… qu’est-ce qu’on peut ? Qu’est-ce qu’on doit ? Qu’est-ce qu’on… qu’est-ce qu’on peut faire, en fait, dans le contexte actuel ? Est-ce qu’on continue comme si de rien n’était ? Est-ce qu’on change nos pratiques ? Et… Tu nous proposes effectivement Luce ce parallèle avec cette profusion de programmations qui sont liées de près ou de loin à cette thématique de la fête, du carnaval, du folklore, de…
Camille Bardin
De la joie.
Grégoire Pranger
On va dire, de la joie du… Alors sous toutes ses formes. Et il y a une forme de paradoxe peut-être à ça. Alors, c’est vrai que j’aurais un peu plus de mal à parler de ce sujet spécifiquement puisque je suis moi-même impliqué dans la saison à Lille. Du coup je m’abstiendrai d’en parler. [iels rient] Mais… Mais non, je trouve qu’en fait, peut-être le sujet de fond était celui de départ, c’est-à-dire comment est ce qu’on… on pense collectivement nos pratiques, qu’est-ce qu’on peut faire ? Est-ce qu’il faut faire quelque chose d’ailleurs au niveau artistique, alors qu’on sent peut-être le besoin de se mobiliser autrement et sur d’autres terrains d’action ? J’ai pas… J’ai pas vraiment trop de réponses. Je sais pas si maintenant que je me suis outé, je laisse la parole ? Ou si je poursuis sur autre chose ?
Camille Bardin
Je ne sais pas. Est-ce que Tania toi ça t’inspire ?
Tania Hautin-Trémolières
Bah… Peut-être déjà, je peux commencer avec la réflexion un peu spontanée que j’ai eu quand on a décidé de ce sujet. Et il y avait un peu ce premier élan de : est-ce que the show must go on ? Heu non, j’avoue. Parce que je trouve que particulièrement ces derniers mois, mais en fait depuis plusieurs années maintenant, on est quand même régulièrement, collectivement et individuellement, dans dans une espèce de sidération un peu profonde, enfin en tous cas que je ressens comme ça, avec une alternance de colère, désarroi et résignation par moments, je crois aussi. Et que je trouve qu’il y a quelque chose qui est vraiment… enfin que je ressens comme assez dissonant et violent à avoir l’impression que tout s’écroule en permanence, tous les jours autour de nous. Et de constater que notre secteur, celui de l’art contemporain plus spécifiquement, continue son agenda habituel, déconnecté de ces réalités-là, avec du coup cette succession de programmations artistiques, de prix, d’appels à projet de… de cette machine dont on parle régulièrement de toute façon au sein de ce podcast. Et l’image que j’avais par rapport au sujet qu’on a choisi et à ce ressenti qui est le mien, c’est ce mème qu’on a pas mal vu sur les réseaux d’un cartoon d’un petit chien, a priori je crois, dans une maison qui brûle et qui dit : « This is fine« . Oui, eh ben c’est ça, je crois pour moi.
Camille Bardin
Oui, complètement. Je te rejoins, mais je dirais même que c’est pire encore, c’est que… Bon, je vous préviens, déjà, je suis hyper aigrie. Genre, vraiment, je suis grave en colère je crois. Je vous le dis parce que… Il me semble que c’est pire encore, parce que j’ai l’impression qu’au-delà du fait de se moquer de ce qui se passe actuellement et de ne pas prendre part à la lutte vraiment à proprement parler, il me semble que l’art contemporain depuis des années fait son beurre, en fait, sur les luttes sociales. On a vu une multitude d’expositions, de tables rondes sur le care, sur les mouvements militants, etc. pour derrière, ne voir presque aucun.e directeurice d’institutions en assemblée générale. Là, pour que vous ayez une idée, ça fait six mois… six mois, n’importe quoi, j’aimerais bien… bientôt… six semaines que le mouvement a commencé et que les premières assemblées générales, en tout cas celle de Paris où je suis basée, a pris place et j’ai vu quasiment aucun.e directeurice de lieux quoi. Et par ailleurs, on voit des expositions qui ouvrent sur le care, la joie collective, qui font la part belle aux mouvements sociaux, qui utilisent aussi tout le vocabulaire militant pour… encore une fois pour pour faire son beurre. Et je trouve que c’est ultra violent. Je… Je pense que je me souviendrai toute ma vie du fait que Paris Noir, l’exposition du Centre Pompidou, ouvre le soir même de l’expulsion des 450 mineur.e.s isolé.e.s de la Gaîté Lyrique, que la ministre de la Culture qui ordonne et motive l’expulsion de ces gamin.e.s-là, se retrouve tout sourire le soir même au vernissage du Centre Pompidou. On est face à ce genre de violence aujourd’hui et notre secteur trinque et… et je crois que ça me rend un peu aigrie, je dois dire. Luce ?
Luce Giorgi
Oui, c’est la question de l’indécence que tu soulèves ici. Et puis, je pense qu’il y a… Alors, du côté marseillais, on a eu plutôt des directeurs ou des directrices de théâtre par exemple, qui venaient aux AG. Puisque c’est bien connu, le monde du spectacle vivant est quand même un peu plus impliqué à tous les niveaux dans les… dans les luttes collectives. Mais ces mêmes directeurs et directrices de théâtre, parfois prenaient beaucoup la parole en AG. Et du coup, il y a aussi ce… cet équilibre à trouver entre le fait d’évidemment accueillir les diffuseureuses dans ces moments-là, parce que c’est important que les diffuseureuses soient présents et présentes pour que ces personnes puissent rester informées, puissent se rendre compte aussi des problématiques que les artistes qu’iels invitent ont, concrètement, dans la vie de tous les jours, mais tout en leur laissant de la place. Et pour notre secteur, moi ce qui me… ce qui me gène particulièrement, c’est que là on a vu pas mal de lieux appeler justement à rejoindre les mouvements des cultures en lutte, à faire la grève, comme ça a été le cas jeudi dernier, mais ces diffuseureuses, ces mêmes diffuseureuses, ne nous soutiennent pas véritablement avec des questions concrètes, c’est-à-dire par exemple la… la volonté d’avoir cette proposition de loi pour une continuité des revenus. Les diffuseureuses ne s’y intéressent pas tant que ça, voire…
Camille Bardin
Ou se dressent contre.
Luce Giorgi
… voire ronchonnent contre ça, parce que ça risque de faire gonfler un petit peu leur budget. Alors évidemment qu’il y a des problématiques de budget aussi chez les diffuseureuses et des coupes budgétaires qui viennent aussi, bien évidemment faire du mal à toutes les institutions, toutes les associations, que ce soit des grandes institutions comme des petites. Mais il n’empêche que les premiers et les premières concerné.e.s, c’est nous, les indépendants et indépendantes, c’est les artistes auteurices. Et donc moi, c’est ça que je reproche, c’est… c’est bien gentil évidemment de venir aux AG ou de se renseigner, etc. ou de faire de la communication sur ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu’au bout. Et au-delà d’aller jusqu’au bout, nous, on veut plus de politique de soutien, on veut en fait une égalité, on ne veut plus avoir de faux patrons, on veut quelque chose de très concret. Donc on a besoin en fait de ça, on a besoin de cette écoute-là et de… surtout c’est… L’investissement en fait militant doit se trouver là et pas forcément sur Instagram. [iels rient] Et juste pour la petite blague à part, on a vu passer quand même des choses assez ahurissantes. Justement pour le jour de la grève où tu as des lieux qui… qui mettaient : « Oui, alors on appelle évidemment à rejoindre la grève, nanana. Par contre, on ouvre le vernissage à 18h ». [iels rient]
Camille Bardin
Oui non mais je te jure, ça me vénère. Je te jure, je suis trop en colère. Grégoire ?
Grégoire Pranger
Oui, j’ai envie de répondre… de rebondir à ce que vous avez dit. Peut-être juste avant ça, indiquer que… Travaillant en institution à temps plein, on va dire, je me sens parfois moins légitime sur ces questions. Donc je vais aussi peut-être déplacer parfois la discussion dans des choses sur lesquelles je peux plus facilement parler. Plusieurs choses, ce que tu disais Camille, évidemment, cette violence qui nous entoure, cette violence qui est parfois aussi, on va dire, éclate au grand jour quand il y a une forme de concomitance de calendrier en fait, qui d’un coup fait advenir, on va dire, aux yeux de tous et toutes, en fait, ces problématiques et ces points de friction. Je dirais quand même que je ne sais pas si on peut… En tout cas, j’aurais pas employé le mot de « faire son beurre » pour les institutions publiques qui en fait sont complètement déficitaires. Il n’y a pas tellement d’argent en jeu. Alors bien sûr, on peut parler ensuite des questions de fame, de mise en avant de soi…
Camille Bardin
C’est plus là-dessus oui.
Grégoire Pranger
… de récupérer à sa propre, à son propre bénéfice on va dire des… des luttes desquelles on est par ailleurs étrangers ou étrangères. Ça c’est autre chose. Par contre, c’est vrai qu’au niveau de l’institution, je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il y ait une récupération, on va dire, qui conduise à des… à des bénéfices financiers, même peut-être inversement en fait.
Camille Bardin
Souvent… Comme souvent de manière générale, dans notre secteur. Enfin, effectivement, là je parle davantage de visibilité, de derrière… Oui, et de fame tout simplement.
Grégoire Pranger
Voilà, et du coup, ce que quand même… Enfin, pourquoi je dis ça ? C’est parce qu’au-delà de la question de documenter ces luttes, je pense que c’est pas tellement l’enjeu d’ailleurs, c’est plutôt comment est-ce qu’une institution peut… Est-ce qu’elle doit d’ailleurs le faire ? Est-ce qu’elle est légitime pour le faire ? On va dire… Donner à voir. Quand par ailleurs, en fait, la plupart de ces agents/agentes sont mobilisé.e.s et sont actifs/actives dans ces dans ces luttes. Est-ce que c’est une bonne chose que les institutions aussi, en fait, proposent ce type d’exposition sur ce type de thématiques qui vont toucher aussi les gens qui sont… qui gravitent autour de l’institution et qui y travaillent, au-delà des directeurices tu vois, ou curateurices. Et juste pour finir par rapport à ça, en fait c’est des questions que je me suis aussi beaucoup posées personnellement. C’est-à-dire que : où puis-je agir ? C’est-à-dire que forcément, on voit tout ça et on le sent, tu vois… et… Où suis-je légitime ? Quels sont mes moyens d’action ? Et au-delà de tout ça, est ce qu’il y a une forme de responsabilité individuelle et collective ? Mais aussi, personnellement, on va dire, là où je suis : qu’est-ce que je peux faire, qu’est-ce que je dois faire ? Et en fait, moi, mon travail, c’est de faire des expositions, donc soit… Soit en fait, je mets de côté cette activité pour m’impliquer autrement. Mais ça pose tout un tas de questions aussi. Et enfin bref, je vous livre un peu ça en vrac parce que c’est… C’est des questionnements qui sont… qui sont quotidiens et… et qui ne sont pas très clairs dans ma tête, mais ça m’intéresse quand même d’en parler avec vous.
Camille Bardin
Tania ?
Tania Hautin-Trémolières
Ben effectivement, c’est toujours je pense une question pour chacun/chacune d’entre nous, à différents endroits où on se place, de quel rôle on joue et est-ce qu’on peut intégrer ces positionnements politiques militants à nos pratiques ? J’entends aussi ce truc sur l’institution, mais c’est… Enfin, la liste que fait Luce en introduction, c’est vrai que dans une période comme la nôtre, avec toutes ces réalités-là, avec ce truc aussi d’être quand même bien à vif et depuis trop longtemps je crois, franchement, ça gratte, ça gratte vraiment comme programmation, comme… Et effectivement, moi je ne peux pas m’empêcher de ressentir ce truc que tu disais Luce, de regarder ailleurs avec aussi quelque chose dont on discute régulièrement au sein du collectif, et en dehors évidemment, la question de la récupération des luttes, des sujets politiques, des paroles des concerné.e.s par les institutions, par les lieux d’exposition de manière plus large, ça n’englobe pas nécessairement que les musées et centres d’art, mais… Donc, j’ai pas de réponse sur ce que devrait faire l’institution comme programmation ou comme absence de programmation peut-être. Mais c’est vrai que… Ouais, je ne sais pas si c’est l’endroit en fait. Si c’est l’endroit pour parler de ces choses-là, si… Certes, bien sûr que la fête est politique, mais je ne suis pas sûr que dans une exposition de grosses structures institutionnelles, elle soit effective. Et je crois que, de manière plus large, après, c’est une réflexion qui est la mienne et peut-être qui est partagée, mais je ne crois pas que l’exposition, finalement, soit l’endroit pour ça. Je pense qu’il y a un échec de ce point de vue-là et je crois qu’aujourd’hui je m’intéresse davantage à des espaces qui produisent du faire plutôt que de la monstration, des espaces de collectifs, des espaces d’échange, des espaces de rencontre, des espaces de lutte éventuellement, des livres, ça me semble plus effectif aussi, des éditions, que l’exposition traditionnelle ou tel qu’elle nous occupe habituellement quoi.
Camille Bardin
Oui sortir un peu de cette posture finalement simplement quoi. Luce, tu voulais y aller ?
Luce Giorgi
Je pense que ça soulève aussi la question de la temporalité en fait. Moi, j’ai la sensation… Voilà, j’ai débuté ma carrière en plein Covid. C’était… C’était déjà comme tu le… tu le disais tout à l’heure Tania. Cette impression de déjà vu et de constante remise en question évidemment du rôle de l’art. Mais… Mais dès le début, en fait. Il y a eu un truc un peu dès le début à quoi véritablement ça sert de continuer à ne pas créer justement, mais à… Parce que je suis d’accord avec toi, le faire est important, mais à montrer des choses de cette manière-là. Surtout que, une fois que les musées et les centres d’art ont réouvert, les mauvaises pratiques aussi sont revenues avec. Donc moi c’est ces enjeux-là aussi que j’aimerais bien interroger. Je trouve qu’on a énormément en fait d’expositions, on a énormément d’événements, que ça soit évidemment à Paris où là, je veux dire, on se noie continuellement dans les propositions. Mais même dans les autres villes, est-ce qu’on a besoin d’autant de choses ? Est-ce que c’est… Alors évidemment, quand on est artiste, quand on est dans la scène émergente, on recherche ça. Et même nous, en tant que critique, on est parfois avide d’écrire justement sur… sur des expos, sur des sur des artistes. Mais, mais est-ce qu’on a besoin d’autant ? Et est-ce que surtout, ça ne remet pas tout le temps les choses à la même place ? C’est-à-dire on a toujours des problèmes d’enjeux écologiques, de production, on a toujours des problèmes au niveau… des problématiques au niveau justement, tu en parlais aussi Camille, du care. Mais en fait, les pratiques, elles sont toujours aussi… elles témoignent tout le temps du harcèlement moral, etc. au sein des institutions. Et je pense qu’il y a… il y a une question de temporalité. Qu’est-ce qu’on a vraiment envie de montrer à ce moment-là ? Qu’est-ce que ça signifie de montrer la fête, l’insouciance à ce moment-là, dans un moment T, sur une chronologie telle que la nôtre ? Et puis en fait, peut-être que c’est bien des fois d’avoir un musée fermé qui invite à… à juste se renseigner justement sur le militantisme, sur le… sur les luttes et essayer de mettre peut-être en commun même de la documentation, mettre en accessibilité des collections qui parle avec des artistes qui ont parlé de ces luttes-là et mettre ça accessible gratuitement parce que c’est pas le cas de tous les centres d’art non plus. Et voilà de faire quelque chose de mieux pour l’ensemble, et pas juste pour une institution, un ou une curateurice, un ou une critique d’art, ou un ou une artiste ou travailleureuse de l’art, peu importe, mais pour tout le monde.
Camille Bardin
Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l’heure Luce, en disant qu’en AG, il y avait beaucoup de personnes du spectacle vivant qui prenaient la parole. Effectivement, c’est un milieu, c’est un secteur qui a une histoire militante beaucoup plus étoffée que la nôtre dans le… dans le secteur des arts contemporains. Néanmoins, je trouve que c’est intéressant… Il y a plein de choses à partir de ça à raconter. Déjà, je me souviens, dès les premières AG des gens du Snap, donc du Syndicat national des artistes plasticien.ne.s, Snap-cgt, qui prenaient la parole en AG en disant : « On entend beaucoup les gens du spectacle vivant, les artistes auteurices, vous avez moins l’habitude, mais allez-y, parlez, vous êtes tout autant légitime. Donc go ! » Et c’est comme ça aussi qu’on se forme en fait. Par ailleurs, c’est vrai que la manière dont notre milieu est en lui-même structuré fait qu’il y a plein de barrières en fait, qui mettent à mal un peu la progression de la lutte. Je pense évidemment au problème de l’atomisation, en fait, de notre secteur qui fait qu’on peine à se rassembler. Mais du coup, en fait, il y a aussi ce truc-là où je me dis mais pourquoi on en profite pas quand on voit qu’il y a un mouvement qui prend forme pour y prendre part en fait ? C’est que là, ça y est enfin. Il y a eu six AG, il y a eu machin… À Paris, en tout cas, je parle de mon endroit. Bah let’s go quoi ! Enfin, en fait, là il est plus question de… Enfin, c’est très cool de boire des coups en terrasse et de dire que voilà : « C’est pas ok ce qu’on fait » ou je sais pas quoi et d’avoir des grandes envolées lyriques là-dessus. Mais là, concrètement, on vous propose de vous former en commissions, de mettre en place un cadre très précis, très carré. Et je pense que c’est là que je deviens aigrie parce que c’est qu’il y a aussi, il me semble, beaucoup de flemme, il y a beaucoup de manque de courage et il y a aussi un réflexe bourgeois en fait de… « En fait, je ne prends pas part à la lutte parce que bon bah en fait ça va être plus intéressant de signer une belle exposition sur… » voilà que sais-je. Après j’avais envie de dire aussi, de redire une phrase qu’on nous a répété en AG et que je trouve très cool c’est : « Tout travail mérite sa grève ». Et moi pour le coup, je l’ai vraiment prise pour moi cette phrase-là parce que je me disais : « Bah encore une fois, je suis indépendante. Moi, c’est très rigolo, mais si je me mets en grève, je serai la seule au courant. Je pense que j’ai aucun.e de mes client.e.s qui vont ne serait-ce que le savoir quoi ». Et finalement je vais être la seule qui va en pâtir quoi. Néanmoins, la grève c’est pas uniquement visibiliser son mécontentement, c’est aussi avoir un temps dédié justement à l’organisation des luttes, au fait de potentiellement aller faire des banderoles, se renseigner sur justement la continuité de revenus des artistes-auteurices. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Là, en l’occurrence, il y avait des manifs organisées, etc. C’est aussi nécessaire de se dégager du temps pour prendre part encore une fois à la lutte. Et après, autre chose que je voulais mettre à mal un petit peu, c’est cette image qu’on a de notre secteur qui serait un secteur qui n’a pas d’histoire militante. Ça, je pense que c’est très important de se débarrasser de cette idée-là parce que je pense que c’est aussi un frein à la lutte. Et pour ça, c’est hyper important qu’on convoque certaines archives. J’en ai trouvé une que justement une des personnes du Snap, Jimmy, m’en faisait part et je la trouvais trop cool. Et j’en ai parlé à plusieurs personnes qui me disaient qu’elles avaient des frissons. C’est en 72 au Grand Palais, dans le cadre de l’exposition 60-72. Douze ans d’art contemporain en France. En fait, il y avait des manifestant.e.s qui s’étaient foutu.e.s devant le Grand Palais, sur les marches du Grand Palais pour revendiquer des droits et notamment un des slogans qui était scandé à ce moment-là, c’était : « Expo 72 des artistes au service du Capital ». Il y avait tout un truc autour de la Sécurité sociale, etc. Enfin bon, bref. Et évidemment, les flics sont arrivés. Et ce qui est fou à ce moment-là, c’est que c’était en plein pendant le vernissage et certains et certaines des artistes qui étaient exposé.e.s au Grand Palais ont décroché leurs œuvres, sont sorti.e.s du Grand Palais et sont allé.e.s directement au contact des CRS avec leurs toiles. Donc les CRS étaient comme des couillons parce qu’ils ne pouvaient pas justement nous caillasser comme d’habitude.
Luce Giorgi
Dommage ! [elle rit]
Camille Bardin
Donc voilà. Et ça c’est… Enfin, je sais pas moi je trouve ça trop beau comme comme anecdote. Et là, les artistes étaient vraiment agissants/agissantes. Et ça, en fait, il y en a plein des anecdotes comme ça. Parmi les écoles d’art, il y a mille et une luttes qui ont été pensées, imaginées, etc. Il faut aussi qu’on se raccroche à ça et faut qu’on arrête de se dire en permanence que : « Bon ben voilà, nous on sait pas se mobiliser, on sait pas ce qu’il en est de lutter, etc. Et qu’on va faire juste trois ou quatre expos sur le care et sur tout… tout… tout tout ça ». Voilà. [iels rient] Grégoire, tu voulais y aller ?
Grégoire Pranger
Je ne sais pas si j’ai encore trop… [iels rient] Merci pour la… de me balancer la patate chaude. J’ai l’impression que sur le sujet qu’on discute aujourd’hui, il y a peut-être deux grandes… Enfin, c’est comme ça que je les ai reçues en tout cas. Il y a deux grands sujets sous-jacents : la question des conditions de travail et d’action du secteur culturel – donc c’est une question vraiment, on va dire, de… de la manière dont l’activité est structurée – et puis il y a des questions ensuite qui sont liées au virage politique qu’on observe toutes et tous, et à la situation délétère au niveau national et international. C’est quand même deux questions qui évidemment sont interdépendantes, puisque un virage politique qui se droitise va venir, sans doute, et ça se vérifie d’ailleurs, c’est le cas, encore plus fragiliser les structures en fait, et les moyens d’action de l’activité. Mais là, encore une fois, à mon petit niveau, je me demande comment est-ce qu’on… à quel endroit on peut travailler ? Et je me dis, par exemple, dans le cas de ces expositions ou de ces programmations de centres d’art, de musées – déjà, selon la structure dans laquelle on est, le rôle de cette structure est extrêmement différent. Ce n’est pas forcément le rôle des musées et d’ailleurs c’est sans doute pas le rôle des musées d’être une caisse de résonance des luttes sociales et politiques. Elle peut… Le musée peut, et sans doute le fait d’ailleurs à divers endroits, on va dire, être soit le relais, soit a posteriori, bien plus tard, en fait être… Mais encore une fois, quel musée ? Musée d’art contemporain, Musée des Beaux-Arts… Enfin, c’est tellement différent. Les centres d’art tout ça.
Camille Bardin
En tout cas, pas Pompidou, on s’est fait.e.s dégager il y a il y a quelques jours seulement.
Grégoire Pranger
Donc voilà, quel est le rôle de l’institution ? Quel est le rôle spécifique de cette institution ? Comment est-ce qu’elle peut agir ? Est-ce qu’elle doit agir ? dans quelles conditions ? Moi je pense que justement, au niveau politique, on est responsable de ce qu’on montre et du coup, à cet endroit, on doit et on peut être tenu.e.s comme responsables de ce qu’on a montré. Et là-dessus, c’est un rôle qui est extrêmement concret, parce qu’encore aujourd’hui, en tout cas en France, les musées sont quand même assez libres de montrer les artistes qu’ils veulent. Ensuite, sur les conditions de travail, c’est pareil une exposition ou un projet culturel, et bien c’est un projet justement qui fait intervenir différentes personnes. Donc comment est-ce qu’on pose un cadre de travail intéressant ? Comment est-ce qu’on repense les rythmes ? Comment est-ce qu’on repense aussi la rémunération au sein du projet ? Comment est-ce qu’on repense les budgets, l’articulation entre les différentes lignes budgétaires ? Est-ce qu’on met beaucoup d’argent ici et du coup, on laisse beaucoup de monde par ailleurs ? Et tout ça, en fait, là aussi, beaucoup de musées ont en gestion – musée, centre d’art… en fait, tous les lieux culturels ont une certaine maîtrise de leur budget et peuvent faire des choix. Et donc, évidemment, c’est peut-être très naïf. J’essaye juste de savoir comment est ce qu’on peut-être utile, là où justement – et c’est là que sans doute, je suis un peu différent de toi Camille – je ne pense pas que ma place, de par ma position, soit uniquement justement, soit dans le militantisme. En tout cas, je pense que ce n’est pas là où je peux même être.
Camille Bardin
Luce ?
Luce Giorgi
Je pense qu’il y a différentes formes de militantisme. Pour revenir sur la proposition de loi d’une continuité des revenus pour les artistes auteurices. Par exemple, ce que les diffuseureuses peuvent faire, qui est dans leur capacité et qui ne leur demande pas nécessairement de le visibiliser, c’est d’aller au contact des journalistes qu’iels connaissent, d’aller au contact des sénateurs et sénatrices, des député.e.s afin de parler de cette proposition de loi, afin de véritablement soutenir les artistes auteurices. Car cette proposition de loi, le fait qu’on en parle, le fait qu’elle soit soutenue et que des diffuseureuses la soutienne, ça changerait concrètement les choses. C’est-à-dire qu’il y aurait une implication directe de cet acte de militantisme. Et je pense que c’est peut-être là le rôle à jouer et pas forcément de faire un musée du militantisme, même si j’avoue, c’est un peu mon rêve. [elle rit]
Tania Hautin-Trémolières
Tellement.
Camille Bardin
Oui, l’idée finalement, c’est de… Là, j’ai l’impression que ce dont tu parles Grégoire, c’est aussi simplement d’avoir de bonnes méthodologies de travail, des méthodologies de travail qui sont saines, etc. Mais ça, c’est à minima ce qu’on réclame en fait aux diffuseureuses, etc.
Grégoire Pranger
C’est pas ce que je dis, ce que… La question que je me pose, c’est : qui agit où ? Qui est responsable de quoi ? C’est simplement ça, c’est tout ce que je vois. Et donc évidemment, on n’est pas toustes en train de faire des lois donc… Mais par contre, je pense que tout le monde… on va dire, toutes les personnes qui sont en poste et qui ont des responsabilités et qui ont les moyens, on va dire, de proposer de petites améliorations, en tout cas qui vont dans le bon sens et ben peut-être doivent le faire. Et ça, évidemment, c’est le premier pas. C’est peut-être le niveau zéro dont tu parles, mais en fait il est déjà pas fait, il est pas largement fait en tout cas.
Camille Bardin
Et surtout, il y a une… J’ai l’impression que dans notre secteur, souvent on se… On n’arrive pas du tout à conscientiser le pouvoir qu’on peut avoir en fait. Et c’est pas parce que je suis juste indépendante, etc. que j’ai pas du pouvoir aussi. En fait, ma voix elle porte à certains endroits évidemment à des échelles très variées, etc. Mais il faut aussi se rendre compte de la responsabilité qu’on a, je pense, à certains endroits. Et aussi, je pense, moi ce qui me dérange le plus, c’est que aujourd’hui, je pense qu’on ne peut pas faire comme si de rien n’était en fait. Parce que cette lutte, elle concerne pas simplement notre petit milieu. Il y a effectivement la question des budg… heu des coupes budgétaires, etc. Mais finalement, cette lutte, elle s’inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre les idées d’extrême droite, contre la fascisation de nos sociétés et pour la préservation et l’élargissement des services publics. Parce que l’art et la culture, ça se situe au croisement d’une multitude de services publics qui sont eux-mêmes menacés. Je pense à la santé, à l’éducation, à la recherche, etc. Tous ces secteurs, ce sont des secteurs avec lesquels les travailleureuses de l’art collaborent. C’est pourquoi il est vital, en fait, d’allier nos forces. Parce qu’en face, on sait déjà quel projet de société l’extrême droite porte : un projet mortifère, liberticide, nationaliste et raciste. Et si on ne se bouge pas maintenant, c’est dans ce monde là qu’on vivra, et pas plus tard que demain. Et je pense que c’est vraiment ça aussi. J’aimerais bien finir là-dessus, c’est de se dire pour celles et ceux qui disent : « Oui, à quoi bon lutter pour la culture, etc. C’est bon, on s’en fout ! » On n’est pas là, juste à essayer de préserver notre petit pré carré. Enfin moi, à la rigueur oui, le pass culture etc. ça me met ultra en colère, soit. Mais c’est juste… C’est presque anecdotique par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs. Donc ça, c’est aussi une entrée vers une lutte plus globale que je viens de décrire juste ici. Luce dernier mot ?
Luce Giorgi
Juste pour aller dans ton sens. On lutte également pour l’abrogation de la réforme RSA qui concerne pas seulement les artistes et les travailleureuses de l’art, mais tous les secteurs confondus. Et d’ailleurs on est confronté.e.s en fait à des du ministère qui vont essayer justement de nous défaire des autres secteurs, de faire en sorte qu’on soit… qu’on soit un peu à se tirer dans les pattes, alors que c’est pas du tout ce qu’on veut. Nous, on veut des luttes intersectorielles.
Camille Bardin
Complètement en solidarité absolue avec les agriculteurices et avec les personnes en situation de handicap. Complètement. On passe à l’expo ?
Tania Hautin-Trémolières
Yes ! [iels rient]
Grégoire Pranger
La transition elle risque d’être compliquée…
Camille Bardin
Oui, Je ne vais pas me risquer à faire une transition sur ce sujet-là. Donc tout de suite, je te lance Tania pour pour faire l’introduction de l’exposition. Je t’en prie.
Tania Hautin-Trémolières
Merci Camille. Donc pour cet épisode, nous avons décidé de discuter de l’exposition de Florian Fouché présentée à Bétonsalon, Centre d’art et de recherche à Paris, en cours depuis le 24 janvier dernier et jusqu’au 19 avril. L’exposition s’intitule SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE, sous-titrée Vies institutionnelles, au pluriel donc, sur un commissariat d’Emilie Renard. Elle présente un petit ensemble d’œuvres qu’on pourrait qualifier de « précaires », des installations et vidéos à l’intérieur et à l’extérieur aussi du centre d’art. Pour expliquer en quelques mots le contexte et le travail de Florian Fouché, je vais citer directement le début du texte par Émilie Renard qui figure dans le livret de visite : « L’exposition s’inscrit dans le prolongement d’une vaste enquête sur la « vie assistée » – terme de l’artiste – qu’il mène depuis 2015. Elle trouve son origine dans l’accompagnement du parcours de soin de son père, Philippe Fouché, qui, suite à un accident vasculaire cérébral, est devenu hémiplégique, se déplace en fauteuil roulant et vit en institution. Elle est également informée par deux arpentages préalables fait de rencontres, de visites, de lectures, de compagnonnage au long cours ». La suite du texte de l’exposition apporte, je trouve, quelques éclairages utiles et sûrement nécessaires sur les recherches de l’artiste et ses réflexions, à partir notamment du Musée Antidote qui a été développé par l’ethnologue Irina Nicolau et l’artiste Horia Bernea au musée du Paysan roumain à Bucarest sur le travail de Fernand Deligny, éducateur, écrivain et réalisateur français, né en 1913 et mort en 96 et son travail auprès d’enfants autistes dans les Cévennes, ou encore de l’atelier de l’artiste Brancusi. Initialement installé près de l’hôpital Necker, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, premier hôpital pour enfants malades qui mènera finalement à la destruction de l’atelier de Brancusi au profit de travaux d’extension de l’hôpital. De cette cohabitation un peu étrange d’éléments qui ne semblent a priori pas être directement en lien, par exemple, entre l’assurance maladie et Brancusi, Florian Fouché établit ses propres correspondances, notamment avec une chronologie présentée dans l’œuvre « Vitrine assistante-assistée ». Des recherches réalisées avec Gabrielle Balagayrie et Quentin Bouard qui viennent mettre en parallèle et en collision l’institution médicale et l’institution culturelle et leurs faillites respectives. C’est aussi cette chronologie et cette vitrine de recherche qui viennent éclairer autrement l’installation vidéo « Vie institutionnelle », pièce centrale de l’exposition à Bétonsalon. Un plan-séquence d’un jour tourné justement dans l’atelier reconstitué de Brancusi, près du Centre Pompidou, où l’on assiste à une sorte de chorégraphie silencieuse entre Florian Fouché, nu, immobile et accroupi sur une chaise à roulettes, mis en mouvement par son père Philippe Fouché à l’aide de son fauteuil électrique, avant de m’arrêter là dans cette présentation et de laisser la place à notre discussion sur cette exposition, je voulais simplement vous lire la première phrase du texte de Florian Fouché qui était dans son exposition Manifeste assisté présenté au CRAC de Sète en 2023 : « Nous sommes tous·tes à la fois des assisté·es et des assistant·es. Tout le monde, toute puissance ou impuissance. »
Camille Bardin
Trop bien. Peut-être avant de vous laisser la parole, traditionnel petit disclaimer. Vous savez que c’est important pour nous de vous… d’être complètement transparent et transparente quant à nos modalités de découverte de ces expositions-là. En l’occurrence pour celle-ci, vous m’arrêtez si je dis une bêtise, mais il me semble que Bétonsalon n’est pas du tout au courant qu’on organise cet… cet épisode. Donc on n’a pas du tout parlé ni aux personnes qui gèrent le lieu, ni à l’artiste, etc. On a fait les visites d’expositions comme des visiteureuses lambda. Et aussi, petite précision, je trouve que c’est bien de le dire aussi, vu le débat qu’on a fait juste avant, Bétonsalon est un des premiers centres d’art à s’être déclaré en grève pour la mobilisation du 20 mars qui était il y a deux jours donc. Ceci étant dit, Luce, Grégoire, est-ce que vous voulez commencer ? Grégoire ?
Grégoire Pranger
Moi, je… En fait, j’ai assez hâte de vous entendre et de discuter avec vous parce que cette exposition m’a laissé assez… assez froid je dois dire. En même temps, j’y suis resté assez longtemps quand même. J’ai trouvé ça intéressant. En fait… Alors on aime bien également… Je vais faire un petit pas de côté, pardon, c’est très décousu. On parle régulièrement aussi de la manière dont l’exposition se donne à voir et se donne à penser. Et c’est quelque chose qui… qui m’a également gêné en fait et qui m’a… qui a participé à cette manière que j’ai eu de recevoir le projet qui était que, en fait, c’est très documenté, c’est vraiment… c’est aussi le lieu qui veut ça. On est vraiment dans la recherche également qui se donne à voir. Mais je trouve que c’est… c’est très difficile d’accès. J’ai trouvé le texte et les textes très intéressants mais particulièrement complexes, avec un vocabulaire qui parfois peut éloigner le public de ce que… on va dire… les œuvres souhaitent transmettre ou en tout cas montrer, et ça m’a un petit peu gêné en fait, je dois dire. Et de manière un peu plus générale… Et je ne voudrais pas que… J’ai pas envie d’être tout de suite très critique sur le projet, qui par ailleurs m’a beaucoup intéressé. Mais j’ai trouvé ça très sec en fait. Et ça peut-être une esthétique choisie. C’est peut-être le cas ici. Mais c’est quelque chose qui souvent me… très personnellement en fait, me… me bloque, me met à distance. Je n’arrête pas de penser aussi à un public moins informé, moins habitué à la fois à l’esthétique contemporaine ou aux esthétiques contemporaines, mais également à tout ce vocabulaire, cette grammaire qu’on est habitué.e à la fois de lire et d’utiliser. Et j’ai trouvé que là, il y avait vraiment une mise à distance assez assez forte. Je ne sais pas si vous l’avez ressentie aussi ou au contraire si vous ne l’avez pas ressentie. C’est la première chose que j’avais envie de dire en fait. C’est quelque chose qui m’a vraiment pris dans l’espace.
Camille Bardin
Très bien. Luce, tu embrayes ?
Luce Giorgi
Oui, je te rejoins Grégoire, sur sur cette certaine forme d’aridité notamment… En tous cas, moi je l’ai ressentie d’autant plus fortement on va dire, cette aridité face aux éléments plastiques et moins étonnamment face à la recherche qui m’a semblé assez intéressante sur cet atelier de Brancusi. Et face aussi également à cette cette vidéo qui est quand même un dispositif que moi j’adore. Donc deux grands écrans assez monumentaux qui viennent se regarder l’un l’autre en miroir, que j’ai trouvé très beau d’ailleurs au niveau du dispositif, avec également ses chaises qui rejouaient la chaise du performeur, donc de Florian Fouché, qui… des chaises à roulettes, d’autres non voilà… qui nous invitaient à rejouer un petit peu ce… ce corps-là, d’empêché ou de contraint. Avec cette question de la scénographie qui contraint les corps qui les invitent à certains mouvements plus que d’autres. Je pense que j’aurais préféré, je pense que ça aurait été potentiellement plus accessible – et là, c’est vraiment très personnel comme remarque – mais s’il n’y avait eu peut-être que cette vidéo en fait. Puisque je suis, en réalité, passée à côté des autres œuvres plastiques. Je me questionne aussi sur ce… sur cette recherche qu’a mené l’artiste sur l’atelier de Brancusi, sur son déplacement. Donc j’ai notifié que l’exposition allait se déplacer à Guingamp, dans le centre d’art Gwinzegal. J’espère que je le prononce bien à la Bretonne. Et ça m’a marqué puisque c’est un centre d’art qui est assez particulier. Je suis très fan de ce genre de centres d’art puisque c’est une ancienne prison. Et donc je me suis interrogée sur ce… sur ce lien de présenter une exposition dans un contexte universitaire qui parle évidemment du lien entre l’hôpital et le centre d’art et ensuite de le présenter dans un contexte plus carcéral. Je ne sais pas s’il y a des liens comme ça, soit méthodologiques, soit assez joyeux et surprenants. Alors je ne sais pas si « joyeux » est le bon terme, mais en tout cas qui rejouerait quelque chose de l’ordre du carcéral, du fait de l’enfermement. Voilà, c’est une petite remarque comme ça, qui… que j’ai trouvé ça assez réjouissant étonnamment.
Camille Bardin
Oui. C’est drôle que tu dises, Luce, que finalement la vidéo aurait pu suffire parce que ça a été un peu mon cas. Moi en l’occurrence, pour tout vous dire, quand je suis arrivée pour faire l’exposition, il y avait un événement à l’entrée et donc je n’ai pas pu avoir accès à une petite partie de l’exposition qui est vraiment à l’entrée quoi. Donc je me suis focalisée sur la vidéo et je dois dire que, en l’occurrence, elle m’a assez vite parlée. Enfin, elle a soulevé plein de questions, mais elle m’a assez vite parlée. Déjà parce que je pense que la question des personnes aidantes, c’est une question qui me touche aussi à titre personnel. Enfin, moi tout de suite en fait, j’ai vu… j’ai vu le corps aussi de mon grand-père que j’ai vu amaigri et fatigué depuis qu’il doit s’occuper quotidiennement de ma grand-mère atteinte de Parkinson, qu’il doit l’emmener aux toilettes, penser à lui donner ses médicaments toutes les 3h, lui… la laver, lui brosser les dents, etc. Enfin, en fait, tout de suite, j’ai été plongée dans cette… cette problématique intime quoi. Et après… En fait, cette vidéo, je l’ai trouvé intéressante parce qu’elle m’a obligée à me poser plein de questions, parce que, à la fois Florent Fouché fait plein de trucs que je déteste et en même temps, je trouvais que ça fonctionnait trop bien ici. C’est-à-dire que je trouvais que ce qui était vraiment intéressant ici, c’était la question du gaze, la question du regard en fait. C’est que, donc, dans cette vidéo, on voit, comme tu le disais Tania en introduction, ces deux corps, donc le corps de son père et le sien qui performent tous les deux, son père est en fauteuil roulant électrique, c’est lui qui… qui mène la danse en quelque sorte. Et Florian Fouché s’agrippe à ce fauteuil-là et sur une chaise de… une chaise de bureau qui est à roulettes quoi, complètement nu. Et il se laisse porter comme ça par son père. Et en fait, la caméra, elle vient vraiment… Elle se pose sur leur corps et elle vient filmer le corps dans tout ce qu’il a de plus banal. Elle vient chercher le grain de la peau, les poils, les plis du visage. Pareil, j’ai trouvé ça hyper intéressant le fait de filmer le fauteuil comme un corps à part entière. C’est vraiment l’extension du corps de son père. Et ça, j’ai trouvé ça hyper important de le montrer tel quel. Et en fait, là où moi j’ai vraiment du mal avec la caméra qui morcelle, qui vient justement découper les corps et les scruter, et bien là j’ai eu la sensation que cette caméra-là, c’était pas un œil qui venait scruter justement, mais plus un regard qui venait… J’ai envie de me tirer les oreilles en disant ça, mais qui venait « enlacer », etc. Enfin, ça fait un peu. [elle rit gênée] Enfin bref. Mais oui, En tout cas, il y avait quelque chose de très doux là-dedans et je me disais : « Mais comment il fait ? » Enfin, j’ai pas réussi à mettre le doigt là-dessus. Comment il fait ? Alors même qu’il fait un truc que je déteste que les artistes… quand les artistes le font – à savoir encore une fois, découpées, etc. les corps. Comment alors, lui qui est en train de le faire, pourquoi là, ça me touche à cet endroit-là ? Peut-être parce que lui même est nu ? Lui-même est dans un moment de grande vulnérabilité. Peut-être que c’est ça aussi qui vient déjouer en fait un regard puissant et… et voyeur finalement. Luce ?
Luce Giorgi
Oui, moi j’ai beaucoup aimé aussi ces moments que j’associe moi plutôt aussi à la complicité entre un père et un fils.
Camille Bardin
Complètement.
Luce Giorgi
Il y a au début, il y a ce masque quand même du performeur qui est très fermé. Il est… Il ferme d’ailleurs les yeux. Il y a quand même quelque chose de l’ordre du personnage qui est créé et… Et puis au fur et à mesure de la vidéo, il y a des… Il y a des moments où ce masque se rompt et… et on décèle véritablement la complicité, l’amour qu’il y a entre ces deux personnes. Il y a des moments de triche où le père n’arrive pas à déplacer la chaise, donc il demande à des… à des complices de l’aider à faire rouler cette chaise roulante où se trouve son fils. Et puis, il y a des moments de rire où il y a des regards, il y a quelques…. il y a quelques phrasés presque indéchiffrables pour nous qu’ils s’échangent. Et puis il y a ce dernier moment, avec cette main qui se top, où là vraiment, le masque est totalement tombé. Et puis, on est dans quelque chose de beaucoup plus… Beaucoup plus doux. Moi, j’aime beaucoup cette complicité qui vient rompre ces rôles un peu figés. Je trouve qu’il y a quand même… tu vois, tu parles d’inversion des rôles. Je pense qu’il y a quand même certains moments où ça « revient un peu à la normale » entre guillemets. Notamment à un moment où il y a les jambes du père qui se lèvent, donc certainement pour pouvoir pousser plus facilement dans cette espèce de chorégraphie. Et puis, le fils vient aider en fait à soulever les jambes de son père pour qu’elles soient bien installées. Et donc là, en fait, on revient un peu à cet… à « cet endroit » entre guillemets, où le fils redevient l’aidant en fait, où redevient celui qui accompagne le mouvement du père. Hum. Voilà.
Camille Bardin
Grégoire ?
Grégoire Pranger
Oui, juste pour dire que ce que tu décris Luce, c’est quelque chose que j’ai ressenti assez fortement aussi. J’ai d’abord ressenti une forme de malaise, je dois dire devant cette cette installation vidéo. Il y avait une très grande violence, notamment parce que, on va dire, il y a un éclairage qui est très blanc, il y a une grande froideur dans le dispositif, on va dire, scénographique, avec ces corps de Brancusi qu’on entraperçoit en fait derrière la vitre. Et puis, au fur et à mesure, ça a laissé place à une grande douceur en fait. Et c’est pour ça aussi que je suis resté si longtemps, c’est qu’il y a vraiment eu cette transition à l’intérieur de moi-même, de… En fait, d’une violence qui me conduisait à quand même énormément de pensées très critiques, jusqu’à une forme de grande douceur qui m’a apaisé en fait, avec la manière dont je recevais aussi le travail. Ça pose plein, plein, plein de questions. Et comme toi Camille, en fait, cette expo… enfin ce ce film m’a conduit à plein de questionnements intérieurs sur les questions de contrôle, sur les questions de déplacement, sur les questions de lâcher prise. Et dans le texte, on découvre aussi, et ça, ça m’a particulièrement intéressé, que l’artiste, en fait, fait un parallèle avec ce qu’il nomme le « musée hôpital ». Du coup, en détournant le terme dont tu parlais Tania sur le musée…
Tania Hautin-Trémolières
Antidote.
Grégoire Pranger
Musée Antidote. Et… il expliquait ainsi que le musée hôpital, en fait, qui fige et qui maintient les œuvres dans une forme de fiction sinistre. Et donc ce parallèle est fait comme ça. Alors ça m’a bien sûr assez bousculé, j’ai d’abord pensé : « Je suis pas du tout d’accord, c’est pas vrai ! » [iels rient] Non mais évidemment, parce qu’on se sent toujours un petit peu… Mais globalement, pourquoi je dis ça ? C’est parce que je trouve ça toujours très intéressant. En fait, quand l’art contemporain ou des artistes proposent une forme d’autoréflexion ou de réflexion sur le système qui les entoure à partir de quelque chose d’autre et en créant et en créant ces ponts ou ces rapprochements proposés, qui par ailleurs étaient très bien documenté et très bien expliqués. Ça, c’est quelque chose qui était pour le coup vraiment réussi. Voilà.
Camille Bardin
Tania ?
Tania Hautin-Trémolières
Je pense un peu comme vous, j’ai pas su tout de suite, et je sais toujours pas je crois, ce que j’ai pensé en sortant de cette exposition. Je sais qu’entre le moment où je l’ai vue et le lendemain avec un peu le temps que ça retombe, que ça reste en tête, de lire plus attentivement aussi le livret, les textes, les notices. Il y a des choses qui se sont un petit peu éclaircies. Moi, je crois que j’ai quand même bien aimé cette vidéo, même si j’ai pas su tout de suite, et j’étais là : « Mais… Mais où va-t-on avec cette cette vidéo ? Et où vont-ils tous les deux ? » Et… Je crois que je suis moins critique que toi, Grégoire, sur les textes. Je… Je questionne beaucoup, toujours le fait qu’ils en aient besoin pour comprendre la démarche de l’artiste et y accéder. Et c’est un vrai sujet, toujours. Je pense qu’effectivement elle est… Une exposition qui sera peut-être malgré elle assez hermétique et c’est dommage je trouve, vu… vu les sujets de l’artiste. Mais en même temps j’ai trouvé que c’était vraiment des bons outils pour appréhender sa démarche, pour appréhender la temporalité aussi dans laquelle il travaille, la manière dont il travaille avec son père notamment, pas exclusivement, mais aussi avec. Et quand je regardais la vidéo, je n’arrêtais pas de me dire : « Mais pourquoi dans l’atelier Brancusi ? » Parce que j’ai vu la vidéo avant de revenir dans la première salle où il y a notamment du coup cette vitrine de recherche et d’enquête. Et ça me perturbait beaucoup parce qu’il y a plein de correspondances effectivement visuelles, d’associations d’images de ces corps, des sculptures et des décors de Florian Fouché et Philippe Fouché. Et donc, en revenant sur mes pas et en revenant devant la vitrine où il y a un dispositif avec des lettres, des archives, des photos et un montage photo aussi qui fait un parallèle entre un lit d’hôpital, un lit dans un couloir d’hôpital et une image de l’atelier de Brancusi. En fait, en ayant accès à cette pièce-là de l’exposition et à cette chronologie dont je parlais rapidement en introduction, j’ai compris. J’ai pas forcément compris les liens en soi, mais j’ai compris les liens que fait Florian Fouché entre cette question de l’institution du coup culturel, artistique qui passe là par l’atelier de Brancusi et… et son père avec… Il y a une œuvre… dont moi j’aimerais quand même bien qu’on parle, enfin ou en tout cas qu’on évoque. C’est les sculptures, qui est un ensemble de balises routières moulées qui sont un petit peu comme ça contorsionnées, tordues, trouées, un peu béantes. On pourrait dire en quelque sorte inadaptées. Et en fait, ça renvoie directement à… quelque chose qui est présent dans la chronologie. Donc un rapport de l’Inserm qui était sorti en 2006, qui est juste effroyable, qui préconisait de détecter dès l’enfance, plutôt la maternelle en l’occurrence, les futurs délinquant.e.s, en détectant donc potentiellement des comportements problématiques. Donc c’est un rapport qui servait de base de projet de loi, non votée (important), proposé par Nicolas Sarkozy, donc en 2006. Et je trouvais intéressant de quand même de pouvoir l’évoquer ensemble, à la fois parce que… pour avoir regardé d’autres images des pièces de Florian Fouché, je trouve que c’est une esthétique qui revient. C’est des matériaux qu’il utilise beaucoup face à la vidéo, notamment. Sur une des chaises sur lesquelles on peut par ailleurs s’asseoir, il y a cet espèce aussi de corps un peu éventré…
Camille Bardin
… presque monstrueux..
Tania Hautin-Trémolières
… dégoulinant, ouais, un peu étrange – qu’on voit pas tout de suite dans la pénombre de la pièce, etc. Et aussi, parce que ça renvoie, je trouve, vraiment à cette histoire de… ouais, de faillite institutionnelle, de défaillance qui finalement, après coup, m’apparaît comme être vraiment le sujet de cette exposition, mais qui n’était pas évident à mes yeux en la découvrant.
Camille Bardin
Trop bien ce que tu viens de dire. Grégoire ?
Grégoire Pranger
Oui, juste le… c’est vrai que ce… Le corps justement, qui est comme ça sur une chaise dans cet espace où en fait nous prenons place pour voir le film, je ne l’ai vu qu’à la fin, en me levant et en partant. Parce que quand je suis arrivé, il était entouré d’autres corps, de vraies personnes pour le coup.
Grégoire Pranger
Jump scare ! [elle rit]
Grégoire Pranger
Et j’ai trouvé ça vraiment bien. Ça m’a, ça m’a… C’était vraiment bien. J’ai trouvé ça vraiment… Ça m’a vraiment interrogé et j’étais content de le voir à la fin en fait. Peut-être juste pour revenir sur Tania ce que tu dis par rapport aux textes… aux textes X et S, puisqu’en fait ils sont nombreux dans le livret aussi qui accompagne l’exposition. Ils sont très précis, ils sont généreux, en ce sens que…. il y a notamment des notices pour chacune des œuvres et que ces notices sont longues et prennent le temps de d’expliquer les choses de manière précise. Néanmoins, je trouve quand même que voilà, c’est toujours la question… C’est extrêmement compliqué. C’est toujours la question de : quel est le contexte de réception et commente est-ce qu’on écrit différemment et comment est-ce qu’on medie (enfin de médier) différemment selon le contexte de diffusion de ces textes ? Entre un texte de salle dans l’exposition, entre un livret de visite, un catalogue d’exposition, des actes de colloques, j’en passe. Et j’ai trouvé les textes en soi très bons. C’est juste que le livret, j’imagine qu’on est plutôt censé le lire après avoir vu l’exposition parce que les textes sont vraiment longs. C’est peut-être compliqué de… Enfin moi j’ai pas réussi.
Camille Bardin
Oui d’arriver à te poser 20 minutes pour lire ça…
Grégoire Pranger
J’ai pas réussi. Il y a quand même beaucoup. Enfin, c’est hyper intéressant mais…
Camille Bardin
Mais c’est dense.
Grégoire Pranger
Mais c’est vraiment… Ça prend son temps quoi. Le… Alors dans l’exposition, il y a un texte d’introduction qui est une sorte de version plus réduite, en fait, du même texte qu’on retrouve… [texte] général de l’exposition qu’on retrouve dans le dans le livret. Voilà, c’est plutôt là dessus en fait, c’est plutôt sur ces questions-là que je m’interrogeais, pas sur la nature, enfin pas sur la qualité du texte en tant que tel. C’est pas ça la question. Et je pense qu’il est nécessaire en fait même à la bonne réception de l’œuvre. Mais… mais plutôt comment est-ce qu’on décline en fait ces informations et comment est-ce qu’on les décline très différemment en fait… pour qu’ils soient adaptés à leurs espaces de réception. C’est… Voilà, c’est plus là-dessus.
Camille Bardin
Je te rejoins complètement, Grégoire. Je pense que c’est exactement ce genre de questions que je me suis posé aussi en sortant de l’exposition parce que je me disais Florent Fouché c’est assez… Franchement, c’est assez fort je trouve ce qu’il fait parce qu’il arrive à mettre en place plein de… plein de petites choses qui sont assez discrètes mais super efficaces, même si ça mériterait un terme mieux choisi. Mais oui, effectivement, le fait de montrer ces chaises de bureau qui permettent de trancher entre une esthétique très bureaucratique qui est une violence symbolique en soi face à des corps meurtris, malades, enfin de la chair quoi, tout simplement. Donc, il y a des choses comme ça qui sont mises en place par l’artiste, qui sont très intéressantes. Et en même temps, du coup, du côté de la curation, ça pose plein de questions, à savoir comment en fait montrer le travail d’un artiste qui est un artiste chercheur, un artiste enquêteur qui vient tisser des liens comme ça ? Comment donner accès à ces recherches sans effectivement balancer je ne sais combien de quantité de texte qui peut être aussi un frein pour certains publics, etc. Donc à titre personnel, je me suis dit : « J’ai trop envie de l’inviter dans PRÉSENT.E », qui est le podcast que je fais par ailleurs. Mais j’ai cette possibilité-là, enfin, c’est un privilège d’avoir cette possibilité-là parce que c’est mon métier, etc. Mais je me dis en tant que visiteuse qui n’a… qui ne travaille pas dans ce secteur, etc. et qui n’a pas la possibilité d’échanger avec Laurent Fouché, je pense que j’aurais été quand même vachement frustrée quoi. Parce que je pense que ça manque peut-être, et peut-être que je dis une bêtise parce que ça se trouve iels ont produit un podcast pour l’occasion, etc. Je sais que par ailleurs, il y a eu énormément de… Enfin, c’est la sensation que j’ai, je ne sais pas si vous êtes… vous me rejoignez là-dessus, mais j’ai l’impression que Bétonsalon a organisé énormément d’événements autour de cette exposition. Preuve à nouveau, c’est que quand je suis arrivée, il y en avait un en cours. Donc, iels font vivre par ailleurs l’exposition avec d’autres… d’autres propositions que simplement la monstration des pièces et des œuvres et des objets produits par Florian Fouché. Mais voilà, je trouve que souvent c’est le problème avec les artistes chercheureuses et enquêteurices, c’est comment diffuser et montrer et donner accès à la chair même de leur travail quoi ? Moi c’est ça qui m’excite aussi de voir comment il fait les liens dans sa tête, etc. Luce ?
Luce Giorgi
Juste pour… pour approfondir cette cette question de comment montrer des recherches, qu’elles soient en cours ou terminées dans le cadre d’expositions et notamment alors lui, il est… Il est évidemment un chercheur, mais aussi documentariste. Je pense que c’est important aussi de souligner ce côté documentaire. Il y a… En fait, c’est quand même un projet qui a été soutenu par la DAGP, mais aussi avec le Centre Pompidou et la bibliothèque Kandinsky, qui est une bibliothèque de chercheurs et chercheuses. Et je pense que c’est peut-être cette donnée-là, en fait, qui est une information manquante et qui fait que ça peut ne pas être très accessible à tous les publics. Je m’arrête ici pour ce point. Je voulais quand même ré-évoquer cette notion de défaillance qui… que tu as… que tu as évoqué Tania, et qui m’a particulièrement parlée. Je pense qu’il y a deux enjeux pour moi dans cette défaillance. Il y a évidemment la mise en parallèle de la défaillance des systèmes, de problématiques économiques, puisque dans la réduction des budgets étatiques, on a évidemment en premier lieu la culture, mais les services publics suivent de très près et ça va de pair avec les universités, avec les hôpitaux. Et donc on connaît très bien les problématiques qui encourent, en fait, à ces coupes budgétaires : moins de soignants et de soignantes, moins d’argent pour… pour les malades, moins d’argent pour… pour les chercheurs et chercheuses et moins d’argent pour les centres d’art et les artistes auteurices, on le répète. Il y a cette défaillance-là. Mais pour moi, il y a aussi potentiellement quelque chose qui est à voir avec… Est-ce que des luttes intersectorielles sont possibles ? Puisque les artistes, avec l’atelier de Brancusi, se font manger par l’hôpital public, les enfants se font manger par l’État. Donc est-ce que c’est possible de faire les choses ensemble et de lutter ensemble pour que plus personne ne se fasse manger ? Je voulais juste, du coup pour finir, revenir quand même sur le titre de l’exposition SÉCURITÉ SOCIALE PRÉLUDE. Nous aussi on lutte pour une Sécurité sociale totale. Pour qu’on est, de la même manière que, en 46, les ouvriers et les ouvrières ont pris cet outil formidable qu’est la Sécurité sociale pour pouvoir permettre aux retraité.e.s, aux malades, à toutes les personnes qui avaient besoin de se reposer, d’avoir des congés maternité, etc. d’avoir une continuité de revenus. On aimerait nous aussi accéder à cette Sécurité sociale, à l’assurance chômage, etc. Donc c’est un enjeu qui est aussi très actuel, très ancré dans nos revendications présentes.
Camille Bardin
Et bien merci Luce, je crois que la boucle est bouclée grâce à ta conclusion. Merci cher.ère.s auditeurices de nous avoir écouté.e.s. On se retrouve donc en AG je pense. Et sinon au mois prochain avec un nouvel épisode de Pourvu Qu’iels Soient Douxces. Je remercie évidemment toutes les équipes de Projets : Marc Beyney-Sonier, Gelya Moreau, Antoine Allain, Martin Hernandez et Cosima Dellac également, qui retranscrit les épisodes de Pourvu qu’elles soient douces. On vous dit à dans un mois, mais d’ici là, prenez soin de vous et on vous embrasse. Ciao !
Tania Hautin-Trémolières
Bye !
Grégoire Pranger
Ciao !
Luce Giorgi
Ciao !