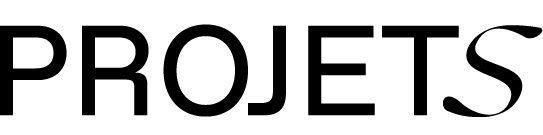Avec Camille Bardin, Horya Makhlouf, Luce Cocquerelle-Giorgi & Samy Lagrange.
↘ Exposition : « Partir du muscle » au Centre d’Art Contemporain de Brétigny-sur -Orge. Commissaire : Daisy Lambert
↘ Débat : Comment contrer les mises en concurrence des acteurices dans le secteur de l’art contemporain (prix, appel à projets, etc.) ?
Extrait du débat :
« En école d’art, à la fac d’histoire de l’art ou lors de nos premiers stages et petits boulots mal payés, on a toutes et tous entendu les mêmes phrases : “Il n’y a pas de place pour tout le monde” ; “Tu sais, personne n’arrive vraiment à vivre de l’art” ; “Mais tu as un plan B, au fait ? ”. Dès le commencement, on est découragé.
Et pour celles qui feront le choix d’essayer de se faire une place dans le monde de l’art, s’ouvre alors l’univers impitoyable de la compétition. C’est comme ça et pas autrement. Il va falloir jouer des coudes. À cela s’ajoute une mise en concurrence institutionnalisée. Expositions, prix, résidences, récompenses et appels à projets ne distinguent, à chaque fois, que quelques heureux élus.
Il nous rappelle aussi, à chaque fois que l’on ne fait pas suffisamment, que l’on ne fait pas comme il faut, que l’on ne mérite pas autant que les autres, que l’on a encore loupé notre chance, que ce n’est pas demain qu’on ira fêter un truc au resto, qui va falloir continuer de galérer un peu. Je nous le demande alors : comment aujourd’hui contrer ces dynamiques concurrentielles ? Est-il possible d’exister tous ensemble, de trouver sa place sans empêcher les autres de prendre la leur ? »
↘ Retranscription complète des échanges :
Camille Bardin
Bonjour à toutes et à tous, on est ravi.es de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu Qu’iels Soient Douxces. Ce soir aux micros de ce studio : quatre membres de Jeunes Critiques d’Art, un collectif d’auteurs et d’autrices libres et indépendant.es ! Depuis 2015 au sein de JCA nous tâchons de repenser la critique d’art comme un genre littéraire à part entière et pensons l’écriture comme un engagement politique. Pour Projets, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu’on a officieusement quand on se retrouve. POURVU QU’IELS SOIENT DOUXCES c’est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d’une problématique liée au monde de l’art puis un échange consacré à une exposition. Aujourd’hui nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger… Luce Cocquerelle Giorgi.
Luce Cocquerelle Giorgi
Salut !
Camille Bardin
Horya Makhlouf.
Horya Makhlouf
Salut !
Camille Bardin
Samy Lagrange.
Samy Lagrange
Bonsoir Camille !
Camille Bardin
Et moi-même, Camille Bardin ! Dans cet épisode on a choisi de parler de l’exposition curatée par Daisy Lambert au Centre d’art contemporain de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne mais avant cela on voulait parler de la concurrence qui impact les rapports dans l’art contemporain et que motivent particulièrement les prix et autres appels à projet. Samy, cela étant dit, je te laisse introduire cette première partie de podcast.
Samy Lagrange
Volontiers. En école d’art, à la fac d’histoire de l’art ou lors de nos premiers stages et petits boulots mal-payés, on a toutes et tous entendu les mêmes phrases : « y a pas de place pour tout le monde tu sais » ; « personne n’arrive vraiment à vivre de l’art » ; « mais t’as un plan B au fait ? ». Dès le commencement, on est découragé-e, et pour celleux qui feront le choix d’essayer de se faire une place dans le monde de l’art, s’ouvre alors l’univers impitoyable de la compétition. C’est comme ça et pas autrement, et il va falloir jouer des coudes. Dans Pourvu qu’iels soient douxces, on a déjà parlé des injonctions à être partout et à tout connaître, à montrer que l’on travaille plus que les autres, à être cool au pays des cool kids. A cela s’ajoute une mise en concurrence institutionnalisée : expositions, prix, résidences, récompenses et appels à projets ne distinguent à chaque fois que quelques heureux élu.es. Ils nous rappellent aussi à chaque fois que l’on ne fait pas suffisamment, que l’on ne fait pas comme il faut, que l’on ne mérite pas autant que les autres, que l’on a encore loupé notre chance, que c’est pas demain qu’on ira fêter un truc restau, qu’il va falloir continuer de galérer un peu. Ces injonctions ne sont pas propres au monde de l’art mais, comme partout, la compétition devient cruelle lorsqu’elle est l’écho de la précarité systémique. Pour conjurer le sort qui nous fait croire qu’on est nul.le parce qu’on n’a pas curaté une exposition au Palais de Tokyo, qu’on a été repéré.e par personne ou qu’on a pas gagné le prix du jeune artiste de l’année, on peut déjà essayer de partager nos expériences, nos frustrations et quelques-uns de nos espoirs. Je nous le demande alors : comment aujourd’hui contrer ses dynamiques concurrentielles ? Est-il possible d’exister toustes ensemble ? De trouver sa place sans empêcher les autres de prendre la leur ?
Camille Bardin
J’adore ton intro. Il y a des sourires sur les visages de tout le monde. Qui commence ?
Horya Makhlouf
Des sourires un peu crispés quand-même.
Camille Bardin
Oui bah quand même faut pas déconner. [Rire]
Horya Makhlouf
Oui parce que c’est vrai que ce que tu dis est assez violent. En même temps, c’est notre monde qui est violent. Oui, moi, je me pose la question de savoir comment contrer ce système hyper concurrentiel, hyper capitaliste en fait et hyper bah violent quoi. C’est une violence qui s’applique par-dessus toutes les autres violences qu’on subit aussi au quotidien, qui sont évidemment d’ordre économique, mais qui sont aussi d’ordre de beaucoup de choses, qui touchent à notre légitimité, à nos corps, à nos pensées, à nos savoirs, à nos vécus, à tellement de choses différentes. Ce système de prix, j’ai l’impression qu’il est tellement lié à l’histoire même du monde de l’art et du monde de l’art comme on le connaît aujourd’hui. En France… Bon je refais ma petite historienne de l’art.
Camille Bardin
Oui, il y a toujours un petit passage. [Rire]
Horya Makhlouf
Il y a toujours ce passage, c’est vrai. [Rire] Mais bon. En France, on vit quand même sur cet héritage du Grand Prix de Rome, de l’Académie royale de peinture et de sculpture qui était pendant jusqu’à la Révolution française et en fait, non, même plus tard, jusqu’aux Impressionnistes et à la toute fin du XIXᵉ siècle, l’Académie et les instances et les académiciens, des hommes blancs bien lotis de manière générale et bien nés, qui décidaient de ce qui était beau ou pas beau, ce qui avait le droit de recevoir un prix ou pas, les personnes qui avaient le droit de vivre de la peinture ou pas, qui avaient le droit d’aller à Rome. Donc le Grand Prix de Rome, c’était la consécration la plus ultime de toute carrière qui permettait d’entériner complètement les carrières de peintre absolu, que ce soit avant la Révolution française auprès de la Cour des rois et après la Révolution française auprès de la République et des différents régimes que la France a connus à ce moment-là. C’est compliqué de sortir d’un système qui est ancré depuis si longtemps et duquel on essaye de sortir au fur et à mesure, mais avec des institutions qui sont quand même toujours, même si elles se renouvellent, même si elles posent de plus en plus la question sur le débat public, qui sont toujours aussi héritières de cette économie-là et de ce système de reconnaissance par des gens que souvent, nous, en tant que travailleureuses de l’art, artistes, critiques d’art, commissaires d’exposition, salarié.es aussi des centres d’art et des institutions, on n’est pas forcément toujours OK avec les principes, avec les natures de ces personnes qui sont là pour décider de ce qui est bien ou pas, de ce qui doit être récompensé ou pas et de la manière dont tout ça doit être récompensé. Je n’ai apporté aucune réponse. Je pense juste que c’est vraiment compliqué.
Camille Bardin
En tout cas, il y a un moment donné, tu dis qu’on essaye d’en sortir, justement, de cette… de ce système-là. Mais est-ce que c’est vraiment le cas aujourd’hui ? Justement, est-ce qu’on tache vraiment… Est-ce qu’on est dans cette… Je te lance doucement, Luce. Est-ce qu’on est justement dans cette perspective-là ? Moi, ce n’est pas ce que je ressens. Qu’est-ce que toi, tu aurais à en dire, Luce là-dessus ou sur le reste ?
Luce Cocquerelle Giorgi
Juste faire un petit rappel. Évidemment, ce que tu viens de dire, Horya, il y avait cette dimension publique étatique. Maintenant, il y a énormément aussi de fondations privées qui donnent des prix.
Camille Bardin
Bah c’est ça.
Luce Cocquerelle Giorgi
Il y a une multiplication énorme des prix, à la fois aussi pour différencier certains médiums. Il y a des prix de peinture, de sculpture, de performance, mais en même temps, il y a quand même toujours cet enjeu-là à accumuler les prix, parce que plus on accumule les prix, plus on accumule aussi la valeur monétaire et symbolique.
Camille Bardin
C’est ça.
Luce Cocquerelle Giorgi
Il y a aussi une dimension qui est assez intéressante, qui est un basculement entre la reconnaissance d’une œuvre qui a déjà été créée ou de quelque chose qui s’est montré à un moment donné, justement, a été présenté à un jury et quelque chose qui maintenant te permet de créer. Des fois, il y a des œuvres qui sont produites exprès pour pouvoir être présentées à un jury et la somme qui va être versée, en tout cas le gain, ça va être la production, donc de l’argent pour avoir de la rémunération pour l’artiste ou pour le.a critique ou pour le.a commissaire et pour la production en tant que telle, c’est-à-dire l’achat des matériaux, des outils, etc. Et ça, c’est aussi une dimension qui est assez compliquée parce qu’en fait, les gens, que ça soit les artistes ou les critiques ou peu importe, veulent aussi avoir cet argent-là pour pouvoir continuer leur production. Je pense qu’il y a quand même un petit basculement qui a eu lieu à ce niveau-là où on ne reconnaît pas… Même la carrière d’un.e artiste, là, c’est vraiment pour continuer sa carrière quoi.
Horya Makhlouf
Tu parles de quoi comme prix quand tu évoques ces… ?
Luce Cocquerelle Giorgi
Bah par exemple, le prix Marcel Duchamp c’est ça ? Il y a de l’argent qui est donné.
Camille Bardin
Oui, c’est ça. Je suis contente que tu parles de ça, Luce, parce que c’est vraiment un peu là-dessus que je voulais un peu angler mon intervention, parce que finalement, ce dont tu parles, c’est de travail prospectif. Et en fait, j’ai l’impression que c’est compliqué de lutter contre la concurrence ou le système des prix de manière générale dans l’art contemporain sans être la bonne poire un peu de ce système-là. Dans le sens où le problème, fondamentalement, c’est que le secteur de l’art contemporain repose sur la concurrence de ses acteur.ices, que ce soit les artistes, mais aussi les curateur.ices, les lieux même entre eux, etc. Donc, si tu refuses de te soumettre à ce système-là, il y a de grandes chances pour que tu sois de fait exclu.e de ce même système. Si tu ne candidates pas, jamais tu ne seras exposé.e au Salon de Montrouge ou tu ne profiteras de telle ou telle résidence ou de tel ou tel prix. Cela étant dit, je donnais l’exemple de Montrouge, mais c’est aussi des questionnements qu’on a entre nous au sein de Jeunes Critiques d’Art, pour ce qui est de faire entrer ou non, par exemple, de nouveaux et nouvelles membres. C’est ce que.. C’est que si tu ne proposes pas d’appel à candidature, qui te dit pas que tu ne vas pas rester finalement enfermé.e dans ton cercle et en cela cultiver une espèce d’entre soi ? Est-ce que les appels à candidature, ce ne sont pas aussi un moyen pour les professionnel.les moins visibles de se faire connaître ? Je vous vois toustes lever la main, c’est cool. Vous avez envie de parler derrière, je fais vite. Moi, je pense en partie que le problème, ce n’est pas tant les appels à candidature que les appels à projet, parce que souvent, les appels à projet relèvent du travail prospectif dont je parlais. Et ça m’a fait penser, en fait, la notion, elle a été pas mal médiatisée il y a quelques mois, notamment à cause de Squeezie qui, en fait, changeait de studio, tout simplement. Il allait bosser sur un fond vert et du coup, il parle à sa communauté. Il dit « Bon bah les gars, moi maintenant, je vais bosser sur son fond vert. Donc du coup, je vais faire appel à un ou une graphiste pour me faire mon studio en 3D, etc. Donc s’il y a des graphistes dans ma communauté, proposez-moi des trucs, faites mon studio et je prendrai le meilleur studio. Évidemment, iel sera rémunéré.e., le ou la graphiste sera rémunéré.e. » Et en fait à ce moment-là, lui partait à priori d’une bonne intention parce qu’en plus, il était là genre « Je paye la personne. » Donc je pense, il était complètement… Je me souviens qu’il avait réagi de manière complètement… Il était un peu tombé des nues que tout le monde lui tombe dessus. Et en fait tout le monde, enfin il y a beaucoup de personnes qui avaient dit « Mais en fait, là, ce que tu réclames, c’est du travail prospectif, c’est-à-dire que là, en fait, tu vas faire travailler des gens dans l’espoir d’être potentiellement rémunéré.es. » Et en fait, c’est ça le problème, je trouve, dans l’art contemporain, c’est que souvent, on demande à des gens de fournir un travail dans l’espoir, demain, d’être rémunéré.es. Et ça, c’est terrible parce que premièrement, ça précarise encore plus, parce que pour beaucoup, on bosse pour rien, parce que même si on peut se persuader qu’on pourra faire de la récup et proposer ce même sujet ailleurs, souvent, c’est quand même compliqué à recaser parce que ça demande en plus des trucs très précis et tout. Et ensuite, ça maintient des inégalités parce que la personne rentière qui a la possibilité de consacrer quatre jours de sa semaine au fait de répondre à un appel à projet, elle sera forcément plus privilégiée que celle qui cumule les jobs alimentaires pour bouffer. Donc même si on se dit que ça peut offrir la possibilité à des gens de try hard pour y arriver, etc., rien ne nous dit que la personne qui candidate n’a pas payé un graphiste pour faire un beau portfolio, un critique ou une critique pour lui écrire un super texte, etc. Donc, donc voilà. Du coup, je me demande si finalement, on n’aurait pas une solution à trouver qui viendrait en partie des espaces et des personnes décisionnaires, c’est-à-dire qu’au lieu d’attendre de recevoir 800 portfolios et projets en devenir, on paye 10 personnes de statuts, d’âges, de secteurs et d’horizons différents qui se mettent d’accord en amont sur des personnes à exposer, avec qui travailler, etc. Vous aviez levé la main comme des fous. Qui veut réagir en premier à ça. Peut-être, Samy, vu que tu n’as pas encore parlé, tu avais un truc dans l’immédiat ou tu passes ton tour ?
Samy Lagrange
Ce n’est pas une réaction à chaud sur ce que tu viens de dire. Donc si vous voulez, Horya ou Luce, réagir à ce qu’elle vient de dire.
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui, je…
Horya Makhlouf
Oui, je…
Luce Cocquerelle Giorgi
Chips ! [Rire] Je voulais juste dire que ce que tu mets en valeur là, c’est le travail invisible administratif que font les artistes, mais aussi les institutions culturelles pour obtenir des subventions, par exemple, de l’État ou de recherche de mécénat, etc. C’est quelque chose qui est jamais reconnu et jamais « valorisé », entre guillemets, même si je n’aime pas trop ce terme. C’était juste ce travail invisible que je voulais souligner.
Camille Bardin
Ouais complètement. Horya ?
Horya Makhlouf
Luce, comme d’habitude, je suis d’accord avec toi sur le travail invisible. Avec Luce, on a quand même fondé cet événement incontournable maintenant [Rire] qui s’appelle Vendre la Mèche et dont la première édition était justement sur le travail invisible qu’il faudrait rendre plus visible et qui passe par écrire des mails que jamais on voit, enfin dont on voit jamais le travail que les gens en général reçoivent… Bref, c’est une autre question. Candidater à 1001 appels à projets sans avoir forcément ni le temps à dédier à ça correct, ni la rémunération qui vient récompenser ce travail. Mais j’ai quand même l’impression que ce dont tu parles, Camille, entre appel à candidature et prix, ce n’est pas exactement la même vibe non plus.
Camille Bardin
J’ai pas tant parlé des prix là. J’ai plus parlé des appels à projet en tant que tels.
Horya Makhlouf
Bien sûr, mais comme justement le glissement s’est fait et qu’au départ, on parlait des prix et qu’on en vient à parler des appels à candidature… Je pense qu’effectivement, il y a une logique qui est la même à l’intérieur de ça, c’est la reconnaissance et par qui elle est attribuée et qu’est-ce que tu es prêt.e à faire pour te la voir attribuée. Parce que que tu réponds à un appel à projet, à un appel à candidature quand il y a un poste qui s’ouvre dans un centre d’art, que ce soit au niveau du commissariat d’exposition, de l’admin, de la prod ou de la médiation et qu’il y a 300 personnes qui candidatent, plus encore quand c’est des institutions qui sont encore plus visibles et que tu sais très bien qu’à l’intérieur de ça, il y a des ami.es, des gens que… Bref, c’est aussi un autre rapport concurrentiel.
Camille Bardin
C’est ça, c’est qu’on ne parle même pas de quand les dés sont pipés, effectivement.
Horya Makhlouf
En tout cas, on parle de ce rapport concurrentiel qui est très important et qui se joue à tellement de niveaux différents. Mais si on revient juste sur la logique des prix, je trouve que c’est quand même une logique un tout petit peu différente. Et il y a plus de manières, il me semble, de contrer cette logique des prix pour l’instant. En fait, je pense que c’est un travail qui doit se mener sur le temps long et de manière systémique comme toujours, puisque de toute façon, tous ces appels, tous ces prix, toutes ces reconnaissances sont de toute façon un peu des symptômes d’un système plus généralisé, qui tend à créer pas mal de violence. Mais sur ce système des prix en particulier, je pense que c’est plus facile de commencer par là pour essayer de déjouer tout un système. Et on en connaît quelques-uns depuis quelques années des prix qui se sont déroulés où les lauréats, les lauréates et les récompensé.es finaux.ales. En général, ça se passe comme ça dans les prix. Vous avez d’abord une série de présélectionné.es, de gens qui font une exposition. Je pense en particulier à deux exemples très précis, un français et un anglais de deux envergures assez différentes : le Prix Utopi.e, qui a été fondé il y a trois ans et dont l’année dernière, la dizaine de lauréats et lauréates avaient refusé de se voir…
Camille Bardin
Attribuer, décerner ?
Samy Lagrange
Distinguer.
Horya Makhlouf
De se voir distinguer, merci. Iels avaient refusé de se voir distingué.es à l’intérieur de cette préselection et sont resté.es à vouloir se partager. Et iels ont écrit…
Samy Lagrange
Ça vient des finalistes, cette décision ?
Horya Makhlouf
C’est ça, oui. Et ça vient de… de toustes ces pré-sélectionné.es qui étaient une dizaine de personnes reçues à travers, je pense, les centaines de dossiers que les jurys ont reçus, ont refusé de se voir distingué.es et qu’une seule personne soit distinguée à la fin. Et iels se sont attri… se sont répartis… ont demandé à se faire répartir la somme qui était attribuée à le ou la lauréat.e. Ça a posé aussi des scissions au sein des pré-sélectionné.es, puisque évidemment, beaucoup de gens sont précaires à l’intérieur, tout le monde n’est pas forcément d’accord pour se faire…
Camille Bardin
Tu fais au prorata…
Horya Makhlouf
Oui, mais c’est difficile encore une fois. Bref, on divague. Mais l’autre exemple dont je voulais parler, c’était aussi un prix qui, pour le coup, a une consécration vraiment internationale et implanté depuis vraiment des dizaines d’années : le prix Turner en Angleterre. Et il me semble que c’était il y a deux ou trois ans également. C’est comme le prix Marcel Duchamp, mais avec un peu plus de visibilité à l’international et un peu plus de… Je ne sais pas… de poids pour les artistes qui sont sélectionné.es et le rayonnement international. Bref. Les quatre lauréat.es ont décidé de – pareil – ne pas se voir distingué.es et d’être tous et toutes finalistes ensemble et d’être toutes et tous prix Turner à ce moment-là.
Camille Bardin
Très chic.
Horya Makhlouf
Je pense que c’est chic et en même temps, ça pose aussi plein de questions. Est-ce que du coup, tous les… Oui, Samy, interromps-moi. [Rire]
Samy Lagrange
C’est vrai qu’il faut faire comme ça, je vous le dis toujours. [Rire]
Camille Bardin
Samy a levé la main et Samy a eu la parole immédiatement. [Rire] Non, c’est vrai du coup, à Samy ?
Horya Makhlouf
À Samy, pour de vrai, je voulais poser ça et je sais que…
Samy Lagrange
C’est exactement sur le même sujet en plus. C’est à ça que j’avais pensé de la même manière qu’Horya a fait un point « histoire de l’art », j’avais prévu un point « études de cas. » C’est aussi au prix Utopi.e auquel j’avais pensé en premier. Pour rappeler, c’est un prix qui travaille à la reconnaissance, à la valorisation et à la déprécarisation du travail des artistes LGBTQIA+. Mais pourtant, ça reste quand même un prix et donc ça rejoue quand même une compétition dans un milieu déjà très marginalisé et plus précaire que les autres dans le monde de l’art. Justement, c’est hyper intéressant ce que tu disais sur cette décision. Je n’avais pas suivi que de la première année, de la première promotion, c’étaient les finalistes qui avaient décidé de ne pas se distinguer et de toustes recevoir finalement le prix, la récompense. Et donc là, je suis allé chercher sur leur manifeste le passage qui parle du prix. Et justement, c’est intéressant parce qu’iels parlent de ce dont tu parlais, de cet héritage assez lourd du concept de prix et de comment iels l’ont retourné. Je vous lis le passage si vous voulez bien.
Camille Bardin
Ouais grave.
Samy Lagrange
« Bien que décrié pour son format historiquement inégalitaire, nous revendiquons ce terme que nous nous réapproprions pour l’utiliser à des fins utiles. Réinvestir ce mot est politique. Le prix Utopi.e se veut équitable. Il prend la forme d’un appel à candidature avec à la clé une exposition collective réunissant dix artistes sélectionné.es par un jury pluridisciplinaire et transgénérationnel. Au-delà de l’exposition, les artistes perçoivent la même dotation financière, les mêmes frais de production ainsi que des opportunités d’exposition en musée, galerie et des résidences. En réinvestissant ce terme, nous en proposons une nouvelle lecture, une nouvelle manière de l’habiter. Le recours au prix est avec un moyen… Pardon. Le recours au prix avec… Il y a des fautes. C’est pas moi. C’est un copié/collé. [Rire] C’est un moyen d’encourager et d’accompagner des artistes qui ont peu ou pas accès à des espaces institutionnels et aux grands-rendez vous culturels. Avec le prix Utopi.e, nous célébrons les 10 artistes sélectionné.es de la même manière. » Donc c’est intéressant de savoir que finalement, iels se sont également réapproprié une décision qui n’était pas la leur, mais qui venait des finalistes. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c’est que là, ce qui est dit, c’est qu’on se réapproprie consciemment le terme comme un outil de résistance à ce système capitaliste qui promeut la distinction et la compétition, mais au final rejoue quand même la compétition dans un milieu déjà marginalisé et précaire, parce qu’un prix, quoi qu’il arrive, même si on le parasite de l’intérieur, ça reste quoi qu’il arrive… quoi qu’il arrive, un prix à la fin.
Camille Bardin
Mais oui carrément.
Samy Lagrange
Juste pour finir, je vous redonne la parole.
Camille Bardin
Non mais vas-y tu as le temps.
Samy Lagrange
J’avais pensé mon deuxième cas, c’était de penser pas pour un prix, mais pour des résidences à la maison Artagon.
Camille Bardin
Ouais j’étais sûre.
Samy Lagrange
Précisons qu’on n’est pas totalement neutres quand on parle de ça, parce qu’Horya et Camille, vous êtes déjà passées par le programme de la maison Artagon et que j’y vais en juillet. [Rire] Mais du coup, c’est est une offre de résidence qui permet trois fois par an à une cinquantaine d’acteur.ices du monde de l’art de venir travailler quelques semaines dans le Loiret sans obligation de rendu. Donc, qui sont déjà trois bons points. C’est-à-dire que c’est un appel qui court trois fois l’année, qui permet d’enlever cette dimension événementielle de souvent une fois par an ou une fois tous les deux ans d’avoir un grand prix qui fait participer à peu près entre 40 et 50 professionnel.les du monde de l’art à chaque fois, donc déjà qui brasse assez largement et qui évite la compétition et la distinction d’un.e seul.e lauréat ou lauréate. En plus, c’est quelques semaines et il n’y a pas de rendu, donc il n’y a pas d’obligation de travail.
Camille Bardin
Tu peux même y aller pour te reposer.
Samy Lagrange
Exactement.
Luce Cocquerelle Giorgi
Êtes-vous payé.es ?
Camille Bardin
Non, ce n’est pas payé.
Samy Lagrange
Eh ben voilà. Ça quand même, c’est limite parce que quand tu y penses, ça reste en plus déjà un concours. Il faut quand même candidater à la maison Artagon, donc il faut envoyer un dossier, même s’il n’est pas le plus léger possible, mais il est plus léger qu’à l’habitude qu’on a dans ce genre de concours, mais ça reste un concours qui offre le droit à une résidence qui n’est ni rémunérée ni défrayée.
Luce Cocquerelle Giorgi
Est-ce donc une résidence ?
Samy Lagrange
C’est bizarre parce que quand j’en parle, les gens qui sont extérieurs au monde de l’art disent « Mais c’est pas une résidence si ce n’est pas payé, c’est pas possible. » Et quand tu es à l’intérieur, tu essaies de faire le tour des résidences qui sont payées et des résidences qui sont payées sans obligation de rendu. Je crois que je n’en connais aucune.
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui, mais pour moi, une résidence, c’est censé faire de la production, donc c’est censé accompagner quelqu’un ou quelqu’une à faire quelque chose.
Horya Makhlouf
Il y a des résidences de recherche aussi.
Luce Cocquerelle Giorgi
Il y a des résidences de recherche, mais on rémunère aussi. On rémunère aussi les gens.
Samy Lagrange
Oui qui devrait être payées aussi. La recherche est un métier ! [Rire]
Camille Bardin
Ah bon Samy ? [Rire]
Samy Lagrange
Voilà tout ça pour dire qu’en gros, même quand on regarde les structures qui essayent un peu de parasiter ce concept de prix et de le retourner, de se le réapproprier, peu importe le vocabulaire, tant que tout le monde ne peut pas y avoir accès de manière égalitaire et démocratique, le système de prix, ça ne marche pas. Mais comme tu dis, je suis totalement d’accord avec toi, quand t’as refait l’histoire, on est ancré dedans. C’est paradoxal parce que c’est notre moyen premier pour valoriser, rémunérer, accompagner et déprécariser les acteur.ices du monde de l’art. Et pourtant, c’est paradoxal depuis la définition parce que ça exclut et distingue les acteur.ices du monde de l’art.
Camille Bardin
Bah ouais. Du coup, je voulais juste… Ça m’a fait tilter du coup quand t’as parlé du prix Utopi.e parce que, il y a deux ans maintenant, on m’a proposé d’être membre du jury de ce prix-là. Là, j’ai fait face à un choix cornellien dont je pense que je vous ai toustes déjà parlé autour de cette table parce que vraiment, ça m’a pris la tête. Je me disais que si j’accepte, j’accède déjà… Parce que du coup, il y a ça aussi, les prix courent encore parce qu’il y a des personnes qui acceptent toujours d’être membres des jurys de ces prix-là. Parce que ça permet d’accéder, en l’occurrence dans ce cas-là, peut-être à des centaines de portfolios d’artistes qui travaillent potentiellement sur mes propres sujets de recherche. Donc une mine d’or, clairement, pour la critique et curatrice que je suis. Aussi, ça favorise ma propre carrière dans le sens où on m’accorde la possibilité de choisir. On me donne une légitimité qui coûte très très cher dans notre secteur. Mais si j’ai fini par refuser après de longs mois d’hésitation, etc., c’est parce que fondamentalement, je ne pense pas que mettre en concurrence des artistes qui plus est déjà minorisé.es, mis en minorité notamment, ce soit une bonne chose. Et du coup, là, on parle de retournement, etc., de… Enfin, je suis vraiment, vraiment pas convaincue. Et puis, ça pose aussi la question de la sélection. Qui postule ? Le mec cishet qui proclame le fait que son travail soit un travail queer ? Est-ce qu’on va demander la situation amoureuse ou l’identité de genre des personnes qui postulent ? C’est quand même hyper compliqué. Bref, c’était un truc perso, mais en vrai, je suis toujours… Je sais toujours pas quoi faire de ce prix-là et je ne suis vraiment pas convaincue que ce soit une bonne solution et que la pirouette de « on retourne le truc pour se le réapproprier » soit une bonne chose, sachant que c’est aussi notre travail d’envisager aussi de nouvelles manières de faire et de nouvelles manières d’envisager notre travail, tout simplement. Horya ?
Horya Makhlouf
Camille, je suis contente que tu abordes ce sujet des jurys, puisque je pense que c’est aussi un des traits les plus problématiques des prix. Par qui tu veux être jugé.e ? Par qui tu veux être récompensé.e ? En général, quand tu postules à un prix, tu connais pas encore l’organisation du jury qui est révélée quelques semaines, quelques mois après, parfois après que la clôture pour candidater à ce prix ait été sélectionnée. Et là, on parle des prix qui sont attribués de manière publique auxquels il faut candidater, mais il y a aussi des prix qui sont attribués dans l’ombre, où il y a des personnes qui sont chargées d’être les rapporteuses de présélectionner des gens.
Camille Bardin
Ah ça m’énerve…
Horya Makhlouf
Oui, mais en même temps, je te vois souffler Camille, mais de l’autre côté, au moins, ça ne demande pas aux gens de préparer tout ce travail de portfolio.
Camille Bardin
Oui oui, tu as raison. Complètement.
Horya Makhlouf
Je ne sais pas si ça peut être une piste.
Luce Cocquerelle Giorgi
C’est un truc de co création aussi.
Horya Makhlouf
Oui, complètement.
Camille Bardin
Et puis, c’est le boulot des curateur.ices, de faire des choix quoi.
Horya Makhlouf
Je me dis, est ce que ça, ça pourrait… En vrai, je ne sais pas. J’avoue que je n’ai pas de réponse. J’aimerais bien continuer à en discuter pendant… Et qu’on crée des espaces de discussion, de remise en démocratisation de tout ce système du monde de l’art, qui, on le sait, est vraiment très vicieux, très sclérosé à plein de niveaux différents. Et si on veut atteindre ce que tout le monde n’arrête pas de dire dans tous les moyens, la démocratisation de l’art, essayer de vivre de manière… Bref, tous ces beaux idéaux du monde de l’art dans lequel on a décidé d’essayer de survivre. La question des jurys, elle pose quand même beaucoup de problèmes et je trouve que c’est aussi ça qui distingue les prix des appels à candidature ou des appels à… juste des candidatures à un poste aussi. Tu ne sais pas par qui tu vas être jugé.e. Parfois, tu sais par quelle institution et c’est d’elle que tu veux obtenir la reconnaissance aussi. Je pense que c’est un problème aussi en soi. Et du coup, ça me fait poser la question, pourquoi est-ce qu’on continue à postuler à des prix ? Je pense que c’est ce que vous avez évoqué plus tôt et moi, je vois trois enjeux vraiment principaux. C’est d’un côté ce besoin de reconnaissance qui, en fait, on a beau dire ce qu’on veut, il reste quand même assez inévitable. Je pense qu’il est entretenu par énormément de choses et à tellement de niveaux qu’il dépasse aussi le simple monde de l’art. Mais ce besoin de reconnaissance, c’est un peu pour l’estime de soi, c’est un peu pour son regard sur soi, sur le monde de manière générale, avoir le sentiment d’intégrer une communauté, un monde, une société, d’être quelqu’un.e d’important.e. Et c’est complètement, je pense, naturel. Il n’y a rien qui est naturel, tout est toujours construit. Mais bon ça vient quand même d’un truc comme ça. De l’autre côté, il y a ce besoin évidemment d’économie. Évidemment qu’un prix, ça va t’apporter de la visibilité et/ou de l’argent. Ça va être un pont, forcément, dans ta carrière institutionnelle ou… Parce qu’en général, c’est plutôt comme ça que tu aies choisi, le côté institutionnel ou plutôt marché de l’art et qui sont parfois liés, mais très souvent très poreux. Hum…
Camille Bardin
Troisième point.
Horya Makhlouf
J’avais un troisième élément, j’ai oublié.
Samy Lagrange
Oui tu as levé trois doigts.
Horya Makhlouf
Oui, j’ai levé trois doigts.
Camille Bardin
Tu nous as vraiment teasé un troisième point. Donc là… [Rire]
Horya Makhlouf
Attends, vraiment faut que je le retrouve. Reconnaissance, argent…
Camille Bardin
Gloire et Beauté ! [Rire]
Luce Cocquerelle Giorgi
Et l’amour ! [Rire]
Horya Makhlouf
Bon. Je ne me souviens plus exactement de mon troisième point, mais je dirais que c’était peut être un mix des deux. Entre argent et reconnaissance et économie. Et en fait, juste genre continuer d’exister et continuer de croire que tu peux vivre de cette économie-là aussi. Et à l’intérieur de tout ça, ça se mêle. Bref, tout ça pour dire, je n’ai aucune réponse à comment contrer ce système de prix, à part juste les supprimer complètement et faire en sorte de subventionner tous les artistes de la même manière en créant, par exemple, l’intermittence des artistes..
Camille Bardin
Oui !
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui !
Horya Makhlouf
..et des commissaires d’exposition et des critiques d’art. Et arrêter…
Camille Bardin
Arrêtez de nous foutre des trucs type Mondes Nouveaux à la con…
Horya Makhlouf
Tout à fait.
Camille Bardin
Pardon. [Rire]
Horya Makhlouf
On peut parler aussi de ça, Mondes Nouveaux qui n’est pas forcément un système de prix aussi, mais en exemple de contestation qui a été ultime, on peut parler de cette soirée de contestation qui a eu lieu aux Beaux-Arts de Paris au moment de l’inauguration de l’exposition des projets lauréat de Mondes Nouveaux, édition 2021-2022, où des étudiants, des étudiantes et des…
Camille Bardin
C’était le Le Massicot, SNAP cgt et La Buse.
Horya Makhlouf
..et des syndicats du monde de l’art, car ils existent quand même, rejoignez-les !
Camille Bardin
Ouais Snap CGT, oui !
Horya Makhlouf
Ils ont dénoncé cette… Ont dénoncé tout en… Bref, leur manifeste est trouvable sur Internet. Cherchez-le, il est important. J’arrête parce que j’ai dépassé mon temps de parole. Merci.
Camille Bardin
Luce, à ton tour.
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui, je crois que j’avais deux choses à dire. La première, c’était aussi une étude de cas. C’est celle de… Tu parlais tout à l’heure du Salon de Montrouge, Camille, il y a Florence Jung qui a été à un moment donné dans ce salon et qui a fait une œuvre un peu humoristique, provocatrice, où elle a refusé un peu ce système-là, même si elle a quand même accepté d’être dans ce salon, puisqu’elle a demandé à une cheffe de venir faire vendre comme un traiteur dans le salon. Et les gains qu’elle a reçus grâce à cette location d’espace à cette cheffe cuisinière, elle a distribué les gains à l’ensemble des participants, participantes du Salon de Montrouge. Et donc, il y avait quelque chose contre l’élitisme, justement, et la réattribution de l’ensemble des prix en disant que l’oeuvre, c’était, il me semble… « Prix Jung : Ici pas de perdant. »
Camille Bardin
Trop bien. Ok. Que des gagnants !
Luce Cocquerelle Giorgi
Que des gagnants. La deuxième chose que je voulais évoquer, c’était aussi, est-ce qu’on peut en vouloir aux personnes qui continuent à participer à ces prix ou à faire ces appels à projets ? Personnellement, je ne pense pas, même si je n’arriverai pas à faire certaines choses que d’autres personnes peuvent faire. Mais je pense que l’éthique de chacun, chacune est aussi parfois différente ou on met le curseur en tout cas de manière différente. Voilà.
Camille Bardin
Samy, à toi la tâche de conclure.
Samy Lagrange
Oui. Difficile de conclure et effectivement, moi aussi, il y aurait plein de choses sur lesquelles j’aurais voulu m’apesantir avec vous, notamment le collectif. Est-ce que… Tu avais commencé à en parler, Camille. Est-ce que le collectif est vraiment un bon outil de résistance à la compétition ? Sûrement oui et non, mais bon, on en parle à chaque fois un petit peu, donc finalement.
Camille Bardin
Oui, on va faire cet épisode sur les collectifs !
Samy Lagrange
Mais je voulais peut être conclure sur ce que j’appellerais, ce n’est peut-être pas moi qui l’ai appelé, mais…
Camille Bardin
Allez, vas-y, on te l’accorde. [Rire]
Samy Lagrange
L’idée de starification dans l’art contemporain, c’est bizarrement la première chose à laquelle j’ai pensé quand on a réfléchi à ce sujet, c’est que même s’il y a vraiment, on le sait, plein de personnes qui sont compétentes, qui font plein de trucs dans ce monde de l’art, que ça soit des artistes ou des professionnel.les du monde de l’art, les institutions de tout ordre se rabattent constamment sur les quelques étoiles montantes du moment, sur des personnes qui ont été récemment adoubées par un prix ou une certaine médiatisation. Et on les dirige ainsi en star du microcosme de l’art contemporain et elles trustent à un moment donné toutes les opportunités du milieu sur une période de quelques mois ou de quelques années. Elles sont de tous les prix. On parlait des prix de pas savoir qui va nous juger. Souvent, il y a toujours la même personne pendant trois ans, donc on sait très bien qui elle est. Elles sont de toutes les prix, de toutes les expositions, de toutes les conférences. Du coup, les artistes et les professionnel.les de l’art talentueux.ses sont partout. Et pour moi, ne miser que sur quelques-uns ou quelques-unes relève d’une stratégie qui est assez feignante de la part des institutions qui privilégient l’effet de com’ à une vraie proposition artistique qui, si elle est réussie, de toute façon, se distinguerait même sans tête d’affiche. C’est une solution assez light, mais c’est déjà un état d’esprit à avoir, de tout simplement penser à faire tourner, parce que si on fait les choses bien, ça marche et du coup, on n’a pas besoin de toujours capitaliser sur les mêmes personnes.
Horya Makhlouf
Oh ! C’est trop beau ce que tu dis. [Rire] Non mais c’est trop beau. J’aimerais trop que ce soit trop vrai aussi. Mais c’est surtout trop beau !
Samy Lagrange
C’est un petit peu ça ma conclusion. Moi aussi j’aimerais bien que ça soit trop vrai, que ça soit aussi facile à dire qu’à faire, mais c’est pas si simple. C’est comme une bouteille à la mer.
Camille Bardin
C’est pas mal comme ouverture. Moi, ça me va de finir là-dessus.
Horya Makhlouf
Merci Samy !
Camille Bardin
Est-ce que je peux lancer désormais Horya pour notre deuxième partie d’épisode ? Ça vous va ?
Luce Cocquerelle Giorgi
Allez !
Camille Bardin
La deuxième partie de l’épisode, qu’on consacre à l’exposition de Daisy Lambert, mais tu vas nous le dire, donc je te laisse.
Horya Makhlouf
Dans cette deuxième partie du podcast, on parle d’une exposition, celle qui a lieu en ce moment au CAC Bretigny, Centre d’art contemporain à Bretigny-sur-Orge, en plein cœur d’Essone, et qui fermera le 1ᵉʳ juillet. Ça nous laisse quand même pas mal de temps.
Camille Bardin
Oui, pour une fois.
Horya Makhlouf
Le titre de l’exposition qui a été commissariée par Daisy Lambert est « Partir du muscle ». C’est une référence à la philosophe politique Elsa Dorlin et à une théorie qu’elle propose dans son livre « Se défendre, une philosophie de la violence.» Partir du muscle c’est partir d’un élément invisible derrière la peau du corps : les affects et les sensations, et c’est la façon dont on peut, par eux, éprouver des phénomènes de luttes, de peurs et de violences. Dans sa note d’intention et dans son texte d’exposition disponible sur internet et dans le communiqué de presse, Daisy Lambert mentionne également le principe « d’autodéfense différée » qui a été aussi théorisé par Elsa Dorlin. C’est le fait de réagir et de se défendre contre les violences subies dans un autre temps que celui dans lequel elles ont lieu. C’est à partir de ces deux éléments et de la résidence curatoriale que Daisy Lambert a menée pendant un an et demi dans le centre d’art qu’elle a formulé cette exposition. Daisy Lambert a été invité en résidence de recherche et de production, rémunérée par le centre d’art contemporain de Brétigny. Elle a été invité à investir le lieu, à y réfléchir, à y enrichir et à dérouler sa pensée. Elle y a invité à son tour des artistes, elle s’est fait accompagner elle-même par les équipes du centre d’art, a été en relation avec elles et eux, avec leur vie quotidienne, celle du centre d’art mais aussi celle des publics qui viennent ou qui ne viennent pas au Cac Bretigny. Mais aussi avec ses actions plus cachées du grand public : l’éducation artistique et culturelle, les ateliers de médiation que mènent certains des artistes, certains et certaines des artistes invité.es par les lieux, dans des espaces qui sont différents de celui de l’exposition : collèges, lycées, prisons, écoles, associaitons, etc. Ce sont des missions sur lesquelles on ne communique pas beaucoup dans les communiqués de presse qui annoncent les expositions mais qui sont la moitié – ou plus parfois – de la vie des centres d’art. Et je trouve que c’était intéressant de le noter. Bref. C’est le fruit de tous ces éléments qui est proposé dans le parcours qu’a pensé Daisy Lambert. Elle les envisage comme une « généalogie ». Elle le dit dans son texte encore une fois, des stratégies d’autodéfense et des manières dont les corps des artistes qu’elle a cotoyés ont habité les espaces dans lesquels ils ont circulé, comment ils ont interagi avec d’autres corps, comment ils ont répondu ou résisté aux corps notamment des institutions dans lesquels ils ont circulé. C’est difficile de mettre à plat un travail de si longue haleine que celui qui a été mené pendant un an et demi, qui est parti dans autant de directions différentes. C’est donc difficile aussi pour l’exposition d’exprimer tout ça en un seul parcours qui est nécessairement figé avec des œuvres terminées, même si les textes disponibles ici et là, il n’y a pas de cartel dans l’exposition, il faut donc aller les chercher, même si ces textes nous disent bien que certaines sont toujours en cours… Bref, toutes ces rencontres ont donné un parcours très hétéroclite, à l’image des différentes manières de résister aux différentes violences que l’on peut subir tous les jours, dans le monde de l’art et dans celui plus large qui l’entoure : qu’elles soient raciales, classistes, sexuelles, ou toutes en même temps. Et une dernière partie, de toute petite description, juste pour mentionner les artistes qui sont présent.es dans cette exposition et les pratiques qui vont aussi bien de la vidéo, à la peinture, l’installation, le djaying, la publication, le dessin ou encore la performance… On trouve dans ce parcours qui quand même a une très jolie scénographie, qui lie les œuvres ensemble dans un espace en même temps qu’elle donne à chacune l’espace nécessaire pour exister seule de manière autonome. On trouve : Zine Andrieu et Fanny Souade Sow, Geneviève Dieng, Samir Laghouati-Rashwan & Trésor, Projet_51_, Elsa Prudent, Sacha Rey, Johanna Rocard et SOÑXSEED. J’ai beaucoup parlé. Donc je vais vous laisser réagir peut-être et commencer par me dire ce que vous en avez pensé.
Camille Bardin
Je ne sais pas si c’est parce que j’ai Luce en face de moi, mais du coup, je t’ai vu faire des grimaces, des sourires, çà et là, comme ça. Donc est-ce que tu veux commencer ?
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui. Je trouve que ce que tu dis là, Horya, en tout cas, ce qui m’interpelle, c’est le fait que l’exposition soit vraiment très, très liée aux résidences, aux différentes résidences qui ont eu cours dans ce centre d’art. C’est quelque chose qui est invisibilisé la plupart du temps. Je trouve que c’est assez beau, par exemple, qu’il y ait des pièces qui ont été produites dans le centre d’art à partir d’ateliers, comme c’est le cas pour la vidéo de Johanna Rocard. C’est des choses qui sont belles à voir. Moi qui travaille en production, c’est quelque chose qui, en tout cas, me rend joyeuse. Je pense que c’est en tout cas le point le plus positif que j’ai pu noter. C’est peut-être un peu dur de le dire comme ça mais… [Le plus positif] de l’exposition, même si je trouve que les pièces qui sont présentées sont très chouettes à plein de niveaux et à plein d’endroits. Mais j’avoue que je ne suis pas tellement d’accord avec toi au niveau de la scénographie.
Camille Bardin
Ouais…
Luce Cocquerelle Giorgi
Je suis un petit peu sur ma faim à ce niveau-là. Je trouve que c’est une exposition qui parle justement de choses qui m’intéressent, le corps, les sensations, les émotions, la rébellion, les rituels. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m’a semblé très désincarnée. Évidemment, c’est l’effet aussi white cube. Pour moi, ça a manqué de quelque chose de plus vivant. Oui, on a quelques vidéos, mais en réalité, pour moi, ça rend pas les choses assez corporelles. Et peut-être quelque chose à noter, mais on en parlera peut-être à d’autres niveaux… Moi, j’ai été assez surprise de voir certaines œuvres les unes à côté des autres. Le dialogue, pour moi, était parfois incompréhensible, voire un peu mal amené. Je pense notamment, par exemple, au projet de… À Projet_51_, dont les témoignages sont assez forts, qui parle justement de femmes qui sont en prison, avec justement quelque chose de très rituel et performatif. Et juste à côté, la playlist de Johanna Rocard, qui est quelque chose qui est très léger. J’entends évidemment le côté du rituel aussi, de la musique, de l’underground, de toute cette dimension festive, mais pour moi, ça a un peu pêché à ce niveau-là.
Camille Bardin
Samy ?
Samy Lagrange
Je suis à 100 % d’accord avec Luce, je crois, que ça soit sur le positif ou sur le négatif. Effectivement, la première chose qui m’a interpellé, c’est que c’est, selon moi, une exposition qui s’offre vraiment pas facilement, mais qui se mérite. Elle est extrêmement pauvre scénographiquement, selon moi aussi, et très précautionneuse dans sa médiation. Évidemment, il y a des difficultés à l’immersion qui s’expliquent par des choses extérieures qui tient à un espace en plateau qui est vraiment pas facile à investir. On est directement dans les offres dès qu’on passe la porte, donc c’est un peu dur de se projeter. On ne sait pas où est l’espace d’accueil par rapport à l’espace d’exposition. Le sujet est complexe, même si tu l’as très bien expliqué, c’est déjà un concept qui… Je ne sais pas si tu l’as dit aussi, mais elle parle du concept de corpoliteracy.
Horya Makhlouf
Non, je ne l’ai pas dit.
Camille Bardin
Tu peux nous expliquer, s’il te plaît ? Tu as fait un refus d’obstacle. [Rire]
Samy Lagrange
Moi, je me misais sur l’introduction pour que le concept soit explicité. [Rire] Mais en gros, c’est de repenser… Toi, tu as le petit fascicule ? C’est un concept qui vient d’un auteur dont je n’ai pas le nom.
Camille Bardin
D’un curateur, en fait.
Samy Lagrange
Oui, et du coup qui déplace d’ailleurs ce sujet, ce concept un peu plus loin d’Elsa Dorlin, qui est un peu un topos du moment. Là, c’est le concept de corpoliteracy qui est théorisé par Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. J’espère que je prononce bien. C’est une notion, je cite le texte, « qui s’inscrit dans une pensée décoloniale, c’est-à-dire dans un effort critique à prendre de la distance avec des savoirs et modes de pensée systémiques, hégémoniques et dominants. Il s’agit d’interpréter les corps comme une plateforme qui acquiert, stocke et diffuse des connaissances différentes de celles produites par la pensée. » Donc en gros, c’est… Je vais très mal… Je m’excuse auprès de la commissaire, je vais très mal le…
Camille Bardin
Non mais bravo déjà, tu es bien courageux, je trouve.
Samy Lagrange
Le re-théo… Pas le re-théoriser du tout. [Rire exaspéré]
Camille Bardin
Pas le rethéoriser. [Rire]
Samy Lagrange
Le redonner. C’est de considérer que les événements extérieurs s’ancrent dans nos corps et que nos corps peuvent être une plateforme, comme il est dit dans la citation, d’expression de la résistance, de la résilience et du combat et qu’on peut développer, diffuser de nouveaux savoirs plus intimes et de nouvelles manières de communiquer par le corps. C’est un concept qui est en soi très intéressant, mais très complexe, qui n’est pas facile à aborder avec une exposition finalement assez courte. À la base, avant, j’étais en train de trouver plein d’excuses à la difficulté d’immersion dans cette exposition. Il y a aussi le truc… le « truc »… Moi aussi, je suis un peu… Il y a aussi le fait que les œuvres ne s’offrent pas non plus très facilement parce qu’elles ne sont pas des œuvres qui s’inscrivent vraiment dans l’espace, mais plutôt dans le temps. Donc, il faut faire un vrai effort. Il faut vraiment s’auto immerger dans l’exposition. Il faut prendre le temps de découvrir les œuvres et toute la profondeur de leurs propos. Concrètement, ça veut vraiment dire qu’il faut aller plusieurs fois s’asseoir par terre, mettre un casque audio, découvrir des vidéos ou des documentaires sonores et prendre le temps de lire le fascicule avec des mini interviews de chaque artiste par la commissaire. Et une fois qu’on a fait ça, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, je trouve. Les artistes ont des angles très précis et très pointus d’entrée dans le sujet. On n’essaie pas de faire un tour d’horizon de tous les corps en résistance, mais on entre dans le sujet par des thèmes choisis et éclectiques. Perso, moi, j’ai beaucoup aimé, par exemple, je crois que tu en parlais, toutes les œuvres qui se réapproprient le rituel comme outil de résistance, comme le projet New Skins for Very Old Ceremonies de Johanna Rocard, qui a recréé un rituel de fête déguisée avec les enfants d’une école de la région. Pour elle, le rituel et les fêtes sont une forme de résistance à l’oppression ou à la crise, à toutes les peurs que tend à nous confisquer le système capitaliste et qu’il faut savoir retrouver et célébrer à nouveau. J’ai trouvé ça hyper cool, hyper beau, hyper joyeux et hyper empouvoirant. Mais juste pour finir, franchement, je pense que j’aurais quand même eu besoin d’un autre travail de scénographie. Je ne sais pas si c’est vraiment un choix de la commissaire ou un manque de budget qui vient directement du Centre d’art.
Camille Bardin
Peut-être un peu des deux non ?
Samy Lagrange
Moi, personnellement, je suis un petit peu fainéant. J’ai besoin d’être pris par la main pour plonger dans un monde que j’ai ensuite envie de découvrir et d’explorer. Je pense que Camille, tu vas en parler, mais il y avait des trucs un petit peu simples pour l’immersion. Pour rebondir encore sur un truc que tu disais, Luce, je pense qu’il y avait un truc aussi à faire. Je ne veux pas réinventer l’exposition. C’est facile, d’arriver après et de critiquer facilement avec des bonnes idées après que tout un travail de plusieurs années ait été monté. Mais par exemple, vu qu’il y a beaucoup d’œuvres qui se découvrent avec un casque et qui font la part belle aux sons et à la vidéo, moi, je pense qu’on aurait pu penser à un accompagnement avec un casque en mode visite audio de musée, même si ça peut paraître très banal et un petit peu caduc. Mais je pense que ça aurait vraiment marché dans un truc beaucoup plus immersif.
Camille Bardin
De ouf.
Samy Lagrange
Et même, tu en parlais aussi, il y a une œuvre avec des chansons de Johanna Rocard aussi. Et je pense qu’on aurait pu aussi penser à un accompagnement musical, parce que la musique est un terrain d’expression des luttes et des résistances hyper important, des luttes et des résistances par rapport au corps hyper important en ce moment. Donc je pense que même un truc immersif par le son aurait vachement bien marché. Après je pense que je suis totalement matrixé par l’exposition Pierre et Gilles à la Philarmonie de Paris d’il y a quelques années qui m’a fait ré-aimer la musique qu’il y a dans les expositions. Mais voilà. En gros, voilà.
Horya Makhlouf
Juste sur la musique, c’était une toute petite incise pour dire que c’était aussi l’objet de cette performance qui a été menée le jour du vernissage par SOÑXSEED et qui, justement, incarnait ce rituel de résistance possible à travers la musique. Petite incise, c’est terminé. Oui, c’était merveilleux. Bravo SOÑXSEED !
Camille Bardin
Non, mais du coup, je vous rejoins complètement là-dessus, dans le sens où j’étais un peu déçue également par la scénographie qui a été proposée. Parce qu’en fait, j’ai ressenti, j’ai eu la sensation tout au long de la visite de l’exposition, que c’était avant tout une exposition pensée par une chercheuse plus que par une curatrice, alors que Daisy Lambert, on le sait, est une curatrice, elle mène un travail… J’avais très très très hâte de voir cette exposition parce que je suis de loin son travail. Je suis assez curieuse de voir ce qu’elle allait proposer. Donc j’avais vraiment hâte. Mais voilà, j’ai un peu eu cette sensation là, à savoir que dès qu’on rentrait dans le centre d’art, toutes les œuvres s’offraient à nous. Il n’y avait presque aucun espace de repli, aucun espace un peu plus intime, etc. Je suis rentrée dans l’espace et je ne savais même pas par où commencer, parce que j’étais directe dans cette grande salle où je voyais d’emblée toutes les œuvres et que je ne sentais pas de geste particulier de la curatrice qui pouvait jouer avec les perspectives, avec les différents points de vue ou que sais-je. Aussi, j’ai trouvé qu’on n’avait peut-être pas assez pensé la monstration de certaines œuvres dans le sens où par exemple le documentaire audio dont tu parlais, Luce, réalisé par le collectif Projet_51_, qui est un groupe de 12 femmes qui s’est constitué au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, c’était un documentaire de 17 minutes qui était pile à l’entrée du Centre d’art, sans assise. Pour l’écouter, il fallait vraiment être debout devant la porte à regarder je ne sais où. Ça, j’ai trouvé que ça a été un peu dommage parce que j’aurais peut être préféré écouter ça dans un espace moins exposé, plus confidentiel ou en tout cas plus protégé des regards et du passage. Le bémol, je voulais parler au début de tous les points positifs, mais juste, vous êtes parti.es là-dessus donc voilà. Après, on n’a pas trop de temps, mais j’ai quand même… En fait, ce que j’ai préféré, c’était globalement, comme vous, c’était l’œuvre de Johanna Rocard, qui était juste folle. Mais je vais te laisser, Horya, il faut qu’on fasse vite. Je te laisse et peut-être que je reviendrai sur cette œuvre que j’ai trouvé trop, trop bien.
Horya Makhlouf
Oui. Effectivement, je suis complètement d’accord avec vous, même si j’ai trouvé la scénographie jolie et assez inclusive et qui permettait de naviguer facilement. Il y a aussi un truc de quand tu découvres les œuvres, le contexte est tellement important et j’avoue que moi, je les ai découvertes… Enfin, j’ai rencontré cette exposition au moment du vernissage, donc il était hyper habité. Le CAC Brétigny, ce n’est quand même pas l’endroit le plus fréquenté du monde tous les jours, mais comme la vie de beaucoup centres d’art. C’est pas du tout pour lui jeter la pierre. C’est juste que voilà. Et en fait au vernissage, les équipes, depuis quelques années, ont pris cette habitude assez régulière de faire des navettes qui partent de François Mitterrand, de BNF, qui amènent gratuitement qui veut jusqu’au CAC Bretigny. C’est vrai que ça permet de ramener tout un groupe de visiteur.euses en même temps et quand même de faciliter ce moment très festif qui est celui du vernissage. Et c’est vrai que du coup, l’espace était très, très habité et tout engageait à aller s’arrêter aussi sur les œuvres. De manière générale, c’est horrible d’arriver à… de considérer les vernissages comme le moment pour visiter les œuvres.
Camille Bardin
C’est pas le plus propice en général.
Horya Makhlouf
Mais après, quand on y va, on passe quand même du temps là-bas en vérité.
Camille Bardin
Et puis c’est joyeux.
Horya Makhlouf
Et on circule. Et c’est aussi à ce moment-là qu’on va visiter les autres expositions. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi dans cette exposition, outre ce travail de médiation et ce travail un peu caché qui certes part un peu dans tous les sens parfois et manque peut-être de lien formel en tout cas, d’un point de vue esthétique, je trouve ça très chouette dans l’idée de réunir autant d’artistes aux pratiques et aux expériences aussi différentes. Mais c’est vrai que dans le fond, fond, fond et dans la forme et dans l’aspect visuel qui se présente, qui est quand même la première chose qui se présente pour n’importe qui qui rentre dans une exposition, est-ce que tu es séduit.e ou pas par la dimension esthétique du truc ? Est-ce que ça te donne envie de rentrer ? C’est vrai qu’il y a des moments où c’est un peu hard. Je suis d’accord avec toi, Luce aussi, quand tu parlais de cette juxtaposition parfois un peu… Je ne dirais pas malhabile, mais en tout cas parfois un peu déconcertante. Bref, tout ça pour dire, je ne veux pas jeter la pierre sur des jeunes artistes, des jeunes commissaires qui sont encore au tout début de leur pratique et qui visiblement ont encore déjà fait un parcours et des recherches assez exceptionnelles, assez pointues et qui, j’espère, sauront entendre aussi ces retours qui, j’espère, ont été assez constructifs aussi pour pouvoir penser aussi peut être ça de… En tout cas, c’est un espace qui pousse à la discussion. Bref, tout ça pour dire moi, cette dimension de la médiation et de l’éducation artistique et culturelle et de sortir un peu ce qui d’habitude remplit beaucoup plus les notes de subventions, les comptes rendus, de choses qu’à la fin de bilan de l’année, les centres d’art remplissent pour pouvoir retoucher leurs subventions et pour pouvoir continuer leurs activités et pour pouvoir continuer à faire venir des publics qui auraient jamais, jamais, jamais le « réflexe naturel », encore une fois avec des guillemets, mais de venir dans ces centres d’art. Bref, montrer ce travail et voir les vraies œuvres d’art aussi et pas juste les comptes rendus d’ateliers que ça permet de créer. Je trouve quand même que c’est une démarche extrêmement intéressante, extrêmement précieuse et qui, en plus, est mise en rapport avec une autre expérience qui est aussi une restitution menée d’ateliers, menée pendant deux ans, qui se déroule juste au sortir de « Partir du muscle », dans l’espace plutôt d’entre deux du CAC Bretigny, dans l’espace de cantine et d’escalier qui monte jusqu’au bar et qui lie le Centre d’art au théâtre, puisque le CAC Bretigny est le regroupement de ce centre d’art contemporain et du théâtre Bretigny. C’est une exposition qui s’appelle « Elle gère » et qui est la restitution de deux… la restitution de conversations sur deux années d’ateliers artistiques en institutions, menée avec pas mal d’artistes, de partenaires, d’intervenants, d’intervenantes qui ont œuvré dans ce territoire du Coeur-Essonne. Juste pour les nommer, puisque c’est toujours important de nommer les gens : Juliette Beau Denès, Morgane Brien-Hamdane, Laura Burucoa, Vinciane Mandrin, Zoé Philibert et des amateur.ices et partenaires du territoire. Et l’exposition a été commissariée par Fanny Lallart et Céline Poulin. Ça a été une publication à l’origine, qui est d’ailleurs très, très belle.
Camille Bardin
Et qui est disponible gratuitement et en libre service !
Horya Makhlouf
Et qui est disponible gratuitement et qui est aussi, il me semble, disponible numériquement. Bref, en tout cas, une très jolie édition qui revient sur des questions, des discussions, différentes formes de… différentes interrogations qu’on peut avoir sur tout ce qui est transmission du savoir. Comment est-ce que tu pratiques un atelier ? Comment est-ce que tu transmets une connaissance d’une personne qui est censée être la sachante, personne qui est censée être l’ignorante ? Bref, toutes ces choses ces questions sont posées, sont parfois répondues, parfois pas répondues. Un peu comme ce qu’on a l’habitude de faire aussi, mais je trouve que c’est important de visibiliser ces questionnements intérieurs, qui plus est, sur un sujet qui, malheureusement, n’intéresse pas du tout autant de monde que ça devrait. [Rire] La médiation culturelle, qui est quand même la clé, et qui est quand même.. Si les centres d’art n’avaient pas leurs publics, est-ce qu’ils continueraient d’exister avec juste nous, les professionnel.les du monde de l’art qui sommes déjà les personnes hyper précaires.
Camille Bardin
Ce serait triste hein.
Horya Makhlouf
Ce serait trop triste. On ne peut pas faire des expositions que pour les commissaires d’expo ou que pour les artistes.
Camille Bardin
Tu m’étonnes !
Horya Makhlouf
Bref, tout ça pour dire, je trouve que cette exposition a énormément de positif et encore plus dans l’ensemble de tout ce qui se propose au CAC Brétigny. Mais c’est vrai que toutes ces ambitions affichées, y compris dans le livret que, du coup, Daisy Lambert et les équipes du CAC Brétigny ont constitué pour accompagner l’exposition. Toutes ces ambitions, elles se manifestent comme ça, mais comme tu le disais, Samy, c’est dommage qu’il faille aller les chercher aussi profondément pour quelque chose qui est justement de l’ordre temps du quotidien. Il y a une espèce de tension qui est pas complètement résolue entre tout ça. Et le livret est vraiment super. On y trouve des interviews, des entretiens qui sont menés avec toustes les artistes, la commissaire d’exposition et qui explique beaucoup de choses sur les œuvres et ce qui ne se voit pas des œuvres. Mais il n’y a aucun cartel dans l’exposition et c’est un vrai problème aussi.
Camille Bardin
Penser à un truc un peu plus immédiat quoi.
Camille Bardin
Et juste, depuis le début, vous parliez… Pour finir et vraiment pour conclure, enfin pour conclure ma partie en tout cas, vous parlez toustes les trois de l’œuvre de Johanna Rocard depuis tout à l’heure, mais je veux faire une petite mention spéciale à une œuvre vidéo qui a été designée en 3D par Zine Andrieu et qui a été le résultat d’ateliers menés par Fanny Souade Sow et Zine Andrieu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et qui investit cet univers qu’on a encore moins l’habitude d’aller fréquenter de manière générale que les centres d’art : les prisons. Prisons dans lesquelles ont été menées, et dans lesquelles sont beaucoup menés avec pas mal de centres d’art, des ateliers de pratiques artistiques qui parfois se passent bien, qui parfois se passent mal, mais qui en tout cas permettent d’enrichir, j’espère tous les partis. Cette vidéo est magnifique. Elle est le récit de fictions et d’imaginaire qui sont déployés pour résister aussi à l’enfermement et pour essayer de ne pas se laisser sombrer à l’intérieur de ça. Les personnes avec lesquelles se sont entretenues, Zine Andrieu et Fanny Souade Sow, ont imaginé des personnages, des stands, ce qu’iels appellent des stands, des points de départ de narration empruntés à l’univers de manga, de jeux vidéo et en particulier de jeux bizarres aventure. Cette vidéo est magnifique d’un point de vue technique, d’un point de vue de tout ce qu’elle raconte. Elle est aussi extrêmement cryptique.
Camille Bardin
Elle est en cours ?
Horya Makhlouf
Elle est en cours. En fait, la série de vidéos est en cours. Cette vidéo est le début d’une série qui va continuer à être menée, j’espère, et qui va nous montrer encore plus de choses aussi belles est inspirées que ça. Bref, tout ça pour dire… Moi, c’est une des œuvres qui m’a beaucoup marquée aussi, mais qui, pareil, était un peu cachée, un peu contre indiquée dans une black box. La vidéo, c’est toujours compliqué à exposer. Beaucoup d’idées, tout ça pour dire c’était quand même une bonne expo.
Luce Cocquerelle Giorgi
Oui, je rebondis juste. Pour moi, en tout cas, les œuvres qui étaient présentées, ce n’est pas le problème. Les œuvres, pour moi, étaient très intéressantes à plein de niveaux. Il y avait des choses qui étaient très belles. Il y avait des choses qui étaient très habitées aussi. Mais pour moi, c’est plutôt le dialogue entre les œuvres qui, en tout cas de mon expérience personnelle, ne s’est pas fait. Et ce que je voulais rajouter pour rebondir aussi sur la notion de médiation, il y a aussi des dessins, par exemple, d’Elsa Prudent, qui sont des dessins qui sont presque automatiques, réalisés par l’artiste presque quotidiennement. Et je trouve que c’est dommage… Moi, quand j’ai vu ces dessins, je ne les ai pas forcément compris et je trouve que c’est dommage de ne pas avoir eu même un cartel à ce niveau-là, pour justement entendre aussi ce dialogue entre l’artiste, la matière et aussi avec les œuvres qu’elle présentait, les autres tableaux qu’elle présentait. Je pense que c’est surtout cette dimension-là qui, pour moi, est un peu dommage.
Camille Bardin
Je voulais juste très rapidement, après, il faut vraiment qu’on coupe parce que sinon, Cosima va avoir trop de travail. [Rire] Je voulais juste dire deux mots encore. C’est dommage parce qu’on en a beaucoup parlé, mais j’y tenais quand même du travail de Johanna, mais aussi celui de Zine Andrieu et Fanny Souade Sow. C’est le travail de Johanna Rocard qui a travaillé avec, ça fait beaucoup de « travail », qui a travaillé avec l’école primaire Les Coquelicots de Bruyères-le-Chatel et qui montre une vidéo dans laquelle on voit des enfants qui portent des masques qu’iels ont sans doute elleux mêmes faits et qui dansent avec. Ce qu’il faut savoir, c’est que comme tu le disais Samy, Johanna Rocard, elle a proposé aux enfants, je la cite, « d’écrire un rituel de courage et d’amour contre les peurs. » Et elle dit « Nous avons énoncé nos peurs, les avons dansés, nous avons défini des gestes de courage et avons crié ensemble. » Et plus loin, elle explique aussi qu’elle a travaillé avec la photographe Estelle Chaigne, non pas pour faire une captation du moment, mais pour produire quelque chose à partir de ces corps en rituel. Et ça, je trouve que c’est vraiment trop fort. Et c’est aussi ce qu’on retrouve dans le travail de Fanny Souade Sow et de Zine Andrieu, c’est que du coup, on n’était pas simplement face à des restitutions de ce qui a été fait entre elleux. En fait, iels ont réussi à la fois à inclure les visiteur.euses qui découvrent leur travail tout en préservant bien une part de secret, à savoir qu’il n’est pas question de connaître les peurs des enfants, de savoir contre quoi ils et elles luttent, mais simplement de les regarder se déployer et s’auto défendre, ce qui fonctionne parfaitement avec le discours de la curatrice qui parle de corps qui se déploient, de modes de réinvention, de réappropriation, de transformation et qui se base sur la fameuse notion d’Elsa Dorlin dont on parlait. Et ça, j’ai trouvé ça vraiment hyper juste et vraiment très bien réalisé. Et j’ai trouvé ça bien parce que Johanna Rocard n’était pas la seule, comme on le disait, à avoir cette justesse-là, à la fois d’inclure les visiteur.euses et à la fois les personnes avec qui iels ont eu ces ateliers. Puisque encore une fois, Fanny Souade Sow et Zine Andrieu, qui, comme tu le disais, Horya ont bossé avec des personnes détenues de la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis, ont elles aussi joué avec à la fois la fiction et le documentaire pour donner à voir sans corrompre leurs voix ni donner en pâture leur intimité. Voilà, je voulais trop prendre deux minutes là-dessus. Encore désolée, Cosima. Je ne veux pas qu’on finisse tous les épisodes en s’excusant à Cosima.
Horya Makhlouf
Tu peux juste dire que c’est Cosima qui retranscrit pour nous.
Camille Bardin
Oui oui. À chaque fin d’épisode, je finis par m’excuser auprès de Cosima Dellac, qui est la personne qui retranscrit les épisodes pour nous. Donc oui, je pense qu’au fur et à mesure, les gens vont commencer à comprendre que Cosima Dellac retranscrit nos épisodes et qu’à chaque fois, on lui demande trop de travail. Désolée. Il est temps du coup de vous dire au revoir. Merci à vous trois, Horya, Luce et Samy. Et merci à vous, chers auditeur.ices, de nous avoir suivis. Au mois prochain !
Samy Lagrange
Au revoir, merci.
Horya Makhlouf
Merci, ciao.
Luce Cocquerelle Giorgi
Ciao.